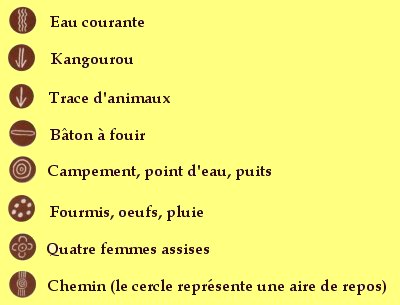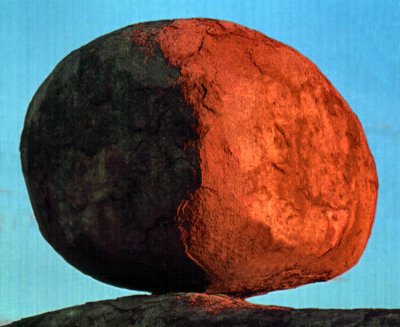| Premier mai:
En milieu de journée, enregistrement
à Roissy Charles de Gaulle, au comptoir de Cathay Pacific. Je demande
et obtiens une fenêtre. Embarquement, non sans quelque pagaille,
vers 13h30. Le sort m'a rendu voisin d'une Chinoise accompagnée
de son enfant. Elle me barre le passage et me fait comprendre d'attendre
le retour de l'hôtesse de l'air avant de m'installer. Cette dernière
m'explique en anglais que mes deux voisins sont accompagnés de la
grand-mère de l'enfant qui souhaiterait voyager en compagnie de
sa famille et m'invite à changer de place avec elle. J'accepte.
Envolés mes espoirs de photographier à travers le hublot
quelques paysages survolés: le siège de la vieille dame est
au bord du couloir! Je ne perdrai cependant pas grand chose puisqu'une
grande partie du voyage s'effectuera de nuit.
Nous décollons aux environs de 14 h et nous nous dirigeons vers le nord. J'identifie la mer Baltique et les pays baltes. Puis nous nous enfonçons dans les profondeur de la grande Russie et dans les ténèbres de la nuit. Deux mai: Douze heures plus tard, nous arrivons au dessus de Hong Kong où nous allons faire escale. J'aperçois les buildings de la cité chinoise, serrés les uns contre les autres et coincés entre les montagnes et la mer. Nous atterrissons sur un aéroport gagné sur l'élément liquide. Comme je voyage seul, j'éprouve une légère appréhension: ne vais-je pas m'égarer entre les nombreux terminaux de cet aéroport inconnu? Après avoir suivi un assez long couloir, je me trouve à une sorte de carrefour où les indications sont bien visibles et tout à fait explicites. L'organisation chinoise est irréprochable. Il est impossible de se perdre. Je trouve donc mon chemin sans la moindre difficulté et, comme je dispose de ma carte d'embarquement pour Sydney, je me dirige vers la plate-forme où je vais devoir patienter une couple d'heures. J'en profite pour tirer quelques clichés de ce que l'on aperçoit de la ville, à travers les vitres de l'aéroport. En fin de matinée, envol pour Sydney que nous devons rallier 9 heures plus tard. Cette fois-ci, nul ne me conteste ma place à la fenêtre. Je vais donc pouvoir observer avec loisir les lieux survolés. Ma voisine est une jeune femme australienne qui n'a pas dû respecter à la lettre les prescriptions de la diététique. Elle est fraîche et gentille mais victime d'un embonpoint déjà bien marqué. Nous lions conversation et j'apprends qu'elle vit à Sydney. Après une longue traversée maritime, nous abordons enfin aux rivages australiens. Vue d'en haut, la grande île ressemble à une vaste plaine désertique légèrement ondulée où domine la terre rouge. L'impression qui s'en dégage, je l'ai déjà ressentie lors d'un précédent voyage, voici une trentaine d'années. La nuit tombe avant notre arrivée à bon port. A travers le hublot, je regarde briller les innombrables lumières de Sydney qui se reflètent dans le miroir brisé des rivières et de la mer. La ville me semble construite au milieu des eaux. Je passe sans encombre le contrôle des frontières. On ne me demande même pas le document pourtant obligatoire que l'ambassade d'Australie m'a délivré à Paris pour me tenir lieu de visa. Je récupère mes valises et franchit la douane. Mes bagages ne contiennent ni produits prohibés (laitages, oeufs, viandes, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines et noix, plantes vivantes) ni produits soumis à déclaration (nourriture, produits dérivés d'animaux, articles manufacturés divers... la liste est longue!) Mieux vaut ne rien amener. Même une pomme verte entamée posera problème et il est préférable de la laisser dans l'avion. En cas d'importation illégale, la sanction peut être lourde: de 200 à 60000 dollars australiens (environ 120 à 36000 euros) et jusqu'à 10 ans de prison. Reste à savoir si ces peines affichées sont réellement infligées. Je ne me hasarderais pas à le vérifier. Je suis attendu à la sortie par une jeune femme qui m'accompagnera pendant les deux premiers jours de mon séjour à Sydney. Elle est native de Bretagne et vit depuis plusieurs années en Australie où elle est venue après avoir séjourné en Grande-Bretagne. Elle parle avec chaleur de son nouveau pays. Alors qu'elle me conduit à l'hôtel Holiday Inn Potts Point, où je vais passer quatre nuitées, elle me donne quelques renseignements sur Sydney (un plan de Sydney est ici ). Avec 4 millions d'habitants, cette ville est la métropole de l'Australie. Près du cinquième de la population de la grande île s'y trouve. D'ailleurs, la population australienne est essentiellement urbaine. Dans les campagnes, on ne rencontre plus qu'une population résiduelle. Pourtant, paradoxalement, l'essentiel du produit intérieur brut de l'Australie provient de la terre. A la différence de nombre d'autres cités à travers le monde, c'est à l'est de Sydney, c'est-à-dire près de la mer, que se trouvent les quartiers les plus chics. Un des problèmes auxquels on doit faire face, ici comme dans tout le sud de l'Australie et encore plus dans le centre, est le manque d'eau. La sécheresse sévit depuis plusieurs années et les habitants sont invités à économiser le précieux liquide. L'eau est très abondante dans le nord, mais son acheminement ne paraît pas économiquement viable pour le moment. Ce problème est, selon moi, de nature à freiner le développement démographique futur de ce pays aux ressources immenses. (Une fiche synthétique sur l'Australie est ici ). A l'hôtel, je prends congé de ma guide qui me laisse son numéro de téléphone et me donne rendez-vous pour le lendemain. Je m'installe dans ma chambre. Je me rase et me douche, ce qui n'est pas du luxe après une journée entière de voyage. Me voici à nouveau sur un continent où l'eau tourne à l'envers dans les éviers. On y roule aussi à gauche, mais il n'y a pas de lien de causalité entre les deux! Je constate que la cuvette des toilettes ne se remplit pas après usage. Suis-je déjà en train d'expérimenter à mes dépens une des conséquences de la pénurie d'eau? Non. En fait, le dispositif d'alimentation est défectueux et je le réparerai à ma façon. Mes ablutions achevées, je descend dîner. Las, il est déjà plus de 22 h et le restaurant est fermé. Les Australiens mangent de bonne heure. J'en fais déjà l'expérience. Mais ils sont aussi très serviables et la jeune femme du bar consent à me faire préparer un morceau de viande grillée accompagné d'une sauce aux oignons, judicieusement servie à part, repas que je consomme avec grand appétit accompagné d'un verre de vin rouge. Il est d'ailleurs excellent. Pour attendre le repas, j'ai pris une bière comme apéritif. Elle était également très bonne. Trois mai: Copieux petit déjeuner essentiellement composé de fruits tropicaux, selon mon choix. Je feuillette les journaux locaux. J'y lis un bref article sur le référendum du 29 mai sur la constitution européenne en France dont les informations datent de plusieurs jours. Cela ne m'apprend rien. De la captivité de Florence Aubenas et de son guide, il n'est nulle part question. En revanche, de longs articles sont consacrés à un ingénieur australien, pris lui aussi en otage en Irak, et qui risque de perdre la vie faute des médicaments que nécessite son état de santé. Les ravisseurs exigent le départ des troupes australiennes de leur pays. Naturellement, le Premier ministre australien se refuse à toute mesure allant dans ce sens. Le public français n'entendra jamais parler de cet enlèvement et le public australien ignorera le sort de la journaliste française. L'information est sélective. Lire la presse, écouter la radio, regarder la télévision... nous donne l'illusion de connaître ce qui se passe dans le monde. En réalité, on ne sait que ce que l'on a bien voulu nous en dire. La lecture de la presse étrangère est instructive à cet égard. Mis à part l'article périmé sur le référendum, durant mon séjour en Australie, je n'aurai pas de nouvelles de France. J'aurai seulement l'occasion de lire un article sur les frasques du prince de Monaco avec une hôtesse de l'air africaine. Cela donne la mesure de l'intérêt que suscite notre pays dans l'hémisphère sud! Comme je me suis levé de bonne heure,
je fais quelques pas dans les rues au voisinage de l'hôtel dans l'espoir
d'acheter l'adaptateur qui me manque pour rendre compatible le chargeur
de batteries de mon appareil numérique avec les prises locales,
plates comme en Amérique du Nord, mais en biais comme des yeux asiatiques.
Dans les hôtels chinois, les prises comportaient souvent les trois
options (française, américaine, australienne). Ici, on ne
trouve que des prises locales. Malheureusement, les boutiques ne sont pas
encore ouvertes et je fais chou blanc. Seules sont déjà à
pied d'oeuvre quelques dames exerçant le plus vieux métier
du monde. L'une d'elle me prend en chasse mais, déçue par
mon indifférence, elle ne tarde pas à renoncer. Ma guide
me confirmera que le quartier où je suis descendu était autrefois
habité par des marginaux. Il a été réhabilité,
mais il subsiste encore des séquelles de son ancienne vocation.
Nous traversons Hyde Park flanqué de bâtiments néogothiques dans le goût anglais. Nous nous dirigeons vers la pointe de la presqu'île sur laquelle est situé le jardin botanique. Ce jardin est l'oeuvre de l'épouse d'un gouverneur anglais particulièrement actif: Lachlan Macquarie. Il fut achevé en 1816. On y voit un banc creusé dans le rocher où son inspiratrice aimait venir s'asseoir, face à la baie. Ma guide me fait remarquer un sapin local dont les forêts recouvraient le territoire lors de l'arrivée des premiers européens. Mais les arbres les plus impressionnants sont sans conteste d'énormes figuiers dont les petits fruits, bien que comestibles, ne sont pas mangés et tombent sur le sol où ils pourrissent. Nous sommes en automne, mais toutes les frondaisons sont encore intactes. Aucun arbre d'Australie ne perd ses feuilles lorsqu'arrive l'arrière saison. Ils restent verts toute l'année. Vers l'est de la pointe de terre, s'étend la baie portuaire de Wolloo-mooloo. A quelques pas de là, vers l'ouest, au-delà de la baie de Farm Cove, se dresse le fameux opéra de Sydney avec, derrière lui, le nom moins célèbre pont qui enjambe la baie. Ma guide évoque brièvement quelques épisodes de l'histoire de la conquête de l'Australie et, en particulier, la rivalité qui opposa les Anglais et les Français. Au début du 19ème siècle, sous le Premier empire, des colonies françaises s'installèrent sur la côte sud explorées par le capitaine Baudin. Les Anglais, établis à Botany Bay (Sydney), redoutaient l'expansion de leurs rivaux. Ils décidèrent alors de placer la totalité du continent sous leur tutelle. Le capitaine Flinders joua un rôle éminent dans cette entreprise. Au départ, la colonie britannique était peuplée de bagnards, les convicts, déportés le plus loin possible de leur terre natale. Ils étaient traités avec une grande rigueur. Un enfant de quatorze ans fut même pendu pour servir d'exemple! (Un résumé de l'histoire de l'Australie est ici ). Nous repartons en direction de l'est. Nouvel arrêt pour admirer le panorama de la ville depuis un point de vue. Une légère brume bleutée flotte dans l'air. Sydney jouit d'un climat tempéré relativement humide, jamais ni trop froid ni trop chaud. La cité ressemble beaucoup à celles d'Amérique du Nord, avec ses buildings de verre et d'acier. Mais, autour, s'étendent des constructions plus modestes, au style colonial, agrémentées de balcons en fonte, qui ne sont pas dépourvues de charme. La conversation se porte sur le coût de la vie. Il semble un peu inférieur à celui de la France. Mais, les salaires étant plus élevés, le niveau de vie est plus confortable que chez nous. L'Australie a la chance de bénéficier d'un taux de chômage très faible: de 2 à 6% selon les régions. La protection sociale, autrefois très généreuse, a cependant été rognée ces dernières années sous l'influence de l'idéologie libérale, comme chez nous. L'Australie, bien que membre du Commonwealth, est aujourd'hui presque totalement détachée de la Grande-Bretagne. Le pays est régi par une monarchie parlementaire de type fédéral. On compte six États et deux Territoires dotés de leurs propres autorités et un gouvernement central. Ce découpage administratif ressemble à celui du Canada. Sydney est la capitale de la Nouvelle Galles du Sud. Un Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, dirige l'exécutif. Les deux principaux partis sont les conservateurs (ou libéraux), actuellement au pouvoir, et les travaillistes. La reine d'Angleterre, représentée par un gouverneur, est le chef de l'État fédéral. Néanmoins, la majorité des Australiens seraient favorables à la proclamation de la république. Un référendum sur le sujet n'a échoué que de peu, grâce à la conjonction des extrêmes: les républicains qui trouvaient insuffisant le nouveau statut proposé et les monarchistes fidèles à la couronne britannique. Beaucoup d'Australiens sont d'origine irlandaise et il est probable que nombre d'entre eux ne portent pas la "perfide Albion" dans leur coeur. La population de la grande île se sent plus proche des États-Unis que d'un royaume européen presque perdu lorsqu'il est projeté sur la carte de leur immense territoire. En dehors des nombreux points communs qui les rapprochent, tant pour ce qui concerne les origines que le mode de vie, l'histoire explique aussi largement cet engouement des Australiens pour les Américains. Au cours de la seconde guerre mondiale, les armées japonaises sont parvenues à proximité de l'Australie et, sans la défaite cuisante qui leur fut infligée par la marine de guerre des États-Unis en Mer de Corail, ce ne sont pas les soldats de l'empire britannique, occupés ailleurs, qui auraient pu empêcher l'invasion. Nous poursuivons notre périple en direction de l'est. Un crochet nous amène à proximité d'un phare que l'on ne peut d'ailleurs pas approcher et dont j'ai oublié le nom. Nous nous arrêtons à nouveau en haut d'une falaise qui tombe à pic sur l'Océan Pacifique. Ma guide aborde le sujet du climat des principales régions d'Australie. Comme on peut s'y attendre, compte tenu des dimensions du pays, celui ci varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Sydney se trouve dans la partie tempérée. Mais, au nord, Darwin est beaucoup moins favorisée. Les étés y sont si chauds et si humides que les habitants y souffrent d'une maladie qui confine à la démence laquelle porte le nom évocateur et poétique de fièvre de la mangue. Perth, à l'est, jouit d'un climat méditerranéen agréable. La partie centrale est désertique. Comme les chevaux n'y étaient pas à l'aise, lors de la colonisation, on eut l'idée d'importer des dromadaires du Pakistan montés par des cornacs afghans. Depuis, la traction mécanique ayant remplacé la traction animale, les dromadaires ont été abandonnés à leur sort. Ces derniers, parfaitement adaptés à leur nouvel habitat et n'y comptant aucun prédateur, s'y sont reproduits de sorte que des groupes de dromadaires sauvages hantent désormais le désert australien. Les crocodiles se rencontrent fréquemment dans les rivières. Leur chair figure parmi les spécialités culinaires du pays. Je n'y goûterai pas. J'ai déjà tenté l'expérience en Afrique du Sud et les qualités gastronomiques de cette viande douceâtre ne m'ont pas convaincu. Ma guide me raconte une anecdote personnelle. Au cours d'une randonnée estivale dans le Bush, elle s'approcha d'une rivière pour s'y rafraîchir les mains. Comme elle se penchait sur l'eau, un crocodile s'enfuit juste en dessous d'elle. Lequel de l'animal ou de l'homme fut le plus effrayé? Nul ne le saura jamais! Nous voici sur la plage de Bondi, paradis des surfeurs. Aujourd'hui, les rouleaux ne sont pas bien impressionnants. Aussi, les amateurs de glisse maritime sont-ils plutôt rares. Il paraît que certains mordus de ce sport lui consacrent tout leur temps. De quoi vivent-ils? De la charité publique! Pause café. Il est inutile de s'installer à une terrasse pour attendre un serveur. Il ne viendra jamais. Il faut passer commande et payer au comptoir. Ensuite, le préposé vous apportera votre consommation là où vous aurez pris place. Retour vers le centre ville en passant par Paddington dont les terrace houses victoriennes aux balcons de fontes, aux façades étroites et aux appartements profonds, pleines de charme, sont justement réputées et... coûteuses. Oxford Street est la rue gay de Sydney. Il y a aussi un quartier chinois, vers l'ouest. La Chinatown de Sydney est la plus ancienne du pays. Selon la légende, deux cuisiniers se trouvaient à bord des bateaux de la première flotte, en 1787. Officiellement, les Chinois arrivèrent dans la ville en 1818. Au milieu du 19ème siècle, ils participèrent à la ruée vers l'or. Aujourd'hui, ils seraient environ 150000 à Chinatown et dans les faubourgs de l'ouest. Il y a aussi une communauté indochinoise qui fut grossie par les boats people voici une trentaine d'années. Terre d'immigration, l'Australie accueillit près de 6 millions d'habitants de 150 pays de 1945 à 2001. Plus du quart de la population est né à l'étranger. Par George Street, nous nous dirigeons vers le port où nous allons embarquer dans un catamaran pour une croisière dans la baie pendant laquelle nous déjeunerons. Tandis que ma guide attend la personne qui
doit venir chercher notre voiture, je flâne sur les
quais. Juste de l'autre côté du bras d'eau s'élève
le musée de la marine. Devant lui trois navires sont à quai:
un sous-marin, un bateau de guerre de surface et une réplique de
la Bounty dont seules les vergues les plus hautes s'aperçoivent
par delà les structures massives des deux vaisseaux de guerre modernes.
Alentour, se dressent des immeubles de béton sur lesquels je remarque
des enseignes familières: hôtel Ibis, Mercure... Au passage,
j'ai déjà noté les buildings d'Axa et d'IBM. Le quartier
des affaires n'est pas loin. Un pont utilisé par un petit train
monorail enjambe les eaux. Des traversiers colorés croisent dans
la baie. Nombre d'entre eux servent de moyens de transports en commun d'un
rivage à l'autre. Il y a aussi des bateaux de croisière,
dont un à aube, blanc comme ceux du Mississippi.
Le buffet est bien garni. Je choisis quelques huîtres comme entrée et du poisson comme plat de résistance. Un gros piment rouge, visiblement destiné à décorer le plat, attire mon attention et suscite ma convoitise. Il excitera mes papilles et finira dans mon estomac. Comme boisson, j'élis un verre de vin blanc sec. Les huîtres sont peu iodées, trop grasses pour moi, mais leur goût est fin. Le poisson est bon. Le vin est excellent, mais pas donné: 14 dollars le verre (9 euro environ); nous sommes sur un bateau; en ville, il revient à moitié prix. Un fromage et un dessert achèvent le repas. Nous prenons notre café sur le pont en regardant défiler les rives. On saisit bien les différences architecturales des différents quartiers visibles de la baie: ici des gratte-ciel, là des maisons résidentielles plus basses que séparent de larges taches de verdure. Je crois reconnaître des lieux visités pendant la matinée. Nous nous rapprochons de la cité et de ses buildings. Des voiliers blancs croisent devant l'opéra. La tour ronde du vieux fort Denison, bâti sur un îlot, paraît minuscule à côté des hauts immeubles modernes, en avant plan des grues d'un port. Nous remontons ce que je crois être l'estuaire de l'une des rivières qui arrosent la ville, un bras d'eau qui porte le nom de Port Jackson, d'après une carte en ma possession. L'océan pénètre à l'intérieur de la cité à travers de larges échancrures et je comprends mieux pourquoi la première vision nocturne que j'ai eu de Sydney m'a fait penser à une agglomération construite sur l'eau. Nous passons sous le pont de fer qui enjambe la baie. Nous longeons d'anciens locaux portuaires écrasés par la masse des constructions modernes construites derrière eux. Certains ont été réhabilités. Peints de couleurs vives, jaunes et bleues, ils sont assez pimpants. Une grande roue tourne à côté d'eux ce qui confère à l'ensemble des allures de Lunapark. La croisière s'achève sur le quai dit circulaire, bien qu'il ne le soit qu'à demi et encore. J'achète trois ou quatre cartes postales que je destine à mes proches restés en France. Nous voilà sur la terre ferme. L'après midi sera consacré à la visite pédestre de la vieille ville. Nous marchons le long du quai, en direction du quartier des Rocks. Des Aborigènes proposent sur le trottoir les produits de leur artisanat. Nombre d'entre eux vivent dans les villes et il n'est pas rare d'en rencontrer, même dans les plus importantes. Un joueur de didgeridoo vend des CD à 10 dollars pièce. D'ordinaire, les Aborigènes, très timides, n'acceptent généralement pas de se laisser photographier. Lui en a fait une occasion d'arrondir les fruits de son commerce. Moyennant deux dollars, ainsi que le précise une étiquette apposée contre une sorte de panier, il est possible de lui tirer le portrait. Je laisse tomber une pièce de deux dollars dans la sébile improvisée avant de fixer la scène sur la mémoire magnétique de mon appareil numérique. Devant nous, au delà d'une petite place verdoyante, la structure métallique du pont qui traverse la baie ferme l'horizon. Nous longeons d'anciens entrepôts réhabilités et nous débouchons face à l'opéra. Celui-ci s'élève sur une pointe de terre dont on ne savait trop que faire. On hésita longtemps avant de décider de son affectation définitive. La conception de l'édifice fut confiée à un architecte norvégien, Joern Utzon. C'est ce dernier qui eut l'idée géniale de lui donner cette forme audacieuse qui évoque celle d'un voilier aux ailes gonflées, prêt à prendre le large. La construction de ce monumental bâtiment coûta beaucoup plus cher que prévu et, les crédits venant à manquer, son inventeur fut congédié. Les architectes australiens qui prirent la suite adaptèrent l'aménagement intérieur afin de respecter les contraintes budgétaires de sorte que l'ensemble reste en quelque sorte inachevé. Pour défrayer le prix des travaux, les autorités australiennes eurent l'idée de créer une loterie. Le premier tirage favorisa un jeune couple pourvu d'un enfant. Comme c'est souvent le cas en de telles occasions, les parents soudain fortunés se trouvèrent sous les feux de l'actualité et sous les regards de gens pas toujours bienveillants. L'enfant fut enlevé dans l'espoir d'obtenir une rançon. Le gouvernement s'opposa au paiement de cette dernière par crainte d'inciter d'autres malfaiteurs à imiter les kidnappeurs. L'enfant fut retrouvé mort et ses assassins courent toujours. Lors des jeux olympiques de l'an 2000, l'architecte danois fut invité. Il refusa de retourner dans une ville qui l'avait évincé quelques années plus tôt avant d'avoir terminé son oeuvre. Ces différentes péripéties n'empêchent pas l'opéra de Sydney d'être l'un des plus spectaculaires témoignages de l'architecture moderne. Devant l'une des maisons les plus anciennes de Sydney, le Cadman's Cottage, construite en 1816, une petite assemblée s'est agglomérée autour d'un bonimenteur. Nous pénétrons à l'intérieur. C'est l'occasion de me familiariser avec l'architecture de l'époque. Les murs sont en gros moellons taillés. On remarque des lots de pierres relativement homogènes. Certaines pierres sont marquées d'une trace gravée qui évoque une signature. Les artisans de l'époque apposaient ainsi leur marque de fabrique. On peut ainsi déterminer la provenance de chaque lot et reconstituer l'histoire de l'édification du bâtiment. Au fond d'une fouille, je remarque de gros tuyaux d'argile cuite: adduction d'eau ou égouts? Nous poursuivons notre cheminement le long d'anciens entrepôts de brique réhabilités dont le style rappelle les maisons hollandaises. A la traversée d'une rue, ma guide me fait observer, le long d'un trottoir, un cadre de fer bordant un espace où ont été conservés, pour l'édification des générations futures, quelques-uns des pavés de bois dont la rue était autrefois couverte. Par temps de pluie, j'imagine que ce revêtement devait s'avérer plutôt glissant. Nous voici parvenus au quartier
des Rocks. Les maisons y furent construites,
au début de la colonisation, à même une sorte de falaise.
Sur une place piétonne pavée de briques, un monument de pierre
blonde me fait penser à un tableau de Magritte. Ce monument comporte
plusieurs faces. Sur chacune des faces, des personnages typiques de l'histoire
du pays: convicts, colons... sont sculptés en creux. Les petits
immeubles d'origine, aujourd'hui réhabilités et convertis
en commerces, sont dominés par les hautes tours de la cité
toute proche. Je note la présence d'un restaurant italien. Nous
nous engageons dans des ruelles, puis empruntons les escaliers de fer qui
longent la falaise. Un peintre expose ses oeuvres autour du trou d'anciennes
latrines! Des moutons et des poules se promènent en haut d'un mur.
Des personnes en costume d'époque participent à l'animation
du quartier. Elle tiennent une taverne en plein air au milieu de meubles
en fer pour que les intempéries ne les détériorent
pas. Il y a un canapé, une horloge debout, une étagère...
Quelques vestiges des habitations d'autrefois permettent de se faire une
idée de la vie ici au moment de la colonisation: pièces sombres,
massif évier de pierre... Nous passons par une étroite rue
qui était jadis un coupe-gorge. Puis nous regagnons la civilisation
moderne. Un homme, déguisé en convict et accompagné
de deux autres personnages vêtus comme des matons, nous salue en
nous disant en riant qu'il sera libéré demain.
Je retire un peu d'argent dans un distributeur. Sans problème. Je cherche à me procurer un adaptateur pour recharger mes batteries. J'y parviens après un premier essai infructueux. Nous voici à l'intérieur du Queen Victoria Building, "the most beautiful shopping center in the world", d'après les dépliants touristiques. Cet édifice prestigieux fut d'abord un grand magasin. Mais son entretien coûtait trop cher pour le Sydney de l'époque. Le magasin fit faillite et l'immeuble fut converti en édifice administratif. Maintenant, il a retrouvé sa destination commerciale sous forme de galeries marchandes où sont installées des boutiques de luxe. Au milieu de la galerie centrale, trône une horloge monumentale au style intéressant, sous la voûte de verre. De l'autre côté du bâtiment, sur une place entourée d'immeubles du 19ème siècle, s'élève la statue de la reine Victoria assise, juchée sur un haut piédestal. J'aurai l'occasion de revoir l'effigie de la souveraine et d'entendre son nom à plusieurs reprises, dans la ville et ses environs. Elle semble avoir été la bonne fée de la colonie britannique. Au pied du monument, un jeune homme habillé de rouge vend un magazine dont la couverture est illustrée d'une colombe de la paix. S'agit-il d'un titre engagé dans la lutte contre la guerre? Je ne me pose même pas la question. Nous passons sous le train monorail dont les wagons me paraissent de taille plutôt modeste et ma guide m'amène vers une station de taxi d'où je rejoins mon hôtel. La première journée à Sydney vient de s'achever. La nuit tombe avec une rapidité déconcertante. Il en va toujours ainsi à Sydney, paraît-il. Mais la transition entre le jour et la nuit est plus lente ailleurs. J'aurai l'occasion de le vérifier. Le soir, au dîner, vin effervescent à l'apéritif. Il est rouge, quelque peu liquoreux et ne me convient que très médiocrement. Ensuite, pizza aux légumes arrosée de vin rouge. On trouve des pizzas dans toutes les villes du monde et elles n'ont jamais le même goût. Les meilleures, selon moi, sont celles du Québec. Elles sont plus riches que celles d'Italie. Passons sur la nourriture; pour ce qui est du vin, je le trouve trop chargé en alcool et sa saveur, fortement marquée, manque de finesse. Il ne vaut pas les vins français. Mais je ne saurais me prononcer définitivement à partir d'une expérience aussi limitée. On ne m'a sans doute pas servi un grand cru australien. Quatre mai: J'ai passé une très mauvaise nuit, à aller et venir entre mon lit et les toilettes. Je mets cette indisposition sur le compte du piment rouge que j'ai mangé sur le bateau. Destiné à servir d'élément décoratif, sans doute n'avait-il pas été bien lavé. Au matin, je suis épuisé et je me demande si je ne vais pas annuler mon excursion aux Montagnes Bleues; ce serait dommage. Je finis par me résoudre à m'habiller. Je me contente d'un petit déjeuner spartiate. Dans le hall, je fais la connaissance d'un couple de Français qui s'impatientent. Ils seront de l'expédition. Ils ont été convoqués par l'agence de voyage pour 8 heures et s'étonnent de ne voir encore personne. Je les rassure: la guide m'a donné rendez-vous à 8h30. Elle est ponctuelle, comme hier. Nous partons en direction de l'ouest. La conversation tombe d'abord sur l'immigration. L'Australie est toujours une terre d'accueil. Mais les Australiens sont méfiants et redoutent d'être dominés par les étrangers, notamment asiatiques. Les Néo Zélandais constituent une proportion importante des travailleurs immigrés. Le niveau de vie dans leur pays est sensiblement inférieur à celui de l'Australie. Ils sont attirés par de meilleures conditions d'existence et leur intégration ne posent pas de gros problèmes. L'obstacle de la langue n'existe pas pour eux. Ils constituent aujourd'hui la principale source d'immigration, devant les Chinois et les Sud-Africains. Premier arrêt dans un parc animalier. Un gardien va nous chercher un wombat pour nous le faire caresser. Cet animal est un marsupial que l'on pourrait rapprocher du blaireau. Les marsupiaux portent une poche sur le ventre pour y abriter leurs petits. L'archétype en est le kangourou. Mais il existe en Australie quantité d'autres marsupiaux. Cette variété d'animaux s'est développée en autonomie alors que la grande île était isolée des autres terres pendant une très longue période. La faune et la flore australiennes ne constituent d'ailleurs pas une exception. Dans le Pacifique, sur de nombreuses îles, on rencontre des espèces endémiques qui n'ont pas toujours leur équivalent ailleurs. Mais revenons à notre wombat. Cet animal possède seulement une paire d'incisives en haut et en bas de la mâchoire. Ses dents sont dépourvues de racines et poussent continuellement au fur et à mesure qu'il les use. Sa taille peut atteindre 1,5 mètres et son poids 30 kilos. Très puissant, il creuse sans difficultés les terriers dans lesquels il vit, au moyen de ses fortes griffes. (Une note sur les animaux fouisseurs, dont le wombat, est ici ). Voici maintenant le koala qui ressemble à un gentil petit ourson. C'est aussi un marsupial. Il vit dans les arbres et se nourrit des feuilles d'une variété d'eucalyptus. On le rencontre donc seulement là où pousse cet arbre. Il ingurgite un important volume de feuilles. Il ne boit jamais car sa nourriture lui apporte suffisamment d'eau. Il tient d'ailleurs son nom aborigène de cette particularité. Les mâles se sustentent de jour et les femelles de nuit. Sa nourriture étant peu énergétique, le koala se comporte comme un paresseux. Il dort quand il ne mange pas, fortement accroché aux branches des arbres. La femelle met au monde un seul petit par portée. Sa gestation est de 35 jours (pendant l'été austral, de décembre à mars). Le petit koala reste près de six mois dans la poche de sa mère, où il passe son temps à dormir ou à téter. Puis la femelle le porte sur son dos jusqu'à la prochaine saison des amours. Il est alors chassé par un mâle et vit seul jusqu'à sa maturité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait à son tour rencontré l'âme soeur. (Une note sur le koala est ici ). Au tour des oiseaux: des cacatoès, de petits pingouins australiens qui vivent probablement dans le sud à proximité des courants froids... Un kangourou qui se dissimule à demi derrière la végétation. Nous en verrons d'autres. Un dingo, le chien sauvage australien, dort couché sur le sol de sa cage. Cet animal est à peu près le seul à avoir été domestiqué par les Aborigènes. (Une note sur le dingo est ici ). Il existe de nombreuses espèces de kangourous
qui diffèrent par l'apparence et la taille. Je me suis contenté
de retenir deux d'entre elles: le kangourou et le wallaby ainsi que leur
hybride: le wallarou (je ne garantis pas l'orthographe!). Le wallaby est
plus petit que le kangourou. Plusieurs échantillons de ces animaux
sauteurs s'offrent à notre vue. Nous n'aurons pas l'occasion de
les voir boxer. Il paraît qu'ils vident ainsi leurs querelles, notamment
pour éliminer un rival trop entreprenant auprès d'une femelle.
Le combat est rarement mortel. Très souvent un oiseau accompagne
le kangourou. Peut-être se nourrit-il de ses excréments.
(Une note sur
ces marsupiaux est ici
).
Voici maintenant d'autres oiseaux, plus gros, deux sortes d'autruches: un casoar, au plumage de jais, au cou bleu orné d'une caroncule rouge, à la tête sommée d'une crête cornée; des émeus gris, nettement moins séduisants, mêlés à des moutons (un symbole de l'Australie?); puis un animal moitié oiseau moitié rat qui dort pendu par les pieds la tête en bas: une chauve-souris qui, par sa taille et son poids, vaut bien au moins quatre ou cinq de nos pipistrelles; un oiseau dont le cri est un rire: le kookaburra; nous attendrons un moment avant qu'il ne daigne s'esclaffer pour notre plaisir. Cela nous permettra de voir passer des touristes hispanophones: ils viennent du Mexique. (Des renseignements complémentaires sur les oiseaux d'Australie sont ici - Cacatoès - Emeus - kookaburra) Nous repartons. De chaque côté de la route s'étendent de vastes prairies clôturées où paissent des vaches ou des chevaux. Les fermes australiennes, qualifiées de stations, sont immenses. L'une d'elle couvre la superficie de la Belgique. Les troupeaux sont surveillés par avion. Les vachers australiens ne sont pas des cow-boys, mais des stockmen. On élève à peu près de tout: des bovins, des ovins (l'Australie est le principal exportateur de laine du monde, celle des fameux mérinos), des chevaux. Les Australiens sont joueurs. Nombre d'entre eux parient et fréquent les hippodromes. Les chevaux commencent à courir jeunes (2,5 ans) et leur carrière s'interrompt tôt (vers 4 ans). Ils finissent leur vie tranquillement dans les herbages. Grand amateur de viande de boeuf, l'Australien répugne à manger du cheval. La plus noble conquête de l'homme ne court pas le risque de se retrouver à l'étal d'une boucherie avant de terminer sa trajectoire dans une assiette. Par contre, la chair de l'émeu, celle du kangourou, celle du dromadaire ou celle du crocodile sont servies dans les restaurants. Pause café dans la petite ville de Windsor.
Tandis que notre guide prépare la table, dans une halte prévue
à cet effet, nous nous promenons dans la bourgade. Restaurant chinois,
rue pavée de briques, roue de bois d'un moulin actionnée
par un ruisseau souterrain, balcons de fonte victoriens... Nous buvons
notre breuvage en grignotant quelques gâteaux secs. Au long des routes,
de nombreuses aires de pique-nique sont aménagées. On peut
s'y livrer aux joies du barbecue sans bourse délier, la viande mise
à part, puisque l'installation et même le combustible sont
fournis gratuitement par les municipalités.
Nous déjeunons dans une autre bourgade qui porte le nom de la reine Victoria (Victoria Mount, je crois). Comme mon indisposition de la veille me tourmente encore, je choisis un plat aussi léger que possible accompagné, une fois n'est pas coutume, d'un simple coca cola supposé efficace contre les douleurs intestinales. Au hasard d'une rue ombragée, nous découvrons quelques feuillages roussis d'arbres importés d'Europe. Au lieu de changer de couleur et de tomber comme chez nous, les feuilles semblent s'être recroquevillées, après avoir jauni ou rougi, avant de quitter les branches. Les essences australiennes, on l'a déjà dit, restent vertes toute l'année. Premier arrêt dans les Montagnes bleues. Ces escarpements, bien que peu élevés, le point culminant de l'Australie, le mont Kosciusko ne dépasse pas 2230 m, n'en furent pas moins un obstacle longtemps invaincu à la progression coloniale en direction de l'ouest, c'est-à-dire vers l'arrière pays (outback) et le centre du continent. Ils sont en effet couverts d'une forêt touffue, coupés de gorges profondes sur lesquelles tombent des falaises abruptes et il était plus facile de s'y perdre que d'y trouver son chemin. Nous nous dirigeons vers un point de vue qui domine la Grose Valley. Eucalyptus à perte de vue. Droit devant nous une haute falaise rougeâtre, striée de couches alluvionnaires. Notre guide nous dit quelques mots concernant la flore. J'apprends l'existence de l'arbre à thé (tea tree) dont l'huile essentielle, diluée dans l'eau ou l'huile, guérit les écorchures et calme les piqûres d'insecte. J'en ferai mon profit. Nouvel arrêt au-dessus d'une gorge spectaculaire. Charles Darwin, qui visita les lieux le 18 janvier 1836, fut impressionné par la symétrie des couches horizontales qui se retrouvent sur chaque bord de la large échancrure. L'érosion eut raison du basalte qui forme la couche supérieure et dont subsistent encore des restes sur les sommets (monts Hay et Banks). Les débris furent emportés vers la mer par les rivières Grose et Hawkesbury. L'érosion, favorisée par l'alternance de périodes sèches et de périodes humides, mina le sable des couches inférieures entraînant, à la longue, l'effondrement des couches supérieures ce qui explique la verticalité presque parfaite des falaises. Notre guide nous indique la présence d'une cascade actuellement asséchée qui, sur la droite de la vallée, dévale de la cime jusqu'à l'abîme. Une vapeur bleuâtre, qui a donné leur nom aux montagnes, plane sur la forêt en contre bas. Elle est la conséquence d'une sorte de sueur qui émane des eucalyptus. Autre arrêt à la Jamison Valley, non moins impressionnante. Droit devant nous, une sorte de table élevée bouche la perspective. Notre guide nous fait remarquer une plante originale, l'arbre à herbe, un tronc court recouvert d'une chevelure drue qui retombe de chaque côté. J'en reverrai plus tard à Cairns. Des touristes anglophones, qui viennent d'arriver, écarquillent leurs yeux afin de découvrir le téléphérique qui permet d'accéder au fond de la vallée au lieu d'admirer le paysage splendide qui s'offre à leur vue. Nous ne perdrons pas notre temps dans une activité aussi stérile. Ultime arrêt aux Trois Soeurs, un groupe de trois rochers dressés en forme de tours pointues en surplomb de la vallée que l'on observe du haut d'une terrasse aménagée. Passage à travers une allée de fougères arborescentes. Photo souvenir de nos compagnons de voyage. De retour en France, ils m'enverront un exemplaire. Notre guide nous fait part de l'existence d'une mine de charbon qui était autrefois exploitée à ciel ouvert, dans la vallée. Elle est aujourd'hui abandonnée mais l'élévateur qui servait à hisser la houille est maintenant utilisé pour véhiculer les touristes qui souhaitent se rendre en bas. Nous n'aurons pas le loisir de profiter de cette attraction d'ailleurs non prévue au programme. Nous revenons vers Sydney. Après une nuit blanche, je commence à ressentir de la fatigue. Je m'assoupis par moment bercé par la conversation de mes voisins et le ronflement du moteur. De retour à l'hôtel, je prends définitivement congé de ma guide. Elle m'indique comment employer la journée libre du lendemain. Dîner à l'hôtel. Nuit paisible et reposante. Cinq mai: Petit-déjeuner plus substantiel que la veille, avec beaucoup de fruits, selon mon habitude. Dernier jour à Sydney. Conformément aux conseils de ma guide, je descends la rue où est situé l'hôtel, en direction du port. Un escalier permet de parvenir jusqu'au quai. La traversée de la chaussée pose problème. Ici, on roule à gauche et, d'instinct, je regarde du mauvais côté, avant de me reprendre. Heureusement, il y a des feux. Ils sont même doubles: le premier de ce côté du carrefour, comme chez nous, et le second de l'autre côté, comme au Québec. Ainsi, les automobilistes, même lorsqu'ils s'arrêtent au premier feu, peuvent toujours voir le second et démarrer dès son changement. Pour les piétons, le signal lumineux est accompagné d'un signal sonore: bruit lent et espacé pour le rouge, plus rapide pour le vert indiquant qu'il faut se dépêcher de passer. Les daltoniens et les aveugles n'ont pas été oubliés! Puisque nous en sommes à la circulation, signalons qu'en Australie l'inscription les plaques d'immatriculation des véhicules ne sont pas standardisées. Chacun peut y faire figurer ce qu'il veut, ou à peu près. Je me rends d'abord sur la jetée qui s'élance dans la baie de Wooloo-mooloo (voir le plan de Sydney). A cette heure matinale, on en est encore au nettoyage des façades. Je repère deux ou trois restaurants pour le déjeuner. De nombreux bateaux de plaisance sont à quai dans le bassin. Je me dirige vers le jardin botanique visité le premier jour, de l'autre côté du bassin. Je gravis un escalier et me retrouve à proximité d'un bâtiment de pierre blonde, de style néo-antique, entouré de statues parmi lesquelles je crois en identifier une de Moore. C'est le musée des arts de Nouvelle Galles du Sud (NSW Art Gallery). Je me promène au hasard des allées du parc verdoyant qui est en face du musée: The Domain. On aperçoit le haut des buildings de la cité au-delà des arbres. Des ibis grattent tranquillement de leur long bec noir recourbé le gazon des pelouse à la recherche de nourriture. J'emprunte une allée bordée de figuiers centenaires dont les fruits jonchent le sol. Je me retrouve, au bord de l'avenue qui longe le musée, face à la statue d'une vieille connaissance: le poète écossais Robert Burns, un poing sur la hanche et l'autre serrant le mancheron de sa charrue. Je me dirige vers la cité. Je passe devant la cathédrale, monument néo gothique britannique assez réussi. Me voici à proximité de Hyde
Park. Je visite les baraques (ou casernes)
de briques construites en 1817, pour loger les bagnards, par le gouverneur
Macquarie. Jusqu'à cette date, les déportés étaient
abandonnés sur la côte inhospitalière de Botany Bay
où ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Parmi eux,
on comptait des femmes et des enfants. Tous n'étaient pas de grands
criminels. Le délit de vagabondage était, au 18ème
siècle, sévèrement puni dans une Angleterre en pleine
mutation économique. L'essor industriel, dans ce pays, comme ce
fut le cas plus tard ailleurs, ne s'encombra pas de sensiblerie! Les convicts
étaient durement traités. Un enfant de quatorze ans fut pendu
pour servir d'exemple. Le châtiment le plus courant était
la peine du fouet. On administrait jusqu'à cent coups d'un martinet
à plusieurs queues sur le dos dénudé du condamné.
La peau était mise en lambeaux et le dos n'était bientôt
plus qu'un amas de chairs sanguinolentes. Nombre de suppliciés n'y
survivaient pas. (Un texte sur ces baraques,
aujourd'hui transformées en musée, figure
ici ).
Après ma visite, je découvre, de l'autre côté de la rue, le blason de l'Australie sur la façade d'un édifice: kangourou et émeu y voisinent. Sur la place contiguë, une petite église est perdue au milieu des hauts édifices modernes. Une statue de la reine Victoria debout, sceptre en main, paraît encore régner sur la ville. Je vais flâner un moment dans Hyde Park. Une fontaine, agrémentée de jets d'eau, rafraîchit l'atmosphère à la jonction de larges allées. Je reviens sur mes pas pour prendre la Macquarie Street qui descend jusqu'au port, derrière l'opéra. Je longe successivement divers bâtiments qui méritent de l'intérêt: Mint Museum, Sydney Hospital, Parliament House, State Library, devant laquelle je photographie la statue du capitaine Flinders, héros de la colonisation. Je me promène sur le port, au bord de Sydney Cove. Puis je fais le tour de l'Opéra, encore plus impressionnant de près que de loin. De la pointe de l'avancée sur laquelle il est construit, on voit parfaitement le fort Denison. J'en profite pour prendre un dernier cliché de cet ancien ouvrage défensif. Ensuite, comme la matinée se termine, j'explore le Circular Quay à la recherche d'un restaurant. j'en trouve plusieurs, mais aucun ne me convainc. Je décide donc d'aller prendre mon repas à Wooloomooloo Bay. Je longe le jardin botanique sur le bord de Farm Cove. Un énorme figuier, sans doute très âgé, attire mon attention. Parvenu sur la jetée, je me décide pour le Kingsleys Steak & Crabhouse. Mes voisins tranchent allègrement d'énormes morceaux de boeuf rôti accompagnés de frites. Je me décide pour le crabe bleu, un verre de vin blanc pétillant (le champagne australien) en apéritif et un verre de vin blanc sec pour accompagner le plat. Hélas, pour ce qui est de l'apéritif, je devrais me contenter d'une bouteille d'eau minérale gazeuse! La serveuse qui a pris ma commande a dû mal interpréter mon anglais approximatif. A ses yeux, il est probablement impossible qu'un touriste prenne à la fois un verre de champagne et un verre de vin blanc! Comme c'est une autre personne qui me sert, je me contente de ce que l'on m'apporte. A la cuisson, le crabe a viré du bleu à l'orange. Il est délicieux. Le vin blanc est excellent. Bref, je suis, malgré l'erreur de la serveuse, assez satisfait de mon déjeuner. Je retourne en direction de mon hôtel pour y prendre un peu de repos. A quai, dans l'un des bassins de la baie de Wooloo-mooloo, je remarque un bateau de guerre qui porte le nom de Vendémiaire. Est-ce un bâtiment de notre marine nationale? Aucun pavillon ne le laisse supposer. Chemin faisant, j'admire quelques belles maisons victoriennes colorées pourvues de balcons en fonte très typiques. J'entre dans un cyber center pour relever mon courrier sur Internet. L'opération me coûte deux dollars australiens (1,2 euros environ); c'est tout à fait raisonnable. Il y a bien une prise Internet dans ma chambre d'hôtel, mais il me faudrait un ordinateur pour l'utiliser et je n'en ai pas. Une fois reposé, je décide d'explorer le quartier. Je me dirige vers Elizabeth Bay. Je découvre une ancienne maison très jolie. Puis je flâne au hasard des rues dans cet ancien repaire de hippies. Sous le porche d'une église, des sans logis ont élu domicile; ils ont étendu leur matelas sur le sol et dorment dessus. Par pudeur, je ne les photographie pas; je suis ramené à la situation que je vis quotidiennement à Paris. Le niveau de vie est peut-être plus élevé en Australie qu'en France; l'Australie ne connaît pas notre taux de chômage; pourtant, il existe aussi des miséreux aux antipodes! Il y a toujours eu des clochards dans notre capitale, mais le nombre de personnes sans domicile fixe s'y est accru ces dernières années par suite de la dégradation des conditions économiques et sociales. L'Australie connaît-elle la même dérive? Je prends mon dernier dîner à l'hôtel. Champagne australien, viande grillée, vin rouge, plateau de fromages, dessert. Le champagne est convenable, le vin rouge trop alcoolisé et de goût trop prononcé selon moi, la viande est bonne, mais c'est surtout les fromages qui emportent mes suffrages. Je les trouve excellents et je témoigne ma satisfaction au serveur chinois en lui disant qu'ils valent des fromages français; il en tombe presque à la renverse de saisissement et me précise qu'ils proviennent d'une ferme peu éloignée de Sydney. Quant au vin, j'ignore sa provenance, mais on trouve des vignobles en Nouvelle Galles du Sud; les principaux sont situés dans la vallée de la Hunter au nord de Sydney, et, à l'ouest, près des villes de Mudgee, Cowra et Young, ainsi que dans les plaines arrosées par le Murrumbidgee et le Murray. Je regrette de n'avoir pas eu le temps d'aller y faire un tour. Six mai: Petit-déjeuner.
Je règle ma note: la caissière parle français. Attente
du chauffeur qui doit me conduire à l'aéroport dans le hall
de l'hôtel. J'y retrouve mes compagnons français d'excursion
aux Blues Mountains. Ils sont sur le départ pour Melbourne. Un Australien
nous aborde et nous pose une question que nous ne comprenons pas. En fait,
il a mal prononcé mon nom. Il l'épelle et tout rentre dans
l'ordre. C'est mon chauffeur. Adieux.
A l'aéroport, je prend ma place dans la file d'attente pour Ayers Rock. Ce n'est pas trop long. Le voyage sera sans histoire. Vision de Sydney de jour du haut des airs. Le désert rouge: une interminable plaine que soulèvent parfois des éminences: allure de volcan, chapeau de gendarme... A Ayers Rock, en fin de matinée, je rencontre un nouveau guide, au carrousel où je retire mes bagages. Je fais également connaissance avec un couple de Basques espagnols avec qui je vais faire équipe pour l'après-midi et la matinée suivante. Nous avons à peine le temps de ranger nos affaires dans nos chambres de l'Outback Pioneer Hotel & Lodge et de manger un morceau sur le pouce qu'un autre guide nous attend pour une excursion aux Monts Olga (Kata Tjuta en langue aborigène). Il est recommandé de se munir d'un chapeau, de crème solaire, de lunettes de soleil, de bonnes chaussures de marche et d'au moins un litre d'eau. Notre nouveau guide, un Français, est cuisinier de profession. C'est l'occasion de parler de gastronomie. D'après lui, la nourriture s'est améliorée en Australie au cours des années. Lorsqu'il est arrivé ici, la viande était l'aliment dominant. On ne mangeait que peu de légumes. Un barbecue pour une dizaine de personnes se composait d'un quartier de boeuf et de trois ou quatre pommes de terre! Les légumes et les fruits sont maintenant plus appréciés. La tendance à l'obésité d'une partie importante de la population et les recommandations d'hygiène alimentaire y sont certainement pour quelque chose. Pourtant la nourriture demeure encore très largement carnée. Notre bus nous emmène au milieu du désert
au devant des dômes (36 en tout, mais on ne les voit pas tous à
la fois) qui sélèvent au milieu du désert comme les
dos d'un troupeau de pachydermes assoupis. Cette formation montagneuse
d'arkose rouge a une longue histoire. Des sédiments s'accumulèrent
d'abord au fond de l'eau. Ensuite, ils s'élevèrent jusqu'à
la hauteur de l'Himalaya à une époque où l'Australie
n'était pas encore séparée du Gondwana, un continent
qui réunissait à elle l'Afrique, l'Inde, l'Amérique
du Sud et l'Antarctique voici 150 millions d'années. Puis de nouveaux
bouleversements géologiques les précipitèrent dans
l'abîme. Enfouis à plusieurs milliers de mètres de
profondeur, la pression et la chaleur qu'ils subirent les aggloméra
en sorte de brique compacte, avant que de nouveaux événement
ne les fassent resurgir. Les éléments, le vent et l'eau,
combinèrent alors leurs effets pour leur donner leur forme actuelle.
Nous pénétrons à pied à l'intérieur de l'imposant massif en empruntant une étroite vallée, la Walpa Gorge, entre deux hautes falaises, presque verticales, dans lesquelles l'érosion a creusé de nombreuses cavités. Comme aux Montagnes Bleues, lorsque le dessous d'un bloc est suffisamment miné, celui-ci se détache et tombe en bas de la pente. De nombreux rochers y gisent. Leur composition me rappelle, dans d'autres teintes, celle des montagnes du Tibet traversées l'an dernier. De longues traînées verticales noires dévalent du haut en bas des falaises témoignant du rare passage des eaux. Il ne pleut ici qu'environ tous les douze ans et encore! Mais des algues et des lichens profitent du peu d'humidité qui subsiste pour se cramponner à la roche et la marquer de leur sombre empreinte. Nous croisons des groupes de touristes au visage caché derrière des résilles noires pour se protéger des mouches nombreuses et agressives. Ce déguisement leur donne des allures d'apiculteurs. Nouveaux arrivants, nous n'avons pas eu le temps de nous équiper. Il nous faudra affronter les importuns insectes volants à face découverte. Le fond de la vallée est parcouru par un ruisseau à sec encombré d'arbustes et de broussailles d'un gris verdâtre. Les mulgas y dominent. Notre guide nous fait observer leurs petites feuilles recroquevillées. Celles-ci recueillent la moindre goutte d'eau, la dirigent comme une chêneau vers la branche et, de celle-ci, elle coule jusqu'au tronc pour aller abreuver la plante par ses racines, quand elle n'est pas évaporée avant. Ces plantes se sont ainsi adaptées à un environnement particulièrement sec afin de maximiser le bénéfice d'ondées trop parcimonieuses. La vallée se termine par un étroit couloir inaccessible tapissé de végétaux ras. Nous revenons sur nos pas. En face de nous, la haute tranchée s'élargit sur une vaste plaine à contre jour. On nous conduit ensuite vers un point de vue d'où nous pourrons admirer et photographier dans leur entier les mamelons entourant la vallée. Si leurs flancs sont rigoureusement nus, une touffe d'arbres apparaît sur leur sommet comme un bouquet de cheveux sur le crâne d'un individu à demi chauve. La vie est réellement tenace! Vues d'ici, les collines qui encadrent la gorge font penser aux gigantesques fesses de deux géants nus couchés sur le ventre. Les recommandations concernant la boisson désaltérante s'avèrent superflues: il y avait de quoi dans le car. On nous emmène ensuite vers une plate-forme d'où nous pourrons embrasser l'ensemble du massif. Une dizaine de sommets ferment l'horizon. Au total, on l'a déjà dit, le massif en compte trente six. De leurs pieds jusqu'à nous s'étend une plaine recouverte de végétation endogène. On distingue des chênes du désert (kurkara en langue aborigène), jeunes et adultes, qui font plutôt penser à des conifères. Cet arbre est particulièrement bien adapté aux zones arides. Jeune, il est svelte comme un peuplier et son feuillage est touffu. Il gardera cette forme tant que ses racines n'auront pas trouvé une nappe d'humidité. Celles-ci s'enfonceront dans le sol aussi loin qu'il le faudra pour que l'arbre puisse survivre. Alors, il changera de forme et s'épanouira. Ses feuilles deviendront plus rares afin de minimiser l'évaporation. Ses brindilles filiformes réduiront ses besoins. Ses racines stockeront autant d'eau que possible pour faire face aux périodes de sécheresse. Les Anangu (Aborigènes locaux) utilisent son bois dense pour différents usages, notamment la construction d'abris. Sur les dunes de sable (tali en langue aborigène), au pied des arbres, croît une herbe coriace appelée spinifex (tjanpi en langue aborigène). Ses touffes offrent un refuge à de nombreux petits animaux dont ont aperçoit les traces sur le sable: lézards, serpents et souris. Ces dernières creusent des terriers à un mètre et plus en dessous de la surface du sol. Les longues feuilles en forme d'aiguilles des spinifex servent également d'asile à des sauterelles et à des coléoptères. Les termites se nourrissent des vieilles feuilles. Elles les mâchent et les transforment en fin débris qui, retournant à la terre, lui serviront d'engrais. Les Anangu extraient de cette plante, par broyage et exposition au feu, une sorte de glu noire bitumeuse qu'ils appellent kiri. Cette poix devient extrêmement dure en séchant. Ils s'en servent pour coller des lames de pierre au bout de leurs flèches et de leurs javelots ainsi que pour renforcer le crocher du propulseur avec lequel il lancent ces derniers. D'autres plantes sont également présentes.
Leurs racines aident à stabiliser les dunes et elles fournissent
des ressources précieuses aux Anangu. Au pied des monticules, on
trouve l'hirsute herbe à miel (kaliny-kalinypa). Au printemps, les
longues fleurs jaunes et vertes de cette plante distillent un nectar sucré
que les Aborigènes sucent ou qu'ils transforment en boisson
en le diluant dans de l'eau. Près de la plate-forme croît
l'herbe à grelots (Nyintilpa) reconnaissable à ses gousses.
Les Anangu brûlent ses feuilles et mélangent les cendres avec
leur tabac à chiquer.
Du bout de la plate-forme, on aperçoit, à une trentaine de kilomètres, la masse imposante d'Ayers Rock (Uluru en langue aborigène). Avec ses 318 m de haut et ses 8 km de circonférence, ce monolithe est le plus gros du monde. Nous allons maintenant nous y rendre pour jouir du spectacle du coucher du soleil qui, en fonction des caprices du temps, des nuages et de l'heure, change les couleurs de la roche. Le rocher est situé dans un parc national
sous contrôle indigène. Bien que nous soyons au centre de
l'Australie, Ayers Rock fait partie du Territoire du Nord où la
moitié de la terre appartient aux Aborigènes. Ce ne sont
évidemment pas les territoires les plus fertiles. Aujourd'hui, sur
l'ensemble de l'Australie, entre 15 et 20% des terres ont été
rendues aux occupants primitifs de ce pays réputé vide lors
de la colonisation! A l'entrée du parc, il faut montrer patte blanche,
c'est-à-dire le billet à multiples entrées qui nous
a été remis. Le contrôle n'est pas tatillon. Il suffit
de brandir le papier. Le surveillant, qui fait sans doute confiance aux
chauffeurs des cars qu'il connaît, s'en contente sans sortir de sa
guérite.
Sur les lieux, des dizaines de tables sont alignées face au rocher. Nous ne serons pas seuls. En fait, un millier de personnes, peut-être plus, vont affluer. Notre place paraît bien choisi. Nous dégustons un verre de vin blanc pétillant, qui est agréable servi frais, en grignotant des canapés. Nous abordons le sujet des vins. D'après le guide, la viticulture australienne est en plein essor. Les surfaces cultivées ne cessent de grandir. Mais, pour un Français, la qualité du produit laisse encore à désirer. Les vins sont consommés jeunes. On ne s'embarrasse pas de l'élevage en fûts. La rentabilité avant tout. Il y a de quoi choquer un puriste! Nos compagnons basques parlent des vins espagnols (le rioja, par exemple). J'ai pu en apprécier quelques-uns au hasard de mes déplacements. Certains sont très bons, mais ont ne trouve pas une aussi grande variété de crus qu'en France. La même remarque s'applique à l'Italie dont certains vins sont excellents. La culture de la vigne se répand à travers le monde et, dans beaucoup de pays, y compris la Chine, les résultats obtenus sont encourageants. Il n'est donc pas surprenant que la part de marché des vins français se réduisent. D'autant que les nouveaux consommateurs privilégient le cépage plutôt que l'appellation, la qualité standard plutôt que les variations aléatoires induites par les changements climatiques. Pour ce qui est de la première exigence, je pense que les producteurs français pourraient rappeler sur leurs étiquette la mention du cépage. Pour ce qui est de la seconde, je ne crois pas en la vertu des vins de qualité et de saveur constante. Ces produits là ne peuvent qu'être frelatés. Les producteurs français n'ont pas intérêt, me semble-t-il, à s'orienter vers la fabrication de vins industriels. Ils ne parviendront pas à être compétitifs et détruiront leur image de marque. L'authenticité implique la savante combinaison des qualités d'un terroir avec l'ensoleillement de l'année, bonifiés par le savoir faire du vigneron et le vieillissement en fûts de chêne. La notion même de millésime est incompatible avec l'uniformité. On peut attendre celle-ci du coca cola mais pas d'un bon vin. Le nom d'un viticulteur espagnol, qui possède des vignes un peu partout à travers le monde, me vient à la bouche: celui de Miguel Torres, dont le champagne chilien est sans doute l'un des meilleurs qui se fabrique hors de France. D'ailleurs, à mon avis, le seul pays digne de rivaliser pour le moment avec le nôtre, en matière de vins, est le Chili où l'on trouve à la fois la qualité et la variété. J'explore la zone réservée aux touristes afin de repérer l'endroit le plus favorable. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, je reviens à mon point de départ. Je n'ai pas découvert de meilleur emplacement. Le crépuscule arrive. Le ciel est légèrement nuageux vers l'ouest. Le soleil disparaît par instant pour réapparaître ensuite. La progression de la nuit, les alternances d'ombre et de lumière, font passer le rocher, que j'ai vu bleuté depuis la plate forme des Monts Olga, par toutes les nuances de l'orange au violet. C'est féerique. De retour à l'hôtel, je me régale, au restaurant, d'un steak de kangourou. J'en ai déjà mangé en France et n'ai pas trouvé cette viande bien fameuse. Elle est meilleure ici. Les cuisiniers australiens savent mieux l'accommoder. Sept mai: Réveil
avant l'aube. Je plie bagages. J'ai obtenu l'autorisation de laisser mes
valises jusqu'à 11 h, au lieu de 10 h, heure à laquelle les
occupants doivent habituellement laisser leur chambre, comme c'est le cas,
semble-t-il, à peu près partout en Australie. Au retour de
l'excursion matinale, je n'aurai sans doute pas le temps de ranger mes
affaires. A la réception, je réclame le panier petit déjeuner
prévu au programme. J'absorbe son contenu: biscuits, pomme, fruits
secs, jus de fruit... en attendant le guide assis dans un fauteuil. Je
ne conserve que la bouteille d'eau qui peut toujours être utile Pour
la matinée, les mêmes conseils d'équipement que la
veille nous ont été donnés.
Nous partons alors qu'il est encore nuit. A l'entrée dans le parc, nous agitons notre billet au-dessus de notre tête. Gare à qui l'oublie! Mais le contrôle est aussi débonnaire que la veille. Nous nous rangeons le long d'une petite route, face au rocher d'Uluru, mais de l'autre côté par rapport à la veille. Des petites tables sont rapidement installées. On nous sert un café chaud avec quelques gâteaux secs. Nous attendons le lever du soleil en cherchant l'endroit le plus propice aux prises de vue. Ce n'est pas facile tant la presse est grande. Des Japonais prévoyants sont déjà installés. Ils ont amenés leurs pliants! Mais, notre attente sera vaine et les bousculades inutiles. Le ciel est nuageux à l'est. Le soleil ne se lèvera pas. A la fin de la nuit, je prends néanmoins quelques clichés (trop sombres). J'en prends trois ou quatre autres à la pointe du jour. Le rocher est violacé. Sur une de ses pentes, sculptée par l'érosion, apparaît une large tache sillonnée de méandres qui ressemble à un cerveau. Sur l'autre bord, on aperçoit une sorte de bouche. Les bouleversements géologiques ont fait basculer le rocher de 90°. C'est pourquoi les stries qui le parcourent sont horizontales. Elles ont dû être causées par de très anciens ruissellements. Il est probable que, dans des temps très éloignés, le climat du centre australien était beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. Une mer intérieure, dont ne subsiste plus que quelques étendues saumâtres, en aurait même occupé une large partie. Le continent aurait peu à peu était envahi par le désert au rythme de l'évaporation de la mer intérieure. Il est probable que le processus n'est pas achevé. Après notre déconvenue de l'aurore, nous avons le choix entre l'ascension du rocher et deux marches sur sa périphéries qui nous permettrons, en visitant des sites sacrés Anangu, de nous familiariser avec la culture aborigène. Nous choisissons la seconde option à l'unanimité. A titre d'introduction, voici les recommandations qui sont formulées à l'intention des touristes par les responsables du site: 1°)-Prendre soin de l'environnement: laisser les choses dans l'état où on les a trouvé, ne prélever ni branche, ni feuille, ni sable, ni fragment de rocher; ne rien jeter, ne pas abandonner de déchets; ne pas camper ni allumer de feu; ne pas laisser d'autres traces de son passage que l'empreinte de ses pas sur le sable; ne pas nourrir les animaux sauvages (les dingos, par exemple) et les laisser tranquilles; ne pas introduire d'animaux domestiques dans le parc; laisser tous types d'armes à l'extérieur du parc. 2°)-Respecter la culture et les traditions aborigènes: seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans les sites sacrés; l'enregistrement des sites sacrés, quel que soit le moyen: photo, vidéo, dessin... est interdit; pour les Aborigènes, ces sites ne sauraient se concevoir détachés de leur environnement; un cliché, nécessairement limité, constitue donc une trahison. 3°)-Respecter la signalisation des chemins et aires de stationnement: l'ascension du rocher est déconseillée par les Aborigènes; s'agissant d'un lieu de leur culte utilisé pour les cérémonies, ils y voient une sorte de sacrilège; toutefois, elle n'est pas interdite, sauf lorsque les conditions météorologiques la rendent périlleuse; on doit alors s'abstenir; ne pas s'écarter des chemins balisés et ouverts au public; ne pas se livrer à des activités sportives comme le parapente ou le saut en parachute. Bien entendu, toute activité à caractère commercial, y compris le tournage de films et la prise de photographies, est prohibée à l'intérieur du parc, sauf obtention d'un permis spécial délivré par les autorités, et les touristes sont invités à obéir aux consignes qui pourraient leur être données par les rangers. Voici maintenant quelques informations touchant à la culture aborigène telles qu'elles ressortent d'un document émanant des autorités du parc. "Cette contrée appartient aux Anangu depuis des temps immémoriaux. Notre peuple survit encore aujourd'hui parce que sa terre traditionnelle lui confère force et vigueur. Nous tenons la signification du site d'Uluru, dans tous ses détails, des enseignements de nos pères, de nos mères, de nos grand-mères et de nos grand-pères. Nous transmettons cette connaissance à nos enfants et à nos petits-enfants. Les Anangu célébreront et respecteront toujours l'identité spirituelle que donne Uluru. La culture anangu est basée sur les relations entre les hommes, les plantes, les animaux et les caractéristiques physiques de la terre où nous vivons. La connaissance de la façon dont se sont formées ces relations, ce qu'elles signifient et comment nous devons les maintenir, tout cela est expliqué par notre religion. Notre héritage religieux constitue le Tjukurpa, c'est-à-dire la loi traditionnelle qui explique l'existence et guide tous les êtres pendant chaque jour de leur vie. Comme les autres religions à travers le monde, la nôtre apporte des réponses à d'importantes questions. Comment le monde et la vie ont-ils été créés et par qui? Comment les gens peuvent-ils s'intégrer harmonieusement dans le processus global du vivant? Quelles sont les lois qui régissent la nature et les choses vivantes? Le Tjukurpa est le fondement de la culture anangu. De lui découlent les règles de comportement et de vie en société. Il constitue la loi qui régit les échanges entre les hommes et leur rapport avec la terre qui soutient leur existence. Il concerne à la fois le passé, le présent et le futur. Il n'est pas un rêve mais la réalité. Le paysage qui nous entoure nous montre comment la connaissance et la sagesse vinrent à nos ancêtres. La terre fut formée au début du Tjukurpa, lorsque les êtres ancestraux créèrent les différents éléments du paysage et toutes les créatures vivantes, y compris les êtres humains. Les détails des activités des êtres ancestraux et de leurs pérégrinations nous sont enseignés depuis cette époque au moyen d'histoires, de chants, de danses et de cérémonies. Quand un Anangu regarde la terre, les plaines, les montagnes et tout le vivant, il ressent qu'à l'évidence les êtres ancestraux sont toujours vivants. Uluru et les différents éléments qui le composent continuent à nous parler du Tjukurpa. Nous n'avons pas besoin d'édifices dédiés à notre culte. Le Tjukurpa est partout autour de nous sur notre sol. Une puissante valeur spirituelle émane de certaines activités des êtres ancestraux. En tant que gardiens traditionnels de cette terre, nous avons le devoir religieux de préserver les sites et les connaissances sacrés. Telle fut notre loi depuis des temps immémoriaux. Des endroits sont appropriés seulement pour les hommes, d'autres seulement pour les femmes, d'autres encore sont réservés aux personnes âgées. Plus important encore, le Tjukurpa définit ce qui peut être partagé avec des étrangers et ce qui doit leur être caché." Nous commençons notre visite par la marche du Mutitjulu. Notre car nous dépose à proximité du rocher, devant l'entrée d'un cirque peu profond. Alentour, une maigre végétation surmontée de quelques arbustes tapisse la plaine. Des arbres plus grands sont morts et dressent vers le ciel des branches grises comme des ossements en un geste de muette supplication. La sécheresse à fait sont oeuvre. Sur la gauche le rocher, largement entaillé, montre deux lèvres entrouvertes. Nous avançons en direction d'un amas de rochers éboulés entassés les uns sur les autres. A cet endroit se déroula un combat homérique entre deux êtres ancestraux: Kuniya et Liru. Kuniya était un python et Liru un serpent venimeux. Tout d'abord, ils fréquentaient ensemble paisiblement le point d'eau situé au fond de la gorge. La trace du passage de Kuniya est visible sur la falaise. Un jour, Liru rompit le pacte et attaqua Kuniya. Ce dernier battit en retraite. La femelle Kuniya, indignée de l'injure que Liru venait d'infliger à sa maison, devint furieuse. Elle releva le défi et attaqua rageusement Liru. Le combat fut titanesque et se termina par un désastre. Alors, la femelle exécuta une danse rituelle destinée à montrer sa puissance et son désir de vengeance. Elle s'efforça ensuite de maîtriser les forces obscures qu'elle venait de déchaîner en jetant à terre une poignée de sable. Mais sa rage était trop forte. La bataille reprit avec violence. Des morceaux de rochers furent arrachés à la montagne. Ils constituent maintenant l'éboulis de l'entrée. La vindicative femelle lança avec force un javelot dans la direction de son adversaire. Ce dernier réussit à l'écarter avec son bouclier et ne fut que légèrement blessé. Une faille de la falaise rappelle cette blessure. Un second dard perça le bouclier et Liru, grièvement atteint, s'effondra pour mourir. Une seconde faille, plus importante que la première, marque l'emplacement du coup fatal. Liru laissa tomber son bouclier qui glissa au bas de la falaise. Ce bouclier est une sorte de roue de pierre pleine, traversée à sa base par le trou rond du javelot. L'honneur de Kuniya était vengé. Mais le sang du serpent venimeux avait empoisonné toutes les herbes alentours. Ces plantes sont aujourd'hui des buissons épineux particulièrement toxiques: les Urtjanpa, en langue aborigène. Cette légende rappelle probablement une querelle meurtrière qui éclata entre deux tribus, dont les serpents pourraient être les totems, pour la possession du point d'eau. Dans un environnement aussi sec, où les pluies sont rares, les points d'eau jouaient évidemment un rôle vital pour la survie d'une tribu. Lorsqu'un point d'eau s'asséchait, après une longue période de sécheresse, la tribu devait se déplacer vers un autre point d'eau situé dans une région où il aurait pu pleuvoir plus récemment. Ce second point d'eau pouvait être très éloigné du précédent. Le trajet exigeait de nombreux jours de marche à travers le vaste territoire de la tribu. Sa recherche n'était évidemment pas entreprise à la légère. Elle reposait sur les enseignements des ancêtres qui avaient probablement dû surmonter le même problème. La solution se trouvait dans les récits mémorisés par la traditions. Ces derniers n'étaient pas seulement les éléments d'une sorte de catéchisme religieux. Il retraçaient aussi l'histoire du peuple aborigène. Ils narraient les péripéties de ses déplacements et comportaient par conséquent des éléments de géographie. Bref, ils renfermaient tout ce qu'il fallait savoir pour tirer le meilleur parti possible d'une nature bien peu généreuse mais que les Aborigènes vénéraient parce que d'elle venait leur salut. Ils survivaient là où des blancs mourraient de soif en quelques heures. Si l'eau venait à leur manquer, ils savaient en tirer de la sève des arbres ou en extraire des grenouilles. Les clans se retrouvaient autour des points d'eau. Des engagements solennels y étaient pris. Les mariages n'étaient évidemment pas libres. Il étaient régis par des coutumes strictes. Les parents décidaient pour leur progéniture. Lors des rencontres autour d'un point d'eau, des promesses de mariage étaient échangées concernant les enfants en bas âge. Une fois le précieux liquide épuisé, on se séparait avec l'espoir de se retrouver dix à douze ans plus tard, autour du même puits, pour concrétiser l'union des deux enfants devenus adultes. Bien sûr, des querelles pouvaient également éclater lors de ces rencontres. De part et d'autre du bouclier de Liru, des grottes s'ouvrent dans le rocher. Elles sont ornées de peintures aborigènes. Le but de ces dernières est plus utilitaire qu'artistique. Elles sont tissées de symboles et racontent une histoire, fournissent des renseignements. Nous n'y voyons que des gribouillages d'ocre, d'argile et de charbon de bois. Mais les Aborigènes savaient parfaitement les interpréter et les utiliser. A chaque passage, ils les complétaient de nouveaux ajouts de sorte que les traces qui subsistent sont un amoncellement de couches dont les plus anciennes remontent à des milliers d'années. La cirque se termine brusquement en cul-de-sac. Une cascade à sec dévale du haut de la colline qu'elle a creusée pour venir mourir dans une cuvette totalement vide. Sur le bord de ce bassin privé d'eau, une pancarte précise que le point d'eau est la demeure de Wanampi, un serpent d'eau ancestral respecté par les Anangu car il a le pouvoir de contrôler le débit de la source. Au bas de la pancarte, on peut lire cette phrase non dépourvu d'humour noir: "S'il vous plaît, n'allez pas nager dans l'eau et ne la troublez pas". Le point d'eau de Mutitjulu était le plus important d'Uluru. C'était aussi un piège naturel qu'utilisaient les chasseurs aborigènes. Beaucoup d'animaux venaient s'y désaltérer et il était facile de les y prendre. En outre, de nombreuses plantes à graines et à fruits comestibles croissaient alentour. Bien que la source soit aujourd'hui totalement asséchée, le peu d'humidité qui subsiste sur ses bords continue d'attirer des oiseaux. Certains nichent dans les trous que l'érosion a creusé dans la falaise, comme autant de poches, sur la droite du point d'eau. La légende d'un autre être ancestral
est attachée à ces lieux. C'est celle du lézard à
langue bleue Lungkata. Ce dernier rencontra un ému blessé
par des chasseurs et s'en empara. Il mentit à ces derniers lorsqu'ils
lui demandèrent s'il n'avait pas vu l'émeu. Mais ceux-ci
ne furent pas dupe et se lancèrent à la poursuite du voleur
qui, pour leur échapper, fut contraint de jeter un à un les
morceaux de l'ému cuit pour alléger sa besace. Des rochers
représentent les morceaux d'émeu. Lungkata disparut au coin
du rocher vers l'ouest. Mais les chasseurs finirent par l'attraper et lui
firent chèrement payer son larcin.
Ces différentes légendes sont révélatrices de la manière dont les Aborigènes utilisaient les accidents du terrain comme supports de leurs récits et comment ils y associaient des informations de diverses natures: historiques (la lutte entre deux tribus), géographiques (la présence du point d'eau, antre du serpent Wanampi), économiques (les ressources qui se trouvent alentour), botaniques (les plantes toxiques), morales (le mensonge et le vol sont punis). Nul doute que lorsqu'ils se remémoraient la lutte entre Kuniya et Liru, les Aborigènes évoquaient immédiatement Mutitjulu et ses ressources et que c'était pour eux un moyen de ne pas les oublier et de les retrouver lorsque ce serait nécessaire. La civilisation aborigène n'a pas dépassé le stade de la pierre taillée. A part le dingo, elle n'a pas domestiqué d'animaux. Elle ne connaissait pas l'agriculture et se contentait de la chasse, de la pêche et de la cueillette. La chasse était l'apanage des hommes qui rapportaient au camp des kangourous, des koalas, des wombats, des lézards, des poissons et des tortues. Les femmes, armées d'un bâton, le nolla-nolla, creusaient le sol à la recherche de racines, de tubercules, de larves, d'oeufs, de rongeurs et d'insectes. Elles cueillaient les fruits, les feuilles comestibles, les graminées dont elles vannaient les grains dans un plat d'écorce avant de les écraser entre deux pierres. Un contrôle des naissances rigoureux (par abstinence, mortalité infantile voire infanticide, si nécessaire) maintenait l'évolution démographique en phase avec les ressources disponibles. Les tribus nettoyaient le terrain au moyen du feu, peut-être pour dégager l'espace autour de l'endroit où elles s'établissaient temporairement et aussi parfois pour envoyer des signaux. Les cendres engraissaient le sol et l'on y repérait plus aisément les traces du passage des animaux. L'herbe nouvelle était plus tendre et attirait le gibier. Mais les incendies de la steppe australienne ont peut-être aussi contribué à précipiter la désertification de la grande île. Les Aborigènes vivaient dans une société égalitaire, sans hiérarchie, au sein de laquelle se pratiquait une sorte de communisme primitif. La propriété y était inconnue. Partie de la nature, les Aborigènes n'admettaient pas la possibilité d'en revendiquer la possession. A l'arrivée des premiers colons blancs, ils partagèrent volontiers leurs maigres ressources avec ces nouveaux venus. Tout n'est-il pas à tout le monde selon le Tjukurpa? Quant les colons commencèrent à ouvrir des stations d'élevage de moutons, ils se réjouirent. Voilà que leurs nouveaux voisins leur amenaient de la viande! Ils chassèrent les animaux domestiques comme des bêtes sauvages et ne comprirent pas que les blancs le leur imputent à crime. Ces derniers se fâchèrent et repoussèrent à coups de fusil les incursions des indigènes. De nombreux massacres furent perpétrés. Le moindre prétexte fut saisi pour entreprendre des expéditions punitives. Des tribus qui n'avaient pas commis le moindre méfait furent exterminées sans pitié. Les tueurs n'épargnaient ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Chassés de leurs terres, les Aborigènes, si solidaires d'elle, perdirent racines et repères. Les survivants, minés par le désespoir, étaient condamnés à une lente déchéance. On peut dire qu'ils furent victimes, comme les Indiens, d'un véritable génocide. D'après le guide, les Aborigènes seraient venus du sous continent indien, en passant d'île en île, à une époque où la séparation entre les terres n'étaient pas encore aussi affirmée qu'aujourd'hui. Il y aurait eu deux vagues d'immigration. La plus ancienne aurait totalement disparu et il ne resterait plus que des représentants de la seconde vague. Les Aborigènes d’Australie n’ont pas de groupe sanguin B et A2 et ils pourraient avoir des affinités avec les peuples d’Océanie, de Papouasie Nouvelle Guinée, les Négritos des Philippines, de Malaisie et de Bornéo, les Murrayiens parents des Aïnous du Japon, les Aborigènes du sud de l’Inde ou les peuples Vedda du Sri Lanka. Les environs de Mutitjulu furent le théâtre d'un fait divers qui défraya la chronique australienne pendant une vingtaine d'années à partir du début de la décennie quatre vingt. Je veux parler de l'affaire Chamberlain ou "Dingo Baby". Une jeune mère, Alice Lynne Chamberlain, et sa fille Azaria, âgée de neuf semaines, de passage dans les environs d'Uluru, furent attaquées par un dingo sauvage. L'animal emporta l'enfant que l'on ne retrouva pas. La femme raconta l'histoire comme elle s'était déroulée. Elle ne fut pas crue. Suspectée d'avoir volontairement fait disparaître son enfant, elle fut jugée. Son mari fut reconnu coupable de complicité. L'un et l'autre furent condamnés sans preuve tangible, sans motif vraisemblable et sans aveux. Plus tard, un homme avoua que, étant en train de chasser près d'Uluru avec des camarades, ils étaient tombé sur la tanière d'un dingo qu'ils avaient tué. Ils y avaient trouvé les restes d'un bébé. Comme ils avaient déjà fait de la prison, que la détention d'une arme leur était interdite et qu'ils chassaient au mépris des lois, ils décidèrent de garder secrète leur découverte de peur qu'on ne les accuse du meurtre de la fillette. Ils emportèrent donc les restes de l'enfant et les ensevelirent à l'écart. Les autorités australiennes gracièrent les époux Chamberlain et leur accordèrent un dédommagement de plus d'un million de dollar. Cette affaire, mentionnées parmi les erreurs judiciaires célèbres, a inspiré le scénariste d'un film à succès (Un cri dans la nuit). La seconde marche va nous conduire sur les sites cérémoniels de Mala, le lièvre-wallaby, le long de la face nord du rocher. Il y a très longtemps, les Mala, hommes, femmes et enfants devaient accomplir un long trajet, depuis l'ouest et le nord, pour rejoindre Uluru. Une fois arrivés sur place, ils se subdivisaient en groupes de jeunes hommes, de vieillards, de femmes célibataires et enfin de femmes mariées. La cérémonie religieuse qu'ils allaient accomplir, l'Inma, exigeait ces préparatifs. Quelques hommes, venus de l'ouest, portaient le bâton de cérémonie: Ngaltawata. Ils grimpaient rapidement au sommet d'Uluru pour y planter le bâton au coin septentrional du rocher. Alors, la cérémonie pouvait commencer et, pendant toute sa durée, le moindre événement de la vie des Mala s'intégrait à leur culte. Tous les travaux, tels que chasser, cueillir les fruits et les plantes, préparer les repas, puiser l'eau.. et même parler aux gens ou juste attendre, tout était accompli dans le strict respect d'un rite immuable. Telle était la loi qui s'imposait aux hommes, aux femmes et aux enfant depuis toujours. Les Mala étaient heureux et affairés. Les femmes et les enfants cueillaient les fruits nécessaires à la préparation du festin: ceux du figuier sauvage (ili) et du prunier du bush (Arnguli). D'autres femmes écrasaient les graines des graminées précédemment cueillies entre deux pierres. Des hommes jouaient de la musique en frappant l'un sur l'autre deux boomerangs. Des jeunes gens attendaient leur initiation dans une grotte où leurs mères leur apportaient de la nourriture. Ils se désaltéraient avec l'eau d'une source qui suintait au bout de leur abri. C'est alors que des Aborigènes de l'ouest apportèrent aux Mala une invitation à se joindre à une autre Inma. Les Mala furent obligés de refuser puisque leur propre Inma avait commencé. Les gens de l'ouest retournèrent chez eux, dépités et furieux du refus qu'ils venaient d'essuyer. Ils ruminaient une vengeance terrible contre les Mala. A travers la steppe on vit alors se déplacer, comme un ouragan, une créature démoniaque qui ressemblait à un chien noir: Kurpany. Était-ce un diable de Tasmanie? C'était la vengeance imaginée par le peuple de l'ouest, une vengeance terrible destinée à perturber la cérémonie des Mala et à les détruire. Les cris poussés par Luunpa, le martin-pêcheur, pour prévenir les Mala, n'attirèrent pas leur attention. Kurpany attaqua brutalement la tribu, tuant hommes, femmes et enfants. Terrorisée, les rescapés s'enfuirent vers le sud, poursuivis par Kurpany. Telle est l'histoire tragique du peuple des
Mala. Nous allons mettre nos pas dans les leurs en tachant de pénétrer
les arcanes compliquées de leur culture. Pour ne pas avoir à
revenir en arrière, nous suivons le circuit à l'envers du
sens préconisé dans les guides. Nous sommes auprès
de sites hautement sacrés, particulièrement respectés
par les Anangu, qui évitent de trop les fréquenter et ne
les abordent qu'en silence. Les photographies sont évidemment prohibées.
Des panneaux rappellent cette interdiction, ainsi que l'amende qui frappe
les contrevenants surpris par un ranger; la note salée: 5500
dollars! La menace n'empêche pas quelques touristes japonais et anglo-saxons
de tricher. Pour ma part, je m'abstiendrai, plus par respect que par crainte.
Une vue d'ensemble permet d'admirer le travail accompli par l'érosion.
On imagine combien doit être vivante cette façade du monolithe
lorsque tombent les trop rares pluies et que l'eau dévale la pente
en cascades, de vasque en vasque.
Kantju est le point d'eau principal des Mala. La vie de la faune et de la flore qui l'entoure en dépendait. Il est présentement à sec. Autour sont rassemblés plusieurs endroits de haute signification spirituelle pour les Aborigènes et il est conseillé de les visiter avec respect et sans éclats de voix. Le Malaku Wilytja est un endroit où les Aborigènes aimaient s'asseoir pour se reposer. Les abris dressés par les femmes et les enfants se trouvaient à proximité. A l'intérieur de la cavité on peut encore remarquer les traces laissées sur la paroi par les enfants. Les grottes étaient des lieux de réunions. Les anciens y enseignaient le Tjukurpa. Les leçons étaient adaptées à l'âge de l'auditoire. Les mêmes histoires étaient racontées à tous. Mais, suivant le degré de compréhension des élèves, elles étaient plus ou moins complètes. Les détails laissés de côté pour les enfants, étaient racontés aux jeunes gens en reprenant la même histoire. D'autres détails encore s'ajoutaient lorsque venait le tour des adultes. Ainsi, progressivement, les Aborigènes mémorisaient l'ensemble des connaissances de leurs ancêtres. Cet enseignement se déroulait sous le regard de ces derniers, symbolisés par les déformations des parois de la grotte qui évoquent plus ou moins des êtres fantastiques. Les auditeurs, soumis à cette surveillance inquisitoriale, avaient tout intérêt à écouter attentivement la leçon, sous peine de s'attirer les foudres d'êtres toujours présents, tout puissants et prompts à punir les déviants. Un peu plus loin, dans une autre grotte, plus basse, on aperçoit les trous ronds où les Mala stockaient les provisions pour leurs cérémonies. Au passage auprès d'un bouquet d'arbres, notre guide nous fait remarquer comment ceux-ci s'y prennent pour économiser l'eau. En période de sécheresse, ils sacrifient tout simplement une de leurs branches qui, cessant d'être irriguée, se dessèche et meurt. Si la sécheresse persiste, une autre branche est condamnée, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'arbre y passe si le mal est irrémédiable. Mais il sera resté debout le plus longtemps possible. Nous passons ensuite devant Mala Puta, une
grotte à forme triangulaire située en hauteur, où
s'affairaient les femmes, on l'a dit, à l'écart des hommes.
Puis nous longeons la grotte où les jeunes gens se préparaient
à la cérémonie d'initiation. Le site suivant est orné
de peintures rupestres. Enfin, nous nous trouvons devant un énorme
bloc de pierre perforé d'un trou qui recouvre une cavité.
C'est Itjaritjariku Yuu, le terrier de la taupe
marsupiale. Cet ancêtre vécut toujours à Uluru, en
bonne harmonie avec les Mala. On le considérait comme une vieille
femme toujours occupée à creuser des tunnels. A proximité,
s'étale l'aire où les femmes et les enfants cueillaient les
fruits et les herbes. Les repas étaient préparés à
cet endroit de la falaise.
Nous voici au pied du sentier escarpé qui conduit au sommet du rocher et à proximité du parking où nous attend notre chauffeur. Vus d'en bas, les touristes, qui gravissent la pente du monolithe, ressemblent à des insectes. Les Anangu, qui préféreraient les voir rester en bas, qualifient de fourmis, non sans une pointe de mépris, les profanes qui se hasardent à escalader ce lieu sacré hautement symbolique. Il est vrai que sacrifier les deux marches que nous venons d'accomplir, au profit de l'ascension, est incontestablement faire preuve de mépris à l'endroit de la culture aborigène. A l'entrée du chemin, que nous avons suivi à l'envers, une pancarte donne toutes les indications sur les sites à visiter. Une lance aborigène est appuyée contre elle. C'est un longue tige de bois terminée par une pointe de pierre collée à la glu noire tirée de l'herbe des sables. Nous terminons la matinée par une visite au centre consacré à la culture Anangu, à leur loi et à la gestion du parc. Je m'y procure une documentation intéressante qui synthétise les informations recueillies au cours de la matinée et d'autres renseignements concernant la faune et la flore dont je ferai mon profit. De retour à l'hôtel, il est presque onze heures. Je libère ma chambre, règle ma note et dépose mes bagages dans une sorte de consigne. Puis je vais manger un sandwich à la viande d'autruche en buvant une bière au bar de l'hôtel. Je n'aurai pas trop longtemps à attendre le bus qui doit nous emmener, le guide et moi, à Alice Springs. J'ai pris congé du couple espagnol qui part pour Cairns. J'y serai moi aussi avant leur retour en Europe. Mais la chance de nous y rencontrer est infime. Je n'aurai pas vu grand chose de l'agglomération qui porte le nom d'Ayers Rock Resort. Mais, à part les hôtels pour touristes, il n'y a sans doute pas grand chose à voir dans ce village perdu au milieu du désert. Le guide et moi nous prenons place dans l'autobus ATP. On ne me demande même pas mon billet! Chemin faisant, le chauffeur nous donne quelques explications que le guide me traduit. J'apprends ainsi comment fut baptisé le kangourou. La première fois qu'il vit un de ces animaux, le capitaine Cook demanda son nom à un Aborigène. Celui-ci lui répondit: "Kangaroo", ce qui, en langue locale, signifiait: "Je ne comprends pas". L'Anglais crut qu'il avait eu la réponse à sa question et le nom resta à l'animal! Nous traversons un désert rouge sur lequel se dressent quelques arbres chétifs. C'est le paysage typique du centre de l'Australie qui fait penser à une terre écorchée. Bientôt, apparaît sur la droite, à l'horizon, un monolithe au sommet plat, ce qui lui donne l'apparence d'une table. En réalité, d'après le chauffeur, il n'est pas aussi plat qu'il y paraît. Je n'irai pas y voir! C'est le mont Conner. Il est situé sur les terres d'un propriétaire qui aurait organisé un mariage sur son sommet. Un arrêt intentionnel va nous permettre de le photographier à loisir. (Une carte de la route d'Ayers Rock à Alice Springs est ici ). Nous changeons d'autocar à l'embranchement
de la route de Kings Canyon. Une partie des voyageurs se rend là.
Ils poursuivent leur chemin dans la même voiture. On nous transborde
avec nos bagages dans un autre véhicule.
Nouvel arrêt pour se rafraîchir à une auberge. Des émeus se promènent derrière des grilles. J'aperçois une tourterelle huppée. Des corbeaux traversent le ciel. Nous repartons. Au fur et à mesure que nous nous approchons d'Alice Springs, la végétation est de plus en plus chétive, les arbustes de plus en plus rabougris. Un brusque coup de frein nous fait sursauter. Une famille de kangourous traverse la route devant le capot de notre car. L'accident a été évité de justesse. Les Kangourous n'ont pas une bonne vision. Ils traversent les voies sans trop se préoccuper de ce qui arrive. Il n'est pas toujours facile de les éviter. Nous aurons l'occasion de voir plusieurs de ces animaux, de diverses tailles, étendus morts sur les bas côtés de la route, pour le plus grand plaisir des corbeaux et autres charognards. A gauche un groupe de dromadaires sauvages déambulent entre les buissons à la recherche de leur maigre pitance. Introduits dès 1840 et destinés à servir de bêtes de bât, ces animaux originaires de l'empire des Indes furent abandonnés vers 1920, par suite du développement de l'automobile. Ils seraient maintenant près de 200000 à errer dans le désert. Quelques arbres secs, totalement dépourvus de feuilles, apparaissent au sommet du talus qui borde la route sur la droite. Sur la gauche, au lointain moutonnent des mamelons, probablement les contreforts des monts Mac Donnell proches d'Alice Springs. Le guide me parle de l'état des voies
et des gigantesques transports routiers qui transportent les marchandises
entre les points éloignés de cet immense pays. Certains camions
et leurs remorques peuvent comporter plus de 30 paires de roues et il voyagent
parfois en convois qui forment de véritables trains. Nous avons
eu la chance d'emprunter des voies asphaltées. Mais toutes ne le
sont pas. Sur les pistes, un voyage est beaucoup plus pénible. Le
passage des lourds camions trépidants les transforme en véritables
tôles ondulées.
Nous arrivons en fin de journée à Alice Springs. Le guide me parle du train qui relie le sud au nord du pays (Adélaïde à Darwin, si ma mémoire est bonne). Il me montre des groupes d'Aborigènes assemblés sous les gommiers (eucalyptus) dans le lit à sec de la rivière Todd. Le guide ne m'accompagnera pas jusqu'à mon hôtel. Sa voiture est garée dans un parking que le bus atteindra avant. Il me propose de me rejoindre à la réception. Je décline son offre et l'engage à rentrer directement chez lui. Je me débrouillerai bien tout seul. Je ne risque pas de me tromper puisque mon hôtel est au dernier arrêt. J'aperçois de jolis perroquets gris et roses perchés sur un fil: des galahs. A l'hôtel Aurora, pas de problème à la réception. En revanche, je ferraille en vain avec la serrure de la porte de ma chambre. Je possède deux clés. Aucune ne paraît convenir! Je dois recourir à l'aide du bagagiste qui passe opportunément par là. Tout était trop simple: il y a deux portes, seule la seconde est fermée à clé, la première s'ouvre en tirant dessus! Une fois installé, je redescends en direction de la réception pour aller dîner. La réceptionniste me donne un ticket de réduction et m'indique le chemin du restaurant, le Red Ochre Grill. Il faut traverser un garage obscur pour l'atteindre. M'y voici. Une charmante serveuse m'installe et m'apporte la carte. Je commande d'abord un vin blanc pétillant, pour l'apéritif. Je choisis ensuite une entrée dont je ne me souviens plus, puis du chameau (selon la carte, mais j'imagine qu'il s'agit de dromadaire puisque les camélidés australiens semblent pourvus d'une seule bosse) comme plat de résistance, avec un verre de vin rouge. J'attends une bonne demi heure sans rien voir venir. J'ai le temps de me distraire au spectacle rafraîchissant des sources cascadant sur les pentes d'Uluru. Les murs du restaurant sont illustrées de photos des sites d'Australie centrale saisies à un moment opportun ou trafiquées par un habile faussaire. Un nouveau serveur se présente. Je lui dis que j'ai déjà commandé un verre de pétillant qui ne m'a pas été servi. Il me répond qu'il va s'en occuper et prend le reste de ma commande. De fait, il m'apporte rapidement mon apéritif. Mais je l'ai à peine achevé que la première serveuse m'en apporte un second que je renvoie. Une autre serveuse arrive avec le vin rouge, l'entrée, puis le chameau. Cette viande est servie avec une sorte de ratatouille. L'ensemble ne serait pas mauvais s'il ne baignait pas dans une sauce qui ne me revient qu'à moitié. La première serveuse me débarrasse et me pose une question que je ne comprends pas. A tout hasard, je lui réponds oui. Elle me sert derechef un troisième verre de pétillant que je renvoie comme le deuxième. Nouvelle attente pour régler ma note. On me l'apporte enfin. Elle comporte naturellement les trois verres de pétillant, saisis sur ordinateur, alors que je n'en ai bu qu'un. Je réclame auprès de la serveuse. Elle retourne auprès du caissier et revient. On m'en compte encore deux. Nouvelle réclamation. Nouvelle discussion avec le caissier suivie d'une dernière rectification. Cette fois, je consens à payer. Je n'ai pas eu droit à la réduction, le service, peu diligent, ayant laissé passer l'heure limite de la prise de commande au delà de laquelle on n'en bénéficie plus. Je ne déposerai pas de réclamation. Je passerai une excellente nuit de repos. La viande de chameau est plus digeste qu'on ne le pense! Huit mai: Petit déjeuner matinal au restaurant de l'hôtel. Abondance de fruits, comme d'habitude. La matinée est consacrée à une rencontre avec les Aborigènes. On l'a déjà dit, ces derniers représentent une proportion élevée de la population du Territoire du Nord, à peu près le quart. C'est la plus forte concentration en Australie. Ils possèdent la moitié des terres. Ils demeurent très attachés à leurs traditions. Chaque tribu possède sa langue, sa création ancestrale, ses lieux sacrés, ses cérémonies, ses symboles et sa loi. Plus de 40 langues aborigènes sont parlées à travers l'Australie et ces langues diffèrent autant entre elles que celles de l'Europe. Il y a les Aborigènes du désert, ceux du littoral, ceux des rochers et ceux des îles. Les contraintes environnementales auxquelles ils ont dû faire face ont évidemment influencé leur comportement. A proximité d'une eau abondante, les tribus se sédentarisent naturellement. Dans le désert, elles sont condamnées au nomadisme, de point d'eau en point d'eau, pour survivre. La plupart des Aborigènes vivent aujourd'hui en ville. Ils n'empêchent qu'ils continuent de se référer au territoire de leur tribu en l'appelant leur terre. Ils respectent autant que possible les responsabilités mutuelles et les valeurs communes venues jusqu'à eux par le truchement des anciens. Ces liens ont été maintenus à travers les générations grâce aux échanges effectués au long des chemins et par les rencontres autour des sites sacrés. Nous allons nous intégrer à un groupe conduit par un guide aborigène anglophone. Le guide francophone, qui m'a rejoint à la réception de l'hôtel, me servira d'interprète. Nous attendons le véhicule qui doit nous prendre en bavardant sur le pas de la porte. Les voilà. Nous embarquons. Le guide aborigène doit être un métis. On le devine à la couleur de sa peau. Il porte un sac tyrolien d'où dépasse la tête d'un mignon petit kangourou dont la mère a été écrasée par une automobile. Le guide aborigène élève l'animal jusqu'à ce qu'il soit capable de rejoindre ses congénères dans la nature. Nous nous dirigeons vers les installations du télégraphe construit dans les environs d'Alice Springs en 1872. Cet appareil, qui reliait Darwin et Adélaïde au reste du monde, resta en service jusqu'en 1932. Il est à l'origine de la création d'Alice Springs, qui s'appela Stuart jusqu'en 1933. Il n'est plus aujourd'hui qu'un musée autour duquel se réunissent les Aborigènes locaux. A l'entrée du musée, nous descendons de voiture. Au cours d'une assez longue présentation, le guide nous donne sa version de la colonisation et de la façon parfois barbare dont furent traités ses compatriotes. A l'origine, les colons niaient jusqu'à l'existence des Aborigènes. L'Australie était réputée vide et ouverte à toute espèce d'exploitation. La conquête du territoire par les éleveurs entraîna les massacres auxquels nous avons déjà fait allusion. Au cours du 19ème siècle, des centaines de milliers d'Aborigènes périrent. Ils résistèrent, mais avec des moyens dérisoires par rapport à ceux de leurs adversaires. Ceux-ci les utilisèrent même parfois les uns contre les autres, comme ils l'avaient fait plus tôt pour donner la chasse aux convicts. Vers 1930, on estime qu'à peine 10% de la population aborigène avait survécue. Alors, dans l'opinion publique blanche, commença à apparaître le sentiment de l'injustice qui avait été commise. Mais il fallut attendre 1967 pour qu'un référendum confère aux anciens habitants du pays le titre de citoyen australien. Déjà, bien avant cette date, des efforts avaient été entrepris pour faciliter l'intégration des Aborigènes dans un univers où ils n'avaient pas vraiment leur place. Ces efforts prirent parfois une forme contestable. Des enfants furent enlevés à leur famille pour être élevés dans les institutions des blancs. Les Aborigènes parlent de la génération volée. Le guide quitta très jeune ses parents pour ne les revoir qu'une fois adulte, quinze ans plus tard. Il retrouva une tribu où personne ne le connaissait plus et où il ne connaissait plus personne. Il fit néanmoins l'effort de se réinsérer et travaille maintenant à la préservation de la culture de ses ancêtres. (Voir la page sur l'histoire de l'Australie ici ). Les Aborigènes sont aujourd'hui plus de 400000 et leur nombre continue de croître, malgré une forte mortalité infantile, grâce à un taux de fécondité élevé. En dépit des améliorations apportées à leur sort, ils continuent d'être des citoyens de second rang. Leur espérance de vie est inférieure à la moyenne. Leur taux de chômage est 7 fois plus élevé que celui des blancs et ils fournissent un pourcentage disproportionné de la population carcérale. Ils ont malgré tout leur mot à dire. Le capital d'une station de radio et de télévision, mitoyenne de l'hôtel Aurora où je suis descendu (Impaja Television), appartient intégralement à des actionnaires aborigènes. On l'a vu, les Aborigènes parlent plus de quarante langues. Partant, on peut se demander comment ils parviennent à se comprendre. Le guide nous donne la clé de ce mystère. Chaque Aborigène comprend trois ou quatre idiomes, ceux des tribus voisines de la sienne. Ainsi, de proche en proche, les informations peuvent circuler à travers le pays. A titre d'exemple, émeu se dit ankerre (prononcer un-kurr-a) en langue arrernte, kangourou rouge se dit aherre (prononcer harra) alors qu'ils se disent respectivement kalaya et malu en langue anangu. La ville d'Alice Springs est construite sur le territoire des Arrernte. Nous pénétrons à l'intérieur
de la Telegraph Station Historical Reserve. Des
rapaces veillent sur la plus haute branche morte d'un eucalyptus. Les bâtiments
de l'ancien télégraphe paraissent bien entretenus derrière
leur lourd enclos de bois. Mais ils n'offrent rien de bien remarquable.
Le guide nous emmène auprès d'un arbuste vert qui porte à
la fois des fleurs et des fruits. Ces derniers sont les fruits de la passion
aborigène. Le guide en cueille un. Il l'ouvre. Une chair orange
constellée de multiples graines foncées apparaît. Il
nous la fait goûter en nous invitant à ne pas croquer les
graines qui sont aussi fortes que du poivre. La saveur rappelle effectivement
celle du fruit de la passion. Ne craignant pas
les aliments pimentés, je ne tiens nul compte de la recommandations
et j'écrase un grain. Le goût du poivre est bien reconnaissable,
mais il n'est pas si fort que cela, au moins pour moi.
Nous nous dirigeons vers un autre arbuste, une variété d'acacia, au pied duquel creusent les femmes pour trouver les larves dont les Aborigènes sont si friands. Elles ne fouillent pas n'importe où. Un simple examen du tronc leur permet de déceler la présence ou non des précieuses larves dans le berceau des racines. Autour, s'étale un paysage australien typique: herbe rase et sèche, eucalyptus, cactus, empilement de rochers... Le guide nous montre comment dessiner sur le sable la trace d'un kangourou, puis efface de la main cette peinture aborigène fugace. Notre attention est alors attiré par une scène tragico-burlesque. La sécheresse sévit et nombre d'animaux meurent faute de nourriture et d'eau. Le cadavre d'un kangourou gît à quelques distances. Un corbeau s'en régalait jusqu'au moment où, trouvant cette chair légèrement putréfiée de moins en moins appétissante, il s'en prit à un kangourou vivant et commença à lui donner des coups de becs. L'herbivore placide ne trouva pas cet engouement précoce aussi plaisant que le corbeau le supposait peut-être. Faute de pouvoir boxer l'impertinent, bien trop petit pour recevoir des gifles, il le chassa à grand coups de museau. L'oiseau revint plusieurs fois à la charge avant de se décourager et de retourner à ses agapes faisandées. Une petite marche nous amène face à une large prairie sacrée recouverte d'herbe grise qui est un lieu de cérémonies. En revenant, nous remarquons les nombreux débris de verre laissés ça et là par les employés du télégraphe. Ils devaient être de sacrés buveurs de bière. Sous les rayons du soleil, ces éclats luisent comme autant de miroirs transformant les pentes alentour en la réplique terrestre d'un ciel étoilé. L'heure est venue de nous rendre au centre
aborigène où nous devons assister à un spectacle de
danses. A l'entrée, le guide attire notre attention sur une fourmi
à miel qui déambule imprudemment sur le ciment. Son abdomen,
démesurément gonflé, est rempli d'un épais
liquide sucré que les Aborigènes recueille pour leur consommation.
Un panneau de céramique nous souhaite la bienvenue en langue aborigène.
Un café nous est servi au bar installé près de la piste couverte où se déroulera le spectacle. Les artistes arrivent. Ils sont trois. L'un a la couleur de la peau et la morphologie d'un blanc. Je doute de son authenticité. C'est probablement un sang mêlé. Mais cela ne l'empêche nullement d'appartenir à la tribu, s'il en respecte les règles. Nous prenons place sur des chaises. On nous explique la fabrication de l'instrument fétiche que les blancs ont affublé du nom de didgeridoo, ce long et fort tube de bois que l'on utilise comme une sorte de trompe et dont j'ai oublié le nom aborigène. On choisit une branche déjà intérieurement rongée par les termites. On la coupe. Si l'intérieur n'est pas assez rongé, on la plante sur une termitière. On assure le finissage avec des charbons de bois ardents. Ensuite, on durcit l'embouchure au moyen d'un enduit de glu. Jouer correctement de cet instrument n'est pas aussi facile que des profanes pourraient le supposer. Une démonstration nous est faite. Le son provient des lèvres, les modulations de la langue et les effets du fond de la gorge. Utiliser ses lèvres et sa langue ne suppose pas un apprentissage extraordinaire. Mais, pour ce qui est de la gorge, c'est une autre affaire! Les essais effectués par un touriste sont peu concluants. Les autres instruments de musique sont des percussions: deux boomerangs font l'office de castagnettes. Les corps des danseurs sont ornés de dessins blancs hautement symboliques que les non initiés ne comprennent pas toujours. Sur un danseur, on reconnaît un hibou: son emblème totémique. Les danses sont évocatrices. Elles miment parfois le comportement des animaux: casoar, papillons... Elles ont probablement un caractère sacré. Le spectacle s'achève sur une photo de famille. Nous prenons congé. Le paysage alentour est superbe: rochers, arbres décharnés sur sable orange. Le guide laisse gambader un instant son protégé sur une pelouse en nous demandant de ne pas trop nous approcher car notre odeur, avec laquelle le jeune animal n'est pas habitué, pourrait l'effaroucher. Une fois écoulé le moment de liberté, il suffit au guide d'ouvrir son sac. Le kangourou s'y précipite d'un bond comme si c'était la poche ventrale de sa mère. C'est réellement touchant. Nous nous nous dirigeons ensuite vers le musée des instruments aborigènes en passant devant un abri traditionnel de branchages. Il ne devait pas protéger beaucoup ni grand monde. Devant lui, on reconnaît le cercle de pierres d'un foyer. Le guide nous présente plusieurs instruments de chasse (boomerang, javelot...) et d'usage domestique (plat, panier et van d'écorce...) en nous expliquant comment ils étaient utilisés. Tous sont taillés dans des bois plus ou moins rigides et lourds. Les parties dures sont en bitume végétal. Il nous montre comment allumer du feu en frottant deux morceaux de bois différemment tendres l'un contre l'autre. Une fumée se dégage assez rapidement et cela ne semble pas très difficile. Nous nous rendons ensuite sous une sorte de préau où des tableaux résument l'histoire et la culture aborigène. Bien sûr, seulement ce qu'il est possible d'enseigner à des étrangers. Certains mystères ne doivent pas être divulgués sous peine d'enfreindre la loi. Quoi que l'on nous dise, nous sommes donc prévenus: jamais nous ne saurons tout! Sur un premier tableau, une brève chronologie souligne que le temps écoulé depuis l'arrivée de l'homme blanc en Australie est peu de chose rapporté à la durée de l'occupation aborigène. Le début de cette dernière est estimé à 40000 ans, ce qui n'est pas exagéré selon d'autres estimations qui la font remonter à 60000, voire 100000 ans. Voici quelles sont les dates essentielles de l'histoire aborigène, et les événements qui s'y rattachent, depuis l'arrivée de l'homme blanc au 16ème siècle: en 1770, l'invasion - en 1788, la dépossession des anciens habitants - en 1872, la colonisation, - en 1940, la ségrégation, - en 1950, l'assimilation, - en 1967, le référendum de citoyenneté, en 1973, l'autodétermination, en 1993, enfin, le début de la restitution des terres de la couronne. On notera, qu'au cours de la seconde guerre mondiale, l'Australie connut, comme d'autres pays, une évolution ségrégationniste. Sur un second tableau apparaissent les fondements des croyances aborigènes ou du moins ce que l'on peut en connaître. On y distingue trois mondes: le monde physique, le monde humain et le monde sacré. Au monde physique sont rattachés le ciel (soleil, lune, étoiles), les animaux et la terre (arbres, rochers, sites et points d'eau). Au monde humain sont rattachés les cérémonies (danses, peintures, enseignement, chant, narration), la capacité de s'adapter au changement, les gens, les relations familiales (qui doit prendre soins des différents lieux), les règles de comportement (le secret, le mariage). Au monde sacré sont rattachés l'art de prévoir l'avenir, les légendes, la protection de l'environnement, la punition des méfaits. Ce dernier monde est hors du temps. Il n'a pas de commencement ni de fin. De lui découle la loi. Celle-ci se matérialise par des voies, des événements cruciaux... en relation aussi avec les cérémonies, les légendes et les responsabilités concernant l'entretien des lieux. A l'origine, les êtres ancestraux erraient à travers un monde encore informulé. On appelle cette période le temps du rêve. Mais il semble que cette formulation ait été inventée par les colonisateurs blancs et que les Aborigènes ne l'employaient pas. Pour eux, tout est réel. Les êtres ancestraux conçurent le monde tel que nous le connaissons. Ils lui donnèrent ses formes et ses lois. Ils sont toujours présents en tout et partout. Voici quelques éléments complémentaires qui montrent le degré de complexité des relations à l'intérieur de la tribu du guide tels que je les ai retenus. Les noms attribués aux garçons sont identiques. Deux frères portent le même nom. Pour les filles, il en va différemment. On applique un système d'alternance. Deux soeurs qui se suivent ne portent pas le même nom. La seconde porte un nom différent de celui de la première. Mais la troisième peut porter le même nom que celui de la première et la quatrième le même nom que celui de la seconde etc. Cette règle est très importante car elle joue un rôle dans les mariages. En effet, pour que deux personnes du sexe opposé aient vocation a s'épouser, il est impératif qu'elles portent des noms compatibles. Sinon, le mariage est impossible. On peut supposer que cette règle a pour objet la résolution des problèmes posés par la consanguinité. Autre règle: une belle mère peut servir à manger à son gendre mais ne peut pas lui adresser la parole. Le gendre n'a pas non plus le droit de parler à sa belle mère. S'ils ont à se communiquer, ils doivent recourir à un intermédiaire. On peut penser que cette règle vise à éviter les conflits entre gendre et beaux parents. Avant de nous séparer le guide (David Jungala Kriss), qui est aussi peintre, nous montre des cartes postales où sont reproduites certaines de ses oeuvres. J'en achète quelques-unes. Comme nous nous rapprochons de notre véhicule, il me semble qu'un bruit bizarre, que j'entends depuis un moment et que j'avais attribué au vent, augmente d'intensité. Mon guide francophone me tire de ma perplexité en me précisant qu'il s'agit d'un circuit pour motos installé dans la réserve. Lui aussi, la première fois qu'il l'a entendu, l'a pris pour une rafale de vent soufflant dans les eucalyptus. On n'arrête pas le progrès, même chez les Aborigènes. Doit-on s'en féliciter? Un vol de galahs, ces perroquets gris et rose, s'abat sur le bord de la route au moment de notre départ, comme pour nous saluer. Retour à Alice Springs en fin de matinée. C'est dimanche, jour de marché. Je jette un rapide coup d'oeil sur les étalages installés au long de Todd Mall, une rue piétonne. Je repère des boutiques où l'on vend de la crème d'émeu, souveraine dit-on pour la peau, de l'huile essentielle d'arbre à thé (tea tree), pour les petites blessures et les piqûres d'insectes, et d'eucalyptus, pour dégager les voies espiratoires. Je viendrai plus tard y faire mon marché. Puis je vais manger un bon steak dans un restaurant italien, pour changer, en face d'une tablée où l'on célèbre manifestement l'anniversaire d'une jeune femme, sans doute d'origine indienne, couverte de fleurs et de cadeaux. La salle est comble. Mon déjeuner achevé, je déambule à travers le marché. On y vend à peu près de tout. C'est un joyeux bric à brac, mais sans rien de vraiment tentant. Devant Adelaide House, une belle maison où s'établit, en 1926, le premier et unique hôpital d'Australie centrale, qui fut un temps le siège du Royal Flying Doctor Service, des Aborigènes vendent le produit de leur artisanat, essentiellement des peintures. On rencontre beaucoup d'Aborigènes dans la ville. Je suis frappé par leur expression boudeuse. On diraient qu'ils ne savent pas rire. Je leur trouve un air de famille avec les Canaques de Nouvelle Calédonie. Peut-être sont-ils de la même origine. Le bas du visage proéminent de certains d'entre eux m'amène à évoquer nos lointains ancêtres. Je pense à des scènes de l'odyssée de l'espèce. C'est une grande chance de pouvoir confronter à notre civilisation une autre qui sort directement de l'âge de la pierre taillée. J'espère que les Aborigènes sauront préserver l'essentiel de leur héritage culturel, malgré les séduisants appels des sirènes de la modernité. A côté d'Adelaide House se dresse une église devant laquelle trois croix ont été plantées. C'est le lieu de culte d'une mission de l'Eglise unifiée, une religion chrétienne d'origine nord-américaine. D'autres Aborigènes sont assis dans l'herbe, devant les bâtiments de la mission. On commence à plier les étalages. Je me dirige vers la rivière Todd. Son lit est à sec. On peut tranquillement s'y promener. Des gommiers majestueux s'y dressent. En 1888, le constable W. G. Scuth écrivit au ministre du Territoire du Nord une lettre où l'on peut lire: "... les jeunes gommiers, le long de la Todd Creek... requièrent une protection ou alors il est préférable de les abattre... je vous demande d'édicter une réglementation relative à cet objet. Les arbres constituent l'ornement de cet endroit et leur destruction serait une calamité." Cette supplique fut suivie d'effet et, grâce aux mesures qui furent prises, il est possible d'admirer aujourd'hui ces beaux arbres plus que centenaires. Une humidité minimum est indispensable à leur survie. Il arrive que les fortes pluies transforment la rivière en un torrent impétueux qui recouvre les berges. Les troncs blancs des arbres portent la trace de ces crues. En 1974, la rivière Todd coula pendant neuf mois. Mais, la plupart du temps, elle reste sans eau pendant des mois. En remontant le Todd Mall, je remarque un oiseau blanc et noir qui me rappelle nos pies. De très loin, pour ne pas les effaroucher, on les prétend timides, je photographie un groupe d'Aborigènes assis devant Adelaide House. J'entre dans une bijouterie spécialisée dans les opales. J'entame une conversation avec une vendeuse très gentille qui comprend sans difficulté mon anglais (une fois n'est pas coutume), me donne des explications orales ainsi qu'un texte en français. A la hauteur de la boutique, sur une placette, un panneau indicateur précise certaines distances. J'apprends ainsi que je me trouve à 16850 km de Dijon! Au bout du mail, je passe auprès d'une éolienne au repos. Dans la rue (non piétonne) qui prolonge le mail, je découvre un saloon aux portes battantes, comme au Far West. J'arrive dans les faubourgs. Alice Springs est une bourgade qui compte malgré tout plus de 20000 habitants. Au bout de la route, s'élèvent les premières collines des monts Mac Donnell. Je reviens sur mes pas. Je prends une bière,
commandée au bar, à une terrasse. Elle est excellente, comme
toutes les bières australiennes qu'il m'a été donné
de tester, alcoolisée à mon goût, c'est-à-dire
assez (4 à 6°). J'entre dans une galerie où sont exposés
de très beaux tableaux aborigènes. Certains, de facture très
moderne, me font penser à des images fractales. J'échange
mes impressions avec la personne qui tient la galerie. Elle dispose d'un
site internet. Je prends l'engagement de créer un lien à
partir du mien. Nous échangeons nos adresses électroniques
(Email). La peinture aborigène est curieuse. On dirait que les personnages
sont représentés par leurs traces. Tout y est comme vu de
dessus. Chaque tableau est rempli de symboles pas toujours faciles à
déchiffrer. Les harmonies de couleurs sont souvent très réussies.
N'allez pas croire à l'uniformité du style. En réalité,
il existe, au moins pour la peinture traditionnelle, une assez grande variété
de manières de peindre (pointillisme, bandes colorées, représentation
du squelette interne des corps...). On serait parfois tenté de parler
d'abstraction si l'on ne savait pas que, pour les Aborigènes, toutes
ces représentations sont des images de la réalité.
Fréquemment, les tableaux évoquent les péripéties
d'une légende du Tjukurpa ou sont d'élégantes cartes
de géographie stylisées sur lesquelles les chemins, jalonnés
de points d'eau, sont clairement indiqués.
Je passe sous un nouveau panneau indicateur de distances installé devant l'église. Je suis à 14281 km de Rome. Je trouve Londres et Berlin, mais pas Paris. Cela me vexe quelque peu! Les Aborigènes sont partis en laissant les débris de leur repas sur la pelouse. Attiré par l'aubaine, des corbeaux ont pris leur place. Le crépuscule descend. J'observe un bel oiseau blanc, sans doute de la famille des perroquets, jugé dans un arbre, puis un autre oiseau à contre jour sur le rebord d'un toit. Une vieille Aborigène s'approche de moi pour mendier quelques dollars. Je vais jusqu'au carrefour du bout du mail, en direction de la rivière, d'où l'on aperçoit le monument au mort de l'Anzac, tout blanc en haut de sa colline. Des drapeaux flottent dans le vent. L'Australie envoya périr au loin ses enfants dans des luttes qui ne la menaçaient pas au cours des deux guerres mondiales. (Voir la page dédiée à l'histoire ici ). Il fait maintenant presque nuit. Les corbeaux
se sont réfugiés dans les arbres. On distingue à peine
leur masse noire à travers les feuillages en face du restaurant
de l'hôtel, dont la façade s'ouvre sur le mail et l'arrière
se ferme sur un parking obscur. Je vais aller dîner. Tout se passe
comme à l'accoutumée. A la fin du repas, je demande à
la serveuse une bouteille d'eau minérale (mineral water) pour la
nuit. Elle ne comprend pas et appelle un garçon à son secours.
Celui-ci, plus dégourdi, me présente deux bouteilles, l'une
d'eau gazeuse, l'autre d'eau plate, en m'invitant à choisir. Décidément,
mon anglais ne passe pas auprès des serveuses!
Je flâne à nouveau dans les rues. A un carrefour, recouvert d'une sorte de chapiteau de toile, un grand nombre d'Aborigènes sont rassemblés et papotent entre eux. Je me rends jusqu'à la Poste, puis j'arpente une fois de plus le Todd Mall. Un rapace tourne au-dessus de la ville sur le bleu soutenu d'un ciel profond, exempt de nuage. Je vois la rue sous un éclairage différent: saloon, colline des monts Mac Donnell, United Church, Adélaide House, colline de l'Anzac... Déjeuner à la terrasse du Red Ochre Grill. Je suis servi assez rapidement et parfaitement compris par une serveuse au sang visiblement mêlé. Je ne pense pourtant pas que mon anglais s'est beaucoup amélioré depuis la veille! Ma note réglée, je patiente dans un fauteuil de la réception en lisant un journal local. La justice a dû sévir contre de jeunes délinquants qui lapidaient les passants à coups de pierre. Je retrouve des incidents presque familiers! Cela fait plaisir de constater que la France n'est sans doute pas le seul pays de la planète où on brûle les voitures dans les banlieues. Le chauffeur qui doit m'emmener à l'aéroport
est ponctuel. C'est une aimable jeune femme. Nous engageons la conversation.
Elle me rappelle la situation stratégique d'Alice Springs, au centre
du désert, sur la liaison ferroviaire qui va d'Adélaïde
au sud à Darwin dans le nord. Je lui parle de mes activités.
Elle me promet de visiter mon site. Nous nous séparons presque amis.
A l'aéroport, je me rafraîchis en prenant une bière. De grands tableaux aborigènes décorent les salles où attendent les passagers. Le vol est sans histoire. J'ai obtenu une fenêtre et je regarde se dérouler le paysage qui devient de moins en moins désertique au fur et à mesure que l'on se rapproche de Cairns, dans le Queensland. Des nappes d'eau apparaissent. Vers la fin, les montagnes sont recouvertes d'une épaisse fourrure végétale. Nous sommes désormais sous les tropiques. Une voiture de l'hôtel vient me chercher à l'aéroport. J'ai la vision d'un gigantesque bonhomme de bois bariolé qui se dresse au bord d'une avenue. C'est une effigie peu flattée du capitaine Cook. Le Colonial club est un complexe hôtelier d'importance, situé à l'écart de la ville, mais qui met des navettes, pour s'y rendre et en revenir, à la disposition de sa clientèle. Un porteur m'aide à convoyer mes bagages jusqu'à mon bungalow. C'est heureux. Malgré le plan qui m'a été remis, je ne sais pas si je l'aurais retrouvé facilement. Les chambres sont noyées au milieu de la verdure. Une multitude de chemins, formant un véritable labyrinthe, mènent d'un endroit à un autre. Les parcours sont soigneusement fléchés et on se retrouve toujours, mais mieux vaut tenter l'expérience sans fardeau au bout des bras. Le porteur m'indique sommairement la direction des trois piscines, des deux bars et des deux restaurants que compte le complexe. L'un des restaurants, celui où l'on prend son petit déjeuner, proche de la réception, est facile à trouver. La piscine principale est en face. Pour l'autre, le Jardines Restaurant, qui se trouve à la sortie diamétralement opposée, c'est un peu plus compliqué, ce qui est dommage car c'est le plus réputé. Les restaurants ne sont pas ouverts à midi. Pour déjeuner, on peut recourir à un café situé de l'autre côté de la piscine principale, à côté de l'un des bars et des salles de jeu et de détente. Mes affaires déballées et mes ablutions achevées, il se fait tard. Je me hasarde en direction du fameux Jardines Restaurant. Il jouxte le centre de conférence. En suivant les flèches, j'y parviens au bout d'un moment, non sans avoir levé à mon passage des sortes de gros rats, à défaut de lièvres. Ce sont des marsupiaux encore inconnus pour moi: les bandicoats. Ils sont inoffensifs. (Une note sur les bandicoots est ici ) Au restaurant, je tombe au milieu d'un groupe de collégiens japonais en goguette dont l'effectif est certainement celui de tout un pensionnat. Je bats donc en retraite, malgré la gentillesse et la politesse, presque excessive, de ces jeunes gens dont devraient s'inspirer certains de nos adolescents. Je lève la tête au ciel pour tenter d'y deviner la Croix du Sud, que l'on m'a appris à reconnaître, voici déjà des années, à Madagascar. Et je reviens en direction de l'autre restaurant, proche de la réception, au milieu d'une file de jeunes asiatiques. Les bandicoats détalent à notre approche! Le dîner aurait été sans
histoire, du poisson pané, si je n'avais pas eu l'idée saugrenue
d'essayer une boisson locale qui, malgré son apparence de vin blanc,
est obtenue au moyen de la fermentation du jus de mangue. Je découvre
les vins de fruits. Ils sont agréables à l'apéritif,
mais n'accompagnent pas bien les plats. Je m'en console en sifflant une
coupe de pétillant australien tout à fait convenable.
Dix mai: Petit déjeuner au self service du Colonial Club. Il faut montrer patte blanche: un ticket délivré pour l'intégralité du séjour. Le buffet est bien garni. Tout est excellent et il y en a pour tous les goûts. Les fruits sont toujours aussi généreusement prodigués. Je n'ai pas eu à me plaindre des petits déjeuners, où que ce soit, en Australie. La journée est consacrée à une croisière jusqu'à la Barrière de Corail. Cet ensemble de récifs s'étend sur quelques 2500 km de long et couvre 345000 km2. Il longe les 3/4 de la côte du Queensland. C'est pourquoi la barrière est qualifiée de grande. Elle présente la plus grande diversité d'espèces vivantes au monde (6600). Il paraît qu'elle est visible de la lune. On dit aussi cela de la Grande Muraille de Chine et c'est faux! Un car de ramassage vient me prendre à la réception de l'hôtel. Il parcourt la ville d'hôtel en hôtel avant d'amener son chargement de touristes jusqu'au môle. J'entends parler notre langue. Je ne serai pas le seul Français à bord. Nous devons embarquer dans un catamaran. A l'entrée de la passerelle, une photographe me tire le portrait affublé d'une bouée dans les bras. Nous nous éloignons du quai. Dans le port, grouillant de bateaux, j'aperçois deux navires de guerre des États-Unis. Un article lu rapidement dans un journal me revient à l'esprit: on y parlait d'une invasion de Cairns par la marine américaine. Nous nous éloignons de la côte entre des montagnes éloignées noyées dans la brume. Le temps est couvert. Au large, on voit nettement la pluie tomber en diagonale compacte sous de gros nuages gris. Les passagers qui le souhaitent sont invités à s'inscrire pour la plongée. Une séance d'explications est ensuite dispensée sur le pont avant par des membres de l'équipage. La mer est un peu grosse et il n'est pas facile de tenir debout sur ses deux jambes. Les fanions des différentes nationalités présentes sur le navire claquent au vent au-dessus de nous. Un grain balaie le pont avant et toute la compagnie se réfugie précipitamment vers le pont couvert de l'arrière et l'abri de la salle centrale. Nous apercevons, sur la droite, une terre basse que je pense être, d'après les cartes, l'Île aux Huîtres. Après un temps assez long de navigation, le navire jette l'ancre à proximité d'un îlot aux plages de sable blanc (Upolu Cay ou Michaelmas Cay?). Une végétation rase, de couleur vert sombre, souligne le sommet de cet îlot envahi par une colonie d'oiseaux de mer. Ils sont innombrables, au repos sur la plage ou volant dans les airs. Quelques-uns viennent au devant du bateau. Le temps s'est quelque peu dégagé. L'eau change progressivement de couleur depuis la terre jusqu'en pleine mer: vert pâle, bleu pâle, violet, bleu foncé, gris bleu... Tout un dégradé de nuances! (Une planche sur les oiseaux de mer est ici ). Des membres de l'équipage jettent de la nourriture dans la mer qui grouille aussitôt d'une multitude de poissons colorés se précipitant à la curéee vers la surface. Les plongeurs revêtent leur équipement et embarquent sur une vedette. Un semi submersible approche du catamaran. Je me rends dans la salle centrale prendre le billet qui m'autorisera à pénétrer à l'intérieur de ce sous-marin d'opérette. Une file d'attente s'est déjà constituée. J'y prends place. Un à un, nous entrons à l'intérieur du vaisseau par une porte étroite et basse. Nous nous nous asseyons sur les bancs installés en travers. Chaque banc est prévu pour deux personnes. Un hublot s'ouvre dans la paroi de chaque côté. Comme je suis seul, je dispose d'un banc entier et de ses deux hublots. Je pourrai donc jouir sans entrave du spectacle, à droite aussi bien qu'à gauche. Pour le moment, nous pouvons voir des poissons multicolores évoluer et faire des cabrioles sous la quille du catamaran. Le submersible démarre et nous nous promenons sous l'eau, le long des récifs. Le spectacle des coraux et des poissons qui les hantent est féerique. Tour à tour ce sont des branchages, des palmes, des choux-fleurs, des chevelures ondoyantes, des fraises, des éponges, des murs, des tours, des méandres... Ces constructions aléatoires, issues de l'imagination débridée de la nature, sont jaunes, vertes, rouges, bleues... Au milieu d'elles évoluent de nombreuses espèces d'animaux marins. J'aurai même la chance de photographier une tortue. Nous passons au-dessus d'un fond tapissés de brindilles de coraux morts. L'instant d'après, nous longeons une falaise dont on n'aperçoit pas la base... Mais les images sont plus explicites qu'un long discours! Malheureusement, ces merveilles son menacées par le réchauffement climatique. Une augmentation de 2 degrés de la température entraînerait un blanchissement généralisé des coraux; à partir de 3 degrés, devenus incapables de se nourrir par suite de l'expulsion des algues microscopiques dont ils se sustentent, ils disparaîtraient en grand nombre. Déjà, en 1998 et 2002, des blanchissements significatifs ont été observés amenant les autorités à imaginer les moyens de faire face à la menace qui pèse sur le récif. Nous réintégrons le catamaran. Une autre fournée s'engouffre dans le semi submersible. Je flâne sur les différents ponts en attendant l'heure du déjeuner. Celui-ci se prend dans la grande salle du pont inférieur. Le buffet est bien garni: crevettes, salades diverses, fromages, fruits... Nous pouvons choisir entre plusieurs plats chauds: viande ou poisson. On peut se procurer du vin au bar en acquittant un supplément. Il n'y a rien à redire. L'après-midi, les activités marines reprennent, pour ceux qui veulent s'y adonner. Pour ma part, je me contente d'errer sur le bateau en regardant la mer et ses nuances, les plongeurs qui s'enfoncent et refont surface, les oiseaux sombres qui traversent le ciel. Je lie conversation avec un Américain jovial qui regagne sa patrie le lendemain. Comme un vent frais se lève, je vais m'asseoir à l'intérieur. Les serveurs sont en train de débarrasser le buffet. Un impressionnant glouton, dont j'ignore la nationalité, n'a pas quitté la table de l'après-midi; il se précipite, rapporte une assiette recouverte d'une montagne de carapaces vides et s'empare des crevettes qui restent avant qu'on ne les enlève, puis il retourne à sa table se livrer à son passe-temps favori. Il en aura eu pour son argent! La photographe s'installe pour vendre les clichés qu'elle a pris et qu'elle tire sur l'imprimante d'un ordinateur. Ils sont très réussis. Je me reconnais sur l'un d'eux. Peu à peu, les plongeurs regagnent le bord. On nous invite à signer une feuille de contrôle afin de n'oublier personne. Nous sommes récompensés par un gâteau accompagné d'une coupe de pétillant australien fort agréable. L'ancre est levé et nous rentrons vers Cairns. Nous profitons du vent du large pour naviguer à la voile. Peu à peu les montagnes de la côte sortent de la brume. Nous croisons de nombreux autres esquifs, tant voiliers qu'à moteurs. Nous commençons à distinguer les maisons de Cairns. A l'approche du port, les fanions sont hissés. Le temps est plus dégagé que dans la matinée et l'on aperçoit bien la végétation luxuriante qui recouvre les pentes. Plusieurs voiliers sont à l'ancre dans la baie, devant une bande de terre plate boisée derrière laquelle se profile une colline qui a la forme du Fuji Yama (le mont Withfield?). Nous assistons à l'entrée dans un bassin du port d'un autre catamaran plus petit que le nôtre. Les navires de guerre américains sont toujours là. Nous débarquons sur le quai salués par les membres de l'équipage alignés en haie. Je me sens tiré par la manche: c'est mon Américain de l'après-midi qui vient prendre congé de moi. Nous échangeons une chaleureuse poignée de main accompagnée de voeux de bonne chance. Un car nous ramène à nos hôtels respectifs. Une belle journée vient de s'achever. Je dîne au même restaurant que la veille et à la même table. Steak grillé pommes frites. La viande serait excellente si la sauce barbecue qui l'accompagne n'était pas trop abondante. Si j'en crois le menu, cette sauce a fait la réputation du chef. Les cuisiniers disposent en Australie d'une matière première de qualité. Il leur serait certainement loisible de confectionner des plats dignes des meilleures tables. Mais leur goût ne correspond probablement pas au nôtre. J'achète une bouteille d'eau pour la nuit à la boutique de l'hôtel. Il y a bien un bar dans ma chambre, mais il est vide! Je me rends ensuite à l'agence de voyage qui est juste en face. Elle est presque toujours ouverte. Je me procure quelques dépliants et m'informe pour savoir comment occuper ma journée du surlendemain qui est libre. Puis, je regagne mes pénates. Onze mai: Lever de bonne heure. Lorsque je quitte ma chambre, mon voisin, un corpulent Aborigène, est déjà installé sur une chaise devant sa porte. Les Japonais ont investi en masse la salle du petit-déjeuner. A l'entrée, je suis refoulé par une hôtesse aux joues hautes et aux yeux en amandes. Il me faut gagner l'endroit réservé aux Européens par le jardin. Le parcours est fléché. Après m'être pourvu d'une énergie suffisante pour la matinée, je m'installe confortablement dans un fauteuil du vaste hall d'accueil en attendant la venue du guide qui doit m'accompagner à Kuranda. Mon guide est une blonde aux yeux bleus vêtue de bleu. Installée depuis peu en Australie, elle est d'origine anglaise. Elle parle un français correct qu'elle a perfectionné au cours de séjours en France. Des groupes nombreux de touristes japonais s'engouffrent dans les autocars qui leur sont destinés. Je demande à ma guide si elle est vraiment certaine que le Japon a perdu la guerre et si, au contraire, l'Australie n'a pas été envahie. Nous montons dans le bus de ramassage et la tournée des hôtels commence. Nous passons devant la gare et ne nous y arrêtons pas. Le train de Kuranda en part pourtant, mais il est préférable d'aller le prendre plus loin dans une autre gare plus typique. Du moins, c'est l'avis de ma guide. Cette seconde gare ressemble à celles du Far West. Je crois qu'elle porte le nom de Freshwater parce qu'on s'y approvisionnait en eau à l'époque héroïque. Sa façade en bois verni, sur le bord de la route, ne manque pas de charme. Sur l'arrière, s'étalent de vastes champs de canne à sucre. L'Australie exporte du sucre jusqu'en Chine et en Russie. La gare comporte un petit musée où est retracée l'épopée de la construction de la voie ferrée, à travers les montagnes et la forêt équatoriale, sur les pentes spectaculaires des gorges de la rivière Barron. (Un récit succinct de cette épopée est ici ). Des mines ayant été découvertes par delà les montagnes, le transport du minerai et des approvisionnement par voie terrestre s'avéra difficile en employant les moyens traditionnels. C'est pourquoi la construction d'une ligne de chemins de fer fut décidée. Son achèvement exigea de longs travaux, dans un environnement défavorable, et causa la perte de plusieurs dizaines de vies humaines. Mais il assura la prospérité de Cairns. Le progrès est à ce prix. En attendant le train, nous flânons sur le quai bordé d'anciens wagons rouges et blancs. Ceux dans lesquels nous montons bientôt sont en tous points semblables: sièges en bois, fenêtres largement ouvertes... Nous voici partis. Nous longeons des champs de canne à sucre avant de passer par le village de Redlynch qui tient son nom d'un Irlandais roux. L'Hôtel du Béret Rouge (Red Beret Hotel), quant à lui, appartint à un parachutiste des troupes d'élite qui s'illustrèrent pendant la seconde guerre mondiale. Un peu plus loin, Jungara abrita l'hôpital le plus important où furent soignés les blessés de la guerre du Pacifique à la même époque. Dans la courbe de Horseshoe Bend (Courbe du Sabot de Cheval), de notre wagon, il est possible de voir la tête du train. J'en profite pour prendre une photo. Nous abordons les contreforts de la montagne. La pente devient de plus en plus raide. Nous avançons lentement dans une tranchée bordée de végétation tropicale touffue et enchevêtrée. Par instant, la vallée et Cairns apparaissent en contrebas. Un premier tunnel est franchi. Primitivement, il était prévu d'en percer dix neuf. Quatre furent remplacés par des tranchées. Il en subsiste donc quinze. Ces tunnels furent construits en utilisant le sable de la rivière Barron convoyé par wagons tant que c'était possible et ensuite à dos de mulet. Le sixième tunnel défraya la chronique en 1973: des bandits masqués y arrêtèrent le convoi, s'emparèrent de la paye des ouvriers de Tableland avant de s'enfuir en utilisant ce que je suppose être une draisine à bras. Les auteurs de ce hold up courent toujours. Encore le Far West! La gare de Stoney Creek ne paye pas de mine. Pourtant, lors de la construction de la voie, elle était entourée par une véritable petite ville avec ses pubs, ses tripots et son église méthodiste, au bord des gorges de la Barron. Un petit viaduc en poutrelles métalliques enjambe une vallée affluente de celle de la Barron. Il fut achevé en 1890. A cette occasion, une fête fut organisée avec la participation du gouverneur Sir Henry Norman. Un buffet y fut mis à la disposition des invités. Cet ouvrage d'art est la principale attraction de la voie. Un peu plus loin, sur la gauche, une cascade dévale les pentes, juste au bord de la voie. Elle passe dessous. Glacier Rock et Red Bluff sont deux sites particulièrement
spectaculaires qui dominent la gorge de la Barron. L'apparence grisâtre
de Glacier Rock tient au granit décomposé dont il est constitué.
Quant à Red Bluff, il s'agit de la pente la plus abrupte de la gorge.
La forêt tropicale couvre les flans des montagnes. Parfois, une cascade
scintille dans le lointain. Un cacatoès blanc traverse lentement
le ciel. Passé le quatorzième tunnel, à travers les
échancrures de la verdure, on aperçoit à nouveau la
Mer de Corail, Cairns, Lake Placid et Kamerunga ainsi que le sommet caractéristique
du mont Withfield avec l'aéroport à sa gauche. Ma guide me
montre du doigt un endroit où réside un de ses amis. Une
vue magnifique sur la vallée de la Barron
s'offre bientôt à nous.
Avec ses 490 m de long, le dernier tunnel est le plus long de la voie. Il comporte trois courbes et 11 abris destinés à servir de refuges aux piétons qui l'empruntent au cas où surviendrait un train. Ce tunnel s'effondra pendant sa construction et onze personnes furent tuées. le Robb's Monument est un énorme rocher laissé en place pour servir de témoin et aussi parce qu'il joue un rôle dans la tradition aborigène. Un peu plus loin, une centrale transforme en énergie électrique la puissance du courant de la Barron. La houille blanche n'étant pas la ressource la plus courante en Australie, je demande à ma guide si des centrales nucléaires y sont aussi en activité. Elle l'ignore et consulte sa documentation mais n'y trouve rien sur le sujet. Le train s'arrête bientôt à proximité des Barron Falls, chutes d'eau de 265 m de hauteur. Nous nous trouvons à une altitude de 329 m. De minces filets tombent le long d'une paroi rocheuse presque à pic, se reposent un instant dans une vasque verte pour rebondir et finir dans une vallée dont on ne voit pas le fond. Nous nous promenons sur le bord, en empruntant des chemins soigneusement entretenus, balisés et protégés. On ne risque pas de tomber dans le trou! Le prochain arrêt est à la gare
de Kuranda. L'édifice actuel date de 1915, à l'époque
où l'éclairage au gaz fut installé. Il constitue un
témoignage intéressant du passé. Kuranda est une destination
touristique prisée depuis plus d'un siècle. Nous échangeons
les rudes banquettes de bois du train pour celles, plus moelleuses, d'un
bus qui nous dépose devant le Sanctuaire du Papillon
Australien. La visite n'est pas prévue au programme. J'y pénètre
tout de même, en compagnie de ma guide, en payant.
C'est la plus grande ferme d'Australie pour l'élevage des papillons, compte tenu de la dimension de l'enclos à l'intérieur duquel ils se déplacent en liberté. La volière est une vaste verrière grillagée, à structure d'aluminium, d'une dizaine de mètres de haut et d'une vingtaine de mètres de portée, au sol vallonnée traversé par un ruisseau. L'ensemble du sanctuaire couvre plus de 28000 m2. Des plantes tropicales y sont cultivées. Les oeufs des papillons sont soigneusement recueillis et mis à incuber dans une sorte de chambre forte à l'abri des regards indiscrets et des prédateurs. Les touristes ne sont pas autoriser à leur rendre visite. Mais ma guide enfreint l'interdiction. Deux papillons sont en train de copuler sur un grillage. Ma guide anglaise me fait remarquer avec quelle fermeté la femelle agrippe son mâle. Ce n'est certainement pas elle qui prend le moins de plaisir à l'acte. Au risque de paraître indiscret, je photographie les ébats amoureux du couple. Des chenilles de quelques espèces sont exposées sous l'image de leur papillon. Dans des salles, des lépidoptères, d'ici et d'ailleurs, sont épinglés sous verre, sur des cartons. Certains sont d'une taille impressionnante. De nombreuses explications sont livrées. Il y aurait de quoi réjouir un entomologiste! (Une notice sur les papillons est ici ). La visite achevée, ma guide m'invite à faire le tour des boutiques pour touristes nombreuses à Kuranda. Elle me donne rendez-vous devant le Sanctuaire du Papillon Australien, où notre car doit venir nous prendre. Je déambule à travers le village en observant les plantes (fleurs jaunes, palmiers, arbres à racines aériennes...) et en faisant du lèche-vitrine. J'achète un paquet de café. Ma guide me confirmera qu'il est cultivé dans la région. Comme nous rencontrons de nombreux Japonais, elle me taquine en afirmant que ce sont ceux de l'hôtel qui me poursuivent. Ensuite, nous nous rendons vers Forêt de la Pluie (Rainforest). La forêt tropicale humide s'étend sur 300 km au nord du Queensland et couvre 366455 hectares au sud-est de cet État et au nord-est de la Nouvelle Galles du Sud. On y trouve des spécimens de la flore et de la faune rares et uniques. Sous la conduite d'un spécialiste, nous prenons place à bord de véhicules amphibies de l'armée australienne. Premier arrêt à proximité de l'arbre hôte des papillons Ulysses (Euodia Elleryana). Le guide spécialisé nous parle de plantes à vertus thérapeutiques qui seraient utilisées par la firme Bayer. Second arrêt auprès de palmiers (Wait-a-while Palm - Palmier Attendez un Moment) et de fougères arborescentes. Troisième arrêt auprès d'une plante à croissance lente qui n'est pas parasitaire (Elkhorn Fern - Fougère Corne d'Élans). Quatrième arrêt auprès d'un Pandanus. J'en ai déjà vu ailleurs, à la Réunion, notamment. Les Aborigènes les emploient et en mangent. Cinquième arrêt auprès de deux variétés de plantes, une qui croît rapidement (Pencil Cedar - Cèdre à Crayon) et une autre qui croît lentement. La plus grande n'est pas la plus vieille. Sixième arrêt auprès d'un arbre utilisé par les aborigènes pour confectionner leurs boomerangs et leur bâtons (Black Wattle - Acacia Noir). Septième arrêt à côtés de plantes très anciennes. Elles compteraient plus de 150 millions d'années (Tree Fern géant - Fougère Géante et Tree Fern noir - Fougère Noire). Huitième arrêt: la Staghorn Fern (Fougère à Cornes de Mâle), un cousin de l'Elkhorn Fern vu précédemment. Neuvième arrêt: la Birdsnest Fern (Fougère Nid d'Oiseaux) encercle le tronc d'autres arbres. Dixième arrêt: les brindilles et la végétation pourrie procure un habitacle où les insectes font incuber leurs oeufs. Onzième arrêt: le Basket Fern (Fougère Panier) sert d'abri aux animaux et aux insectes. Douzième arrêt: les Ribbon et Tassel Ferns (Fougères à Ruban et à Gland) remonteraient à 400 millions d'années. Treizième arrêt: Le Strangler Fig Seedling (l'Étrangleur) tue la plante qui l'accueille pour prendre sa place. Quatorzième arrêt: la NQ Fan Palm (Fougère Éventail) aurait plus de 200 ans. Jusqu'à présent, nous avons roulé sur la terre ferme en empruntant des pistes argileuses plus ou moins glissantes. Maintenant, nous nous engageons dans l'eau boueuse d'un vaste marigot et notre voiture se transforme en bateau. Nous faisons le tour de ce petit lac dont nous ignorerons toujours la profondeur. La forêt tropicale qui le ceint est particulièrement dense. Chemin faisant, nous découvrons dans les arbres un nid de fourmis (ou de termites, ces bestioles qui creusent les troncs pour participer à la confection des didgeridoos), puis une sorte de lézard juché sur une branche, sans doute l'Eastern Water Dragon (Dragon d'Eau Oriental). Nouvel arrêt: le guide spécialiste nous présente une plante venimeuse aux feuilles pourvues de fines aiguilles, l'Arbre à Brûlures (Stinging Tree). Les inconvénients que cause son toucher peuvent durer plus de 6 mois! A côté croit une autre plante dont pendent des lianes pourvues de crochets: c'est le rotin. Les Aborigènes s'en servent pour tresser des paniers. Ses branches souples peuvent également fournir des baguettes propres à corriger les garnements récalcitrants. (Une note sur les reptiles d'Australie est ici ). Nous regagnons la piste que je n'ose pas qualifier de terre ferme. Sur une pente dénudée, fourmillent des dizaines de petits carrés blancs. Ce sont des cartons qui portent les noms des employés d'une firme japonaise (Mitsubishi, je crois) qui sont venus planter là chacun un arbre pour contribuer au reboisement d'une zone qui ne semble pas en avoir besoin! Nous aurons encore l'occasion de voir d'autres plantes: des orchidées, le Palmier à Canne, duquel les Aborigènes obtiennent leurs bâtons de marche... avant de revenir à notre point de départ. Nous jetons un coup d'oeil sur quelques plantes domestiquées, parmi lesquelles je reconnais un cacaoyer, et sur les bêtes qui ont élu domicile sous le toit de tôle de l'endroit où nous venons de débarquer (terme approprié puisque nous sortons d'un véhicule amphibie!): araignées pas plus affreuses qu'ailleurs, nid suspendu de je ne sais quel animal. Puis nous nous dirigeons vers le restaurant où nous allons déjeuner. Le repas est tout à fait convenable. Le buffet est bien garni. On a le choix entre plusieurs plats chauds. Le fromage est bon. Les fruits du désert abondants. La bière était fraîche et, comme toujours en Australie, à mon goût. Ma guide me demande mon opinion sur les vins australiens. Je la lui donne: Les blancs sont excellents; les pétillants corrects; mais les rouges sont trop alcoolisés, au goût franc mais sans finesse. Je ne pense pas faire preuve de chauvinisme en préférant les vins rouges français. Mais je reconnais volontiers que mes connaissances en matière de crus australiens est encore plus que limitée. Le repas achevé, nous allons commencer sa digestion dans l'amphithéâtre où va se produire sur scène une troupe de danseurs aborigènes. Je reconnaîtrai quelques figures déjà vues à Alice Springs. Les autres sont nouvelles. J'ai rassemblé sur une page quelques notes sur ce sujet accompagnées d'une légende régionale. Les spectateurs sont ensuite divisés en groupe. Chaque groupe est pris en charge par un Aborigène. On nous amène dans une sorte de hangar où des explications nous sont données sur les instruments de musique aborigènes: didgeridoo, boomerangs frappés l'un contre l'autre... Comment on les fabrique et comment on en joue, avec exemples à l'appui. Je connais déjà tout cela, à quelques détails près. Puis, nous en venons aux instruments de chasse: javelot et boomerang. L'invention du propulseur permit d'accroître considérablement la vitesse du javelot, sa force de pénétration et de doubler pratiquement sa portée. Notre mentor aborigène nous en apporte la preuve en lançant dans une prairie ces armes de jet, d'abord à la force du bras, ensuite en se servant d'un propulseur. Le projectile s'enfonce assez profondément dans le sol et sa précision, sans être parfaite, est suffisante pour atteindre, à plusieurs dizaines de mètres, un animal de la taille du kangourou. Des essais effectués en direction d'un piquet nous en convaincrons. Le mince piquet de bois ne sera pas atteint mais les javelots le frôleront. Le boomerang, lancé dans un vol d'oiseaux, permet d'en abattre, avec un peu de chance, plusieurs à la fois. Si aucune cible n'est atteinte, il revient vers son lanceur. Cet effet est dû à la taille en biseau d'une face du boomerang. Ce dernier doit être tenu et lancé en respectant certaines règles. La plus importante consiste à choisir un boomerang adapté: il n'est pas biseauté sur la même face pour les droitiers que pour les gauchers. On accroît son efficacité en en lançant plusieurs à la fois. La forme définitive de cette arme de jet, simple mais ingénieuse, fut inventée voici 10000 ans. Des tentatives, auxquelles se sont livrés quelques touristes, me conduisent à penser qu'il ne doit pas être très difficile de s'approprier son maniement. Après cette séance d'initiation, nous nous rendons au parc animalier. Je vais y rencontrer plusieurs animaux que je ne connais pas encore. Les plus intéressants, sont les lézards, dont certains, comme les varans, atteignent des tailles phénoménales (des notes détaillées leurs sont consacrées ici ). Le crocodile de rivière est de taille modérée. On dit qu'il ne s'attaque jamais à l'homme. Je ne m'y fierais pas! Le crocodile d'estuaire est beaucoup plus volumineux. Il fréquente les canaux de drainage et les mares (billabongs). Il s'aventure même en mer. Il est dangereux. Ma guide me raconte un fait divers survenus dans la région de Cairns. Une jeune fille aborigène se baignait dans un trou d'eau. Elle fut happée par un de ces crocodiles dont elle n'avait pas soupçonné la présence. Heureusement, des adultes qui se trouvaient sur la berge chassèrent l'animal et lui firent abandonner sa proie. Mais la jeune fille, grièvement blessée, dut être hospitalisée. On peut aussi voir dans ce zoo des Koalas et des kangourous. Mais je connais déjà ces animaux et je n'aurais pas grand chose de plus à en dire si une maman kangourou ne m'avait pas fait l'honneur de se promener devant moi avec son petit dans sa poche. Un passage par la boutique du centre s'impose. Puis nous regagnons Cairns par la route. Une journée encore bien remplie s'achève. Une remarque: On peut rejoindre Kuranda par le rail, la route et un téléphérique qui tend ses câbles au-dessus de la forêt. Dîner au même restaurant que la
veille, mais à une autre table. Ni surprise ni commentaire. J'achète
une bouteille d'eau minérale à la boutique de l'hôtel,
puis vais retenir ma place pour un tour de ville demain. C'est, après
examen des dépliants et mûre réflexion, la solution
que j'ai retenue.
Je feuillette quelques revues en m'intéressant tout spécialement aux articles qui traitent de l'histoire de l'Australie: la traversée du continent du nord au sud par John Mac Douall Stuart, les aventures des hors la loi, magnifiées par la légende: Ben Hall, Ned Kelly, Fred Ward alias Capitaine Thunderbolt... et tant d'autres (des notes relatives à ces bushrangers sont ici ). Il est significatif que ces détrousseurs de riches soient considérés comme des héros, des sortes de Robin des bois. A l'époque où ils exerçaient leurs talents, la majeure partie de la population australienne ne descendait-elle pas d'anciens bagnards? Et la dure vie, émaillée d'injustices, qui était le lot de la classe la plus pauvre, ne l'incitait-elle pas à trouver comme une compensation dans les exploits de ceux qui s'en prenaient aux nantis. Les similitudes entre l'Australie et l'Amérique du Nord me semblent de plus en plus frappantes. Comme les États-Unis, l'Australie jouit d'un vaste espace et d'une grande variété de climats; comme eux, elle a été colonie anglaise et parle la même lange; comme eux, elle a eu ses indiens: les Aborigènes; comme eux, elle a eu ses chercheurs d'or; comme eux, elle a eu ses outlaws: les bushrangers! Comment ces deux peuples ne se sentiraient-ils pas proches? Je découvre aussi quelques poètes australiens dont je ne connaissais même pas le nom. A midi, je déjeune au bar, près de la piscine. Je n'ai pas le choix puisque les restaurants de l'hôtel n'ouvrent que le soir. Deux oiseaux, qui ont la corpulence et la couleur des merles, tentent des manoeuvres d'approche dans l'espoir de grappiller quelques miettes. Ils tournent autour de moi, allant du sol à un dossier de chaise canné, pour terminer leur périple sur un fil tendu en diagonale entre le toit de la terrasse couverte, où je suis installé, et la barrière qui la ferme. Une tourterelle, plus prudente, reste sur le pas de la porte. Je me promène un moment en face de l'hôtel. Un ibis, qui picorait une pelouse, s'envole et se pose sur la grille d'une maison. Cet oiseau n'est pas très farouche. Les demeures construites au bord de la rue sont assez typiques: style colonial, toit bas de tôle ondulée, murs blancs, verdures décoratives et fleurs. Le chauffeur qui vient me prendre me salue cordialement. Je lui demande de parler lentement afin que je comprenne le maximum de ce qu'il dira. Nous voilà partis pour le ramassage. Il me fait remarquer la présence du capitaine Cook en bois. Je le connais déjà! Nous cueillons successivement un couple d'Australiens âgés accompagnés de leur fille, un peu forte mais gentille. Elle me tiendra compagnie pendant tout l'après-midi et j'aurai ainsi l'occasion de pratiquer mon médiocre anglais. Deux autres couples montent ensuite successivement. Je ne me souviens plus de leur nationalité. Je crois que l'un était néo-zélandais ou sud-africain. Le tour commence par où on finit généralement,
c'est-à-dire par le cimetière.
Un mélange d'influence: gazon et pierres tombales. Il est interdit
de déposer sur les tombes des pots de fleurs contenant de l'eau,
à cause des moustiques. Des oiseaux, ibis et échassiers,
vaquent cérémonieux dans les allées.
Nous voici maintenant au jardin botanique Flecker. Visite pédestre. Nous allons découvrir une multitude de plantes tropicales, d'ailleurs pas toutes australiennes, dont il est presque impossible de retenir les noms. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par un arbre remarquable par sa taille et son élégance. Le guide attire notre attention sur la singularité des pelouses de Cairns constituées d'une herbe à larges feuilles qui me rappelle nos raiponces. Nous cheminons à travers les allées ombragées. Voici, au hasard de mes souvenirs, une nomenclature des plantes rencontrées: gingembre local; palmier rouge à lèvres; arbre gigantesque qui me rappelle un tilleul mais qui n'en est pas; orchidées, fleurs étranges ressemblant à des éprouvettes; faux caoutchouc, avec en son milieu un petit oiseau au ventre jaune, dont j'ai fait répéter le nom et que je me suis empressé d'oublier, notre guide n'est pas avare d'explications et connais bien son sujet; palmier parasité de lianes; cacaoyer avec ses cabosses; arbre à saucisses que j'ai découvert en Afrique du Sud; des fleurs, encore des fleurs; des bambous géants de Birmanie... .
Nous quittons le jardin pour rejoindre le Royal Flying Doctor Service. Nous visitons d'abord un petit musée. L'histoire de ce service médical original, qui permit de faire pénétrer les soins jusque dans les endroits les plus reculés d'Australie, est retracée par le menu. J'en ai donné un résumé ici . On trouve aussi une exposition de postes de radio et d'instruments médicaux utilisés au cours du temps par le personnel du service. Aujourd'hui, le RFDS compte dix sept bases à travers l'Australie. Les statistiques affichées montrent que celle de Cairns ne chôme pas (en mars 2005 - Patients hospitalisés: 1424 - Patients transportés: 123 - Consultations: 944 - Total des Patients: 2491. Heures de vol: 279,2 - Km parcourus: 94868). Nous visitons un des avions réformés. Il est équipé comme une ambulance. Pour finir, un film nous raconte en images l'épopée des médecins volants. On nous montre ensuite, dans la salle de projection, le générateur à pédales qui fournissait le courant des postes de radio indispensables pour appeler des secours à partir d'endroits dépourvus de téléphone. Notre guide ne nous parlera pas de l'école des airs. On devrait d'ailleurs plutôt dire: l'école des ondes. Comme les docteurs volants, cette école vise à faire pénétrer l'enseignement jusqu'aux lieux les plus isolés du pays. Mais le maître, qui reste sur place, dispense son enseignement grâce aux moyens de communications les plus modernes. Nous nous promenons maintenant en voiture dans les rues de Cairns. Notre guide dispose d'un volumineux dossier de documentation relatif aux événements qui se sont déroulés dans la cité. Il nous fait circuler ces documents au fur et à mesure qu'il nous en parle. J'avoue ne pas avoir retenu grand chose de toutes ces pièces que j'ai trouvées pourtant, sur le moment, très intéressantes. En parcourant l'esplanade qui longe le front de mer, le guide nous indique un restaurant où nous pourrons manger des fruits de mer. Nous voici vers le port. Les navires américains sont toujours à quai. Plus loin, nous passons devant les docks: cuves à pétrole, entrepôts à sucre d'où cette denrée partira pour l'exportation. Nous traversons des canaux de drainage destinés à assainir une zone marécageuses. Ils sont hantés par les crocodiles. Circulation de la photo d'un énorme monstre qui a peut être terminé sa carrière dans les assiettes des gourmets, puisque cette chair se mange. Que cela ne nous coupe pas l'appétit: pause café et gâteau. Ma voisine australienne note le caractère peu diététique de la pâtisserie, mais la mange tout de même! J'en fais d'ailleurs autant. Au diable l'embonpoint et le cholestérol! Nous gravissons ensuite la colline en direction de Kuranda jusqu'à un point de vue d'où l'on embrasse l'ensemble de Cairns et de ses environs. Les boules du téléphérique se déplacent lentement au dessus de la forêt. A nos pieds, les faubourgs; dans le lointain, la mer; entre les deux, la ville; en arrière-plan, à droite, une vaste mangrove au pied des croupes, à gauche des collines. Nous nous rendons ensuite au golf de Paradise Palm. Il aurait coûté 15 millions de dollars à des Japonais, si j'ai bien compris. Mais cela en valait la peine. Le site est superbe et visiblement destiné à des gens sortis de la cuisse de Jupiter. Le crépuscule est là. C'est le moment de nous rendre à la jetée de Palm Cove où nous allons admirer le coucher de soleil. Au passage, en bord de mer, je remarque que les zones de baignade sont protégées par des filets. Précaution contre les crocodiles ou les requins? Sur la jetée, des pêcheurs plient leur attirail. Le soleil décline lentement, jetant l'or et le sang sur les montagnes et la plage, tandis que la mer s'assombrit. C'est l'occasion ou jamais de tirer quelques beaux chromos! Le guide me demande de lui traduire sunset en français. Je ne trouve rien d'autre de plus précis que "coucher de soleil" que l'on ne comprend pas et que je traduis derechef par "the sun goes to bed". La langue anglaise est plus synthétique que la nôtre. Nous rentrons. Avant de nous séparer, nous visitons une poissonnerie où je peux m'initier aux fruits de mer et poissons locaux. Ils ont beaucoup de points communs avec les nôtres. Certaines espèces sont même identiques (les truites, par exemple), d'autres diffèrent quelques peu (huîtres, moules... mais sont reconnaissables), il en est aussi de totalement inconnus dans nos eaux, comme le barramundi (ou barramunda), que je suis heureux de contempler entier, après l'avoir vu en morceau dans mon assiette. Le barramundi est un poisson de rivière, à larges écailles, qui s'apparente à la perche, mais avec un corps plus allongé. Les Aborigènes, qui l'appréciaient, le pêchaient, à l'époque de sa remontée des estuaires, en construisant dans la rivière un barrage percé d'une sorte d'entonnoir en écorce à sens unique. Après l'avoir garni de plantes aromatiques et d'épices, ils le faisaient cuire à l'étouffée, enroulé dans une pellicule d'écorce, sous du sable recouvert de pierres chaudes. (Une recette gastronomique est ici et une note sur le barramunda ici ). Mes compagnons de route descendent les uns
après les autres. J'échange une chaleureuse poignée
de main avec ma voisine australienne. Ramassé le premier, on me
ramènera le dernier à mon hôtel.
Treize mai: J'ai décidé de consacrer ma dernière journée, au moins partiellement, à une visite à pied de Cairns. Lors du tour en voiture, nous ne nous sommes pratiquement pas arrêtés et je souhaiterais revoir quelques lieux, en prenant mon temps, et les photographier, ce qui ne fut pas possible hier. Après le petit déjeuner, je monte dans la navette qui me dépose au coeur de la cité. Elle me reprendra au même endroit pour le retour. Je me dote de quelques repères faciles à mémoriser: carrefour, nom des rues, un hôtel: le Central Hotel, à la façade blanche, au style colonial un peu suranné, que je n'oublierai pas. Je me dirige vers l'océan. J'aperçois bientôt l'Hôtel Casino du Récif, aisément identifiable, grâce à son dôme. Je suis passé devant pour rejoindre l'embarcadère le jour de la croisière. Je remonte l'Esplanade qui longe le front de mer, avec le souci de trouver un restaurant de fruits de mer pour midi. Le meilleur n'ouvre malheureusement que le soir. Je reviens vers le port, en suivant le bord de mer. Des arbres tropicaux bien fournis, en branches comme en racines, tendent leur généreuse ombrelle aux passants fatigués du soleil qui musardent le long de cette belle promenade. Des oiseaux blancs piochent du bec la boue de la vaste mangrove. Je pousse jusqu'au port. Les navires américains sont toujours là. Après une assez longue marche, je parviens au port marchand et à ses docks, ses grues, ses entrepôts, ses cuves à pétrole... Je reviens vers la ville. Il me faut traverser une large chaussée où la circulation est intense et où n'existe aucun passage pour les piétons. Ils n'ont probablement rien à y faire dans l'esprit des édiles. Comme j'y suis, il m'en faut bien revenir. Après un assez long temps d'attente, je me faufile prestement dans un créneau. Rencontre d'une tourterelle ordinaire (je veux dire sans huppe) sur un trottoir. Elle ne semble pas sauvage et me tient un moment compagnie. Vision d'un très bel arbre dont les racines aériennes, extrêmement denses, ressemblent à un faisceau de perches autour du tronc. A un carrefour, je remarque la belle allure du Crown Hotel. Un peu plus loin, la villa Vaucluse attire mon attention. Que vient faire le nom d'une région de France dans ce quartier de Cairns? Il est vrai que l'on peut se poser la même question à Sydney où il est aussi utilisé. Rond point orné de splendides palmiers devant un très bel édifice colonial, propre comme l'uniforme blanc d'un officier d'antan. Je m'engage dans une rue bordée de plantes multicolores du plus agréable effet. Un square m'invite silencieusement à profiter de ses bancs et des ses ombrages. Des arbres imposants l'occupent. Sur une branche de l'un d'eux, je découvre une orchidée (ou une autre plante?) qui semble s'être enracinée au travers d'une sorte de gros champignon gris du type langue de boeuf. Les allées du square sont décorés de mosaïques et de textes poétiques. Je m'assois sur un banc que vient juste de quitter une jeune chinoise. En levant les yeux vers un arbre proche, je constate qu'il sert de perchoir à une multitude de chauves-souris. Ces bêtes, au museau de chien, à la dimension imposante, à moitié rat et à moitié oiseau, chassent la nuit et sommeillent la journée, pendues par les pieds, la tête en bas, comme de gros fruits noirs et fauves. Leur nombre est réellement impressionnant! Un grand concours de peuple est rassemblé autour d'un chapiteau. Un spectacle est en préparation. Les artistes sont déjà là: des Aborigènes et des Tahitiennes. J'ai beau savoir que des descendants des mutins de la Bounty vivent en Tasmanie, la présence de Polynésiens ici m'interpelle. Il est vrai que certaines danseuses ont le teint un peu pâle, mais d'autres ont réellement le type tahitien. Les Aborigènes sont réservés. En revanche, les Tahitiennes, dès qu'elles me voient avec mon appareil photographique en mains, se poussent du coude et m'invitent, avec leur plus gracieux sourire, à les prendre plutôt deux fois qu'une, ce qui est une façon de parler. J'assiste à ce gracieux spectacle en plein air à l'ombre de la toile blanche du chapiteau. Après quelques hésitations, je déjeune au restaurant conseillé la veille par notre chauffeur-guide: pétillant en apéritif, huîtres assaisonnées de quelques grains de gros sel, poisson pané (fish and chips, quel dommage!), verre de vin blanc sec très honorable. La servante est jolie et très gracieuse. Je la plaisante sur son nom qui est celui d'une plage célèbre des environs. Je rentre à l'hôtel par la navette pour me reposer. Ensuite, je parcours le vaste ensemble du Colonial Club, allant de piscine en piscine (j'en ai compté trois, sans parler de celle des enfants), d'allée en allée, de bar en bar. La flore qui s'y étale est celle d'une véritable forêt tropicale. Les bungalows en sont entourés. Une grande diversité de fleurs, qui paraissent dotées d'une lumière interne qui ne chauffe ni ne rayonne, enrichissent l'ensemble et le font vibrer. Je salue au passage les plantes connues, comme l'arbre à herbe. Pour les autres, j'attendrai qu'elles me soient présentées. De place en place, sur les murs, des pancartes présentent le bandicoat à la clientèle, en lui demandant de ne pas s'alarmer de la présence de cet animal inoffensif. La journée s'avance. Comme il me reste encore du temps avant la nuit, je décide de me rendre au cimetière, que je pense ne pas être très éloigné. En revenant de Cairns, nous avons passé devant et je sais à peu près quel chemin suivre pour y aller. La distance est sensiblement plus longue que je ne l'avais prévue et je n'y parviens pas avant le crépuscule. Plusieurs oiseaux, sombres ibis, échassiers gris et marrons, qui se promenant, qui couchés, qui faisant le pied de grue, sur les caveaux ou entre les tombes, sont encore là pour mon plaisir de photographe. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder. A la sortie, je remarque un arbre chargé de noix vertes. J'imagine qu'il doit s'agir d'un macadamia. Je me hâte vers l'hôtel. La nuit est en train de tomber, moins rapidement toutefois qu'à Sydney où la transition est brutale. Un vol d'oiseaux traverse le ciel rougeoyant, au dessus d'un décor de Floride. Plusieurs oiseaux plus petits, taches sombres sur l'herbe courte, se disputent les graines de la pelouse que je foule. Lorsque je parviens à la réception de l'hôtel, il fait nuit. Pour ma dernière soirée, je mange au Jardines Restaurant. Les Japonais sont partis et il n'y a pas foule. On m'installe sur une terrasse en surplomb des arbres. C'est une soirée très agréable. Le pétillant est toujours aussi bon, le steak à point, mais le vin rouge manque encore un peu de finesse. La cuisine est incontestablement plus raffinée que dans l'autre restaurant. La note s'en ressent. Je passerai une assez mauvaise nuit, qui me
rappelle celle de Sydney. J'impute mes ennuis intestinaux aux huîtres
dégustées à midi. Décidément, les fruits
de mer australiens ne me conviennent pas!
Le chauffeur est ponctuel. J'arrive, comme conseillé, deux heures avant l'embarquement. L'enregistrement s'effectue assez rapidement. Je n'obtiens pas de place auprès de la fenêtre: il n'y en a plus, d'après le préposé. Avant l'embarquement, je bois une bière, j'achète une bouteille de vin de fruits et, comme il me reste de la menue monnaie, je vais la dépenser sur Internet. Trois postes attendent les clients à côté du bar. Je me procure au comptoir un rectangle de plastique aux dimensions d'une carte de crédit. C'est le sésame qui me permettra d'ouvrir une session. Pour quatre dollars (environ 2,4 euros), j'aurai droit à vingt minutes, ce qui n'est pas donné. Jamais je ne retrouverai un service aussi bon marché qu'à Sydney. Je parviens bien à me connecter sur ma boîte aux lettres, mais le système est tellement lent que le temps est épuisé avant l'affichage des messages. Une telle mésaventure m'est déjà arrivée dans le Yunnan. Mais je ne m'y attendais pas en Australie. Je devrai attendre Paris pour lire mon dernier courrier! Une fois dans l'avion, une hôtesse m'invite à changer de place pour ne pas être dérangé par mes voisins: deux petits Chinois, qui pourront dormir à leur aise, si je leur laisse mon siège. En échange, elle m'attribue une fenêtre et le siège contigu. Je vais pouvoir voyager comme en première classe! Dernier regard sur l'aéroport et les collines voisines. Décollage. Survol de Cairns, puis d'une rivière dans laquelle de nombreux bateaux de plaisance sont à l'ancre. L'ombre de l'avion se profile bientôt en contrebas sur l'eau de la baie. Et c'est la barrière de corail qui apparaît, vue du ciel, comme je n'aurais jamais osé l'espérer. Je jouis d'une vue d'autant plus exceptionnelle que, étant à l'arrière de l'appareil, rien ne gêne mon champ de vision. La forme, ellipsoïdale ou en demi lune, des récifs frangés d'écume blanche, les canaux qui les séparent et viennent souvent buter sur un autre obstacle, le gigantesque enchevêtrement de cette construction naturelle, s'offrent à moi pendant plusieurs minutes avec une netteté parfaite. Le temps est clair et le soleil perce parfois la verte surface de l'eau jusqu'au sable et au rocher qu'elle recouvre. Par moment, le minuscule sillage d'un navire donne l'échelle des constructions corallines qui s'étalent au dessous de nous sur plus de 2500 km. Peu à peu, le récif se fragmente en îlots de plus en plus petits et nous atteignons la côte nord-est de l'Australie, à hauteur du Cap York. Des nuages commencent à intercepter la vue du sol, montagneux, boisé, traversé de larges rivières. Au fur et à mesure que nous pénétrons à l'intérieur des terres, les montagnes s'élèvent et la végétation décroît. L'endroit semble presque vide et seules quelques constructions, de la taille d'une grosse ferme, rompent rarement la monotonie du paysage. Le Cap York est rapidement traversé et nous débouchons sur le Golfe de Carpentaria. Une côte basse, rectiligne par endroit, le borde. Un large fleuve, qui paresse en d'amples méandres, s'y jette à travers un long et large estuaire. Nous disons là nos adieux à la terre australienne. La prochaine terre sera l'île que se partagent l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée. Sa côte est presque rectiligne. Le ciel est de plus en plus nuageux. Le soleil baisse et l'horizon se teinte d'orange. La nuit approche alors que nous survolons des îles qui doivent appartenir à l'Indonésie, pour les premières, et aux Philippines, pour les suivantes. Les flammes roses, rouges, bleues, violettes et vertes d'un magnifique coucher de soleil épuisent les dernières cartouches de mon appareil numérique. Je le range jusqu'à Paris. L'écran sur lequel apparaît notre position me permet d'identifier sans risque d'erreur notre passage au-dessus de Manille. Les lumières de la ville scintillent sous un énorme nuage blanc certainement plus haut que la Tour Eiffel. Ce nuage est traversé d'éclairs qui l'illuminent de l'intérieur, comme une immense lanterne vénitienne. Nous sommes loin de l'orage et le bruit des moteurs couvre celui du tonnerre de sorte que le spectacle grandiose qui se déroule sous mes yeux se produit dans une sorte de silence qui en accentue la magie. A Hong Kong, le transbordement est sensiblement plus compliqué qu'à l'aller. Il faut changer de terminal en empruntant un train. Une employée de l'aéroport m'arrête au passage, s'assure que je possède une carte d'embarquement, délivrée à Cairns, et me confie à la garde d'une gracieuse hôtesse de l'air, aux yeux bridés, vêtue de rouge, qui passait par là et se dirigeait justement vers mon terminal. Ma charmante cicérone ne me lâche pas d'une semelle avant de m'avoir guidé jusqu'à l'entrée de ma salle d'embarquement! Heureusement, car j'aurais bien été capable de me tromper deux ou trois fois pendant le parcours. Mais l'organisation chinoise veillait. Je suggérerais que certains aéroports occidentaux s'en inspirent*. * L'aéroport de Hong Kong a été plusieurs fois cité comme étant le meilleur du monde et notamment pour l'année 2008. L'embarquement s'achève à l'heure prévue, mais l'avion, prêt à décoller sur la piste d'envol, revient au tarmac. Un incident technique, on ne saura pas lequel, oblige le commandant de bord à différer le départ. Il n'aura lieu qu'une heure plus tard, une fois tout rentré dans l'ordre. Du moins, nous l'espérons. Quinze mai: La
nuit se passe sans incident. Au petit matin, nous survolons la Russie.
Encore bénéficiaire d'une fenêtre, j'aperçois
les croupes arrondies de l'Oural qui dépassent des nuages. Elles
sont encore largement couvertes de neige. Plus tard, j'identifie nettement
le Lac Ladoga et Saint-Petersbourg. J'aurais du mal à mettre un
nom sur les paysages plats qui suivent. Nous survolons probablement les
pays baltes. Puis, la Baltique, le sud de la Suède et nous pénétrons
sur le continent, sans doute à la hauteur du Danemark. Le reste
ne mérite pas la peine d'être conté.
. Quel regard jeter de Paris sur mon voyage? J'avoue être resté quelque peu sur ma faim. L'Australie est un pays beaucoup trop vaste pour espérer en épuiser les charmes en deux petites semaines. Il faudrait être bien présomptueux pour penser connaître en si peu de temps un pays aussi vaste qu'un continent. D'autant que le transport absorbe un temps non négligeable. Alors, augmenter la durée du séjour, revenir plusieurs fois dans le pays? En aurai-je l'occasion? Il y a tant de lieux que je ne connais pas encore dans notre vaste monde. Je pense que mon voyage aurait été plus productif s'il y avait eu moins de journées libres et un découpage différent. J'aurais préféré, par exemple, rester un peu plus longtemps dans le désert et un peu moins à Cairns. Mais les amateurs de plage seraient certainement d'un avis contraire. Pour terminer, voici deux animaux très
spéciaux dignes de susciter la curiosité même des plus
blasés. On ne peut guère les voir que dans les aquariums.
Le premier est une sorte de loutre à bec de canard qui a réussi
le tour de force d'être à la fois ovipare et mammifère.
C'est même le mammifère le plus primitif de la planète.
La femelle ne possède pas de tétines et les petits se nourrissent
du lait qui suinte à travers sa peau. L'Ornithorynque, c'est son
nom, vit au nord de l'Australie où il se nourrit d'écrevisses,
de limaces et de petits invertébrés. Il fréquente
à la fois les berges et le fond des étangs et des rivières.
Le second vit, quant à lui, dans l'océan, au sud du pays.
C'est une sorte d'hippocampe pourvu d'ailes qui ressemblent à des
feuilles d'algues, ce qui lui permet de se dissimuler facilement parmi
ces dernières. On le nomme le Dragon de Mer. Ces deux créatures
me paraissent tout à fait symboliques des curiosités naturelles
de l'Australie.
Remarques: pour illustrer ces notes, j'ai utilisé mes photos ainsi que des images extraites des dépliants touristiques qui m'ont été remis. Ce faisant, je ne pense pas avoir causé de préjudice à qui que ce soit. Dans le cas contraire, je retirerais évidemment les clichés contestés. |