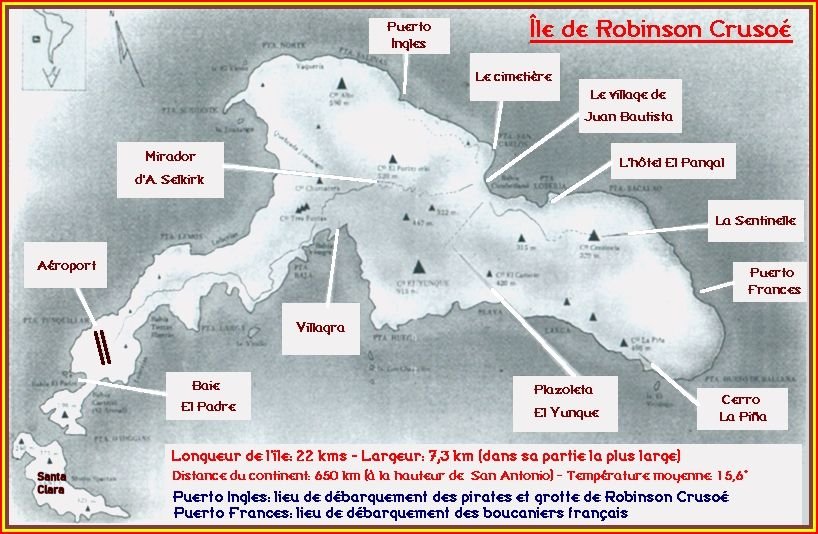
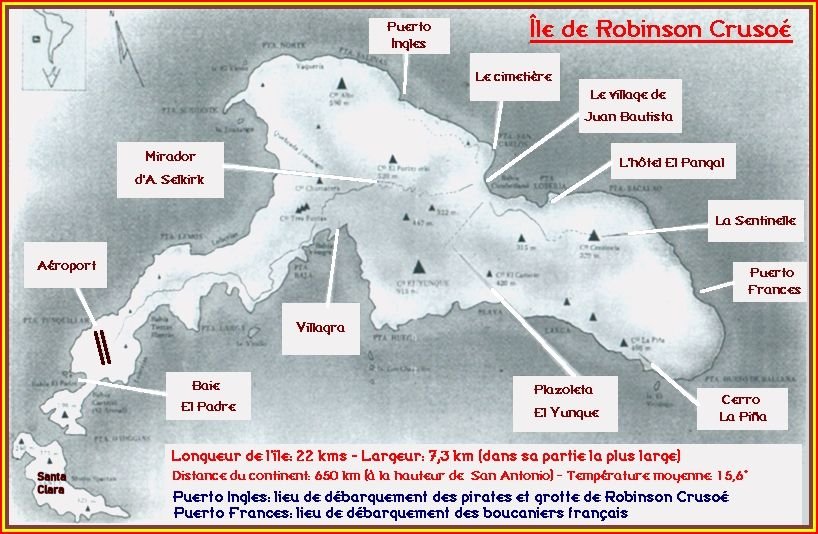
| L'île de Robinson Crusoë (ou Crusoé)
fait partie de l'archipel Juan Fernandez, découvert officiellement
le 22 novembre 1574 par le navigateur espagnol qui lui donna son nom. Toutefois,
Isaac James, auteur de Providence Displayed or The remarkable
adventures of Alexander Selkirk... London, 1800, qui est moins précis,
la situe aux environs de 1572. Cette découverte aurait eu lieu lors
d'un voyage de Lima à Valdivia. L'archipel était si isolé
que l'on soupçonna celui qui le trouva d'avoir passé un pacte
avec le diable!
Il est localisé dans l'Océan Pacifique, à une distance de 650 à 800 kilomètres des côtes chiliennes, à peu près à la hauteur de Valparaiso. Il représente une superficie d'une centaine de kilomètres carrés et se compose de trois îles. L'île de Robinson Crusoë, la plus longue et la seule peuplée, la plus proche aussi de la terre, fut d'abord appelée pour cette dernière raison Mas a Tierra, mais les marins qui la fréquentèrent lui attribuèrent plutôt le nom de l'archipel : Juan Fernandez; elle mesure 22 km de long pour 7,3 km de large et culmine à 915 m, au mont Yunque; sa superficie avoisine 48 km2. La seconde île en importance, Alejandro Selkirk, mesure 10,5 km de long sur 6 de large; elle est massive et culmine au mont Los Innocentes (1320 m) dont le sommet est parfois couvert de neige; comme elle est la plus éloignée du continent, on l'appela d'abord Mas a Fuera; sa superficie atteint 49,52 km2. La troisième, Santa Clara, ou l'île aux chèvres, n'occupe qu'une superficie médiocre de 2,23 km2 et se situe à côté de l'île de Robinson Crusoë, au sud-ouest. On ne peut joindre l'île de Robinson Crusoë qu'en avion ou en bateau. Plusieurs compagnies d'aviation la desservent avec des appareils d'une dizaine de place. Ils ne partent que s'ils ont des passagers ou du fret et si les conditions atmosphériques s'y prêtent. Le départ comme le retour de ces envolées sont donc sujets à aléas. Quant au bateau, il s'agit d'une unité de la marine chilienne qui fait le voyage Valparaiso-Juan Bautista, l'unique village de l'île, une fois par mois. Pendant plusieurs mois de l'année, de l'automne au printemps, l'île est totalement coupée du continent. Malheur à celui qui rate le dernier avion ou le dernier bateau. Il ne lui reste plus qu'à attendre le retour du beau temps. En attendant mon avion, à l'aéroport de Santiago, je fais la connaissance d'un Français qui vit actuellement sur l'île. C'est un ancien soldat d'Indochine et d'Algérie qui a ensuite pas mal baroudé en Afrique et en Asie, pour le compte secret du gouvernement français, certain d'être désavoué si l'affaire tournait mal, comme Bob Denard, qu'il connaissait. Depuis son jeune âge, il était hanté par l'idée de visiter un jour l'île de Robinson Crusoë. Une fois retraité, il put enfin mettre son projet à exécution. A son arrivée, il dormit quelques jours dans la grotte de Robinson. Mais la présence des rats le gênait. Ces animaux pullulent sur l'île. Ils sont énormes à faire peur aux chats. Il finit par battre en retraite et regagner le village. Il y rencontra un Suisse qui souhaitait se défaire de la maison qu'il y possédait. Il la lui acheta et, depuis, il vient passer l'hiver européen dans l'île tous les ans, en prenant bien soin de quitter les lieux à temps. Il n'empruntera pas le même vol que moi. Nous nous retrouverons sur l'île. Nous prenons place dans l'appareil. Il y a cinq passagers : deux Allemands et trois Français. Le plus âgé des Français est un ancien officier de marine, il a servi en Indochine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le second est un architecte néo-calédonien. Il vit en Australie qu'il qualifie de dernier continent blanc, et déteste les Caldoches, à cause de l'engagement de leurs ancêtres dans la Commune de Paris et de leur engouement présent pour les communards; il se flatte d'être l'auteur d'un texte où il a sévèrement étrillé les révolutionnaires de 1871; je le mets en porte à faux, en lui faisant observer que, parmi les combattants de la Commune de Paris, il y avait aussi des militaires patriotes qui refusaient la défaite et le renoncement versaillais. Le troisième Français, c'est moi. Quant aux Allemands, je m'apercevrai que le plus âgé se méfie de tout ce qui rappelle le régime nazi, au Chili comme ailleurs. Mes compagnons de voyage étaient en croisière dans le sud du Chili, sur un bateau russe; le bateau a touché un rocher; une voie d'eau s'est déclarée et la croisière a été interrompue. Comme dédommagement, ils viennent sur l'île de Robinson Crusoë pour la visiter, mais aussi pour aller chasser des chèvres sauvages sur Santa Clara, l'île aux chèvres voisine. Après environ trois heures de vol, nous approchons de notre destination. L'île, vue du ciel, offre au regard des nouveaux venus un paysage rocheux assez peu engageant. Nous avançons vers un plateau étroit et bosselé, supporté par de très hautes falaises, au sud-ouest de l'île. Nous atterrissons sur son unique piste. Cette piste de terre est récente. Elle a été tracée entre les deux falaises à proximité immédiate des collines. Elle est légèrement incurvée en son milieu. Les pilotes doivent faire preuve d'une certaine dextérité et ne peuvent évidemment l'aborder que par temps dégagé. En cas d'erreur, ce serait le choc dans la falaise ou le plongeon dans la mer. Évidemment, il n'y a, sur cet aérodrome de fortune, aucune installation digne de ce nom. Une fois passagers et bagages à terre, le pilote attache l'avion à un piquet avec une corde, comme une chèvre! L'aéroport est très éloigné de l'unique village de l'île, situé au nord-est. La topographie de l'île est tellement accidentée, qu'il n'existe nulle part d'autre endroit où un avion puisse se poser et décoller. La piste occupe toute la largeur du plateau. Celui-ci est à peu près stérile. Il constitue un élargissement d'une branche de l'île, pointée comme un doigt vers Santa Clara. Un sentier mène, de cet aéroport sommaire à Juan Bautista, après plusieurs heures de marche, à travers une étendue désolée que l'on appelle le désert. Pour ce qui nous concerne, nous allons faire le voyage en bateau. On nous propose de descendre en voiture jusqu'au lieu d'embarquement, sur la baie du Padre. Nous préférons faire le chemin à pied. A proximité de l'aéroport, je remarque la présence d'un champ de pavots sauvages. J'apprendrai plus tard que les pigeons de l'île, qui nichent dans les falaises, se nourrissent de leurs graines, ce qui rend leur chair amère et impropre à la consommation. Nous prenons place sur le bateau, la lancha. Nous allons longer une grande partie de la côte nord de l'île. Des falaises, sciées par le vent et les intempéries, tombent à pic dans la mer. Elles sont très impressionnantes. De temps à autre, sur un bout de plage ou quelques rochers, nous apercevons des loups de mer, c'est-à-dire des otaries, qui prennent un bain de soleil. L'otarie de Juan Fernandez est une espèce endémique de l'île; lorsqu'en 1683 le boucanier William Dampier y fit escale, ces animaux étaient si nombreux qu'il n'y avait pas de baie ou de rochers abordables qui n'en fussent couverts. A partir du 17ème siècle, les eaux qui longent la côte chilienne furent malheureusement parcourues par les baleiniers; c'est d'ailleurs au large de l'île Mocha, plus au sud, que Melville situe la rencontre entre le capitaine Achab et Moby Dick; pendant plus de deux siècles, d'énormes cargaisons de peaux quittèrent la région pour la Chine ou l'Amérique du Nord; la population des otaries frôla l'extinction. Aujourd'hui, la colonie est protégée par les autorités. Après plus d'une heure de bateau, nous arrivons à Juan Bautista, le port et unique village de l'île, situé au fond de la baie de Cumberland. Il compte cinq à six cents habitants. Nombre d'entre eux s'adonnent à la pêche aux langoustes. On trouve sur l'île une station météorologique, un bureau de poste, quelques hôtels et deux ou trois représentants de l'ordre. L'île appartient au Chili. Le maire s'appelle Charpentier. Il est le descendant d'un naufragé français. Il y a aussi une famille de Rodt. Son ancêtre, arrivé sur l'île en 1867, aurait été le fils d'un baron suisse. Il fut gouverneur de l'île. Voici une description sommaire de ce village inspirée d'un autre voyageur, Bruce : "on dirait un village mexicain vers midi, la chaleur en moins. La vie s'écoule ici lentement et on peut errer sempiternellement au long des sentiers tracés par les pieds des hommes plutôt que par leurs pioches en méditant ou en jouissant de la beauté d'une nature presque vierge. Les habitants paraissent perdus hors du temps. Quelques maisons s'étalent autour de la baie de Cumberland et une pointe avancée grimpe à l'assaut de la montagne. Lors des gros orages, les cascades se transforment en torrents dévastateurs. l'île est le paradis des botanistes. Pourtant, les visiteurs sont rares." Notre hôtel est éloigné du village. On peut s'y rendre soit par un sentier qui longe les falaises, ou bien en barque. La première fois, nous optons pour la seconde solution. Après une traversée rapide et sans histoire, nous accostons le long d'un rocher qui sert de quai. La mer est agitée. La barque se rapproche et s'éloigne tour à tour du rocher. Mettre pied à terre est par conséquent quelque peu périlleux. Il faut attendre que l'esquif soit le plus proche possible du débarcadère de fortune et ne pas perdre de temps pour en profiter, sinon on risque le plongeon et même l'écrasement entre la barque et le rocher! Le débarquement de cinq passagers avec leurs bagages prend donc un certain temps. L'hôtel est sommaire. Mais peut-on espérer mieux dans un endroit aussi isolé? L'électricité est fournie par un groupe électrogène. Au milieu de la nuit, le groupe est arrêté et il faut s'éclairer à la bougie. Le soir, le garçon de l'hôtel allume un feu dans une grande cheminée et l'on peut se détendre et lire à la lueur du foyer. L'hôtel appartient à la compagnie d'aviation qui nous a amenés. Il est entre les mains d'une îlienne âgée qui tient les emplois de gérante, de cuisinière, de jardinière et de préposée au groupe électrogène. Il n'y a bien sûr pas de téléphone. Les communications avec le village s'effectuent par radio. Pendant notre séjour, on nous servira de la langouste presqu'à tous les repas, accommodée de diverses façons, y compris en soupe. C'est que ce crustacé, même s'il n'est pas donné, est moins cher sur l'île que la viande de boeuf. Manger de cette dernière constitue un luxe. Nous en aurons tout de même aussi; pour changer! Le tout sera accompagné des légumes et des herbes du jardin. La cuisine est rustique mais savoureuse, surtout avec un vin blanc chilien bien frais. Après le déjeuner, nous retournons
au village par voie terrestre. Le sentier
est escarpé. Il passe parfois juste au bord des falaises et,
à certains endroits, il est quelque peu dangereux. Attention à
ne pas glisser! Mais justement des arbres ont poussé là pour
arrêter avant la falaise celui dont le pied viendrait à manquer.
Je ne sais pas encore que ces arbres ne tiennent qu'à très
peu de terre et qu'ils n'offrent donc qu'une protection relative. C'est
réellement un chemin pour les mulets qui, dit-on, ont le pied sûr.
Ils sont d'ailleurs utilisés par les gens du village. Des vaches
paissent en liberté à flanc de montagne. Elles sont agiles
comme des chèvres et ne sont pas ferrées. Il n'empêche;
il arrive que l'une d'entre elles tombe dans la mer. On rencontrait également
autrefois de nombreuses chèvres sauvages. Mais elles sont plus rares
aujourd'hui. Il faut aller les chasser sur Santa Clara, l'île voisine
inhabitée. Par contre, les lapins pullulent presqu'autant que les
rats. On est à peu près certain d'en apercevoir quelques-uns,
pour peu que l'on séjourne quelques jours sur l'île. On pourrait
qualifier celle-ci de paradis des rongeurs. Le préposé à
la voirie du village est également braconnier. En fin de semaine,
il part avec sa mule dans la montagne où il a construit une cabane.
Il pose ses collets, dort sur place et, le lendemain, il relève
le gibier pris. Il rentre au village avec le dos de sa mule dégoulinant
de lapins, attachés deux à deux avec des ficelles. C'est
l'occasion de changer de menu : lapin contre langouste. Au hasard de notre
pérégrination, j'avise des troncs d'eucalyptus qui, privés
de leur écorce, exhibent un bois blanc semblant presque tendre.
Je remarque aussi l'arceau agreste
d'un rosier sauvage qui forme une courbe parfaite, assez majestueuse, et
abondamment fleurie, au long du chemin, comme pour nous rappeler que la
nature n'a pas besoin de notre aide pour dresser spontanément les
plus élégantes, et les plus ingénues compositions.
Les rues du village ne sont pas asphaltées. La meilleure est en ciment. L'ensemble de la voirie doit mesurer seulement quatre ou cinq kilomètres, et encore. C'est suffisant pour justifier l'existence de quelques voitures. La population augmentant, on est en train de construire une nouvelle église plus spacieuse. Sur la porte du bureau de poste un poète local affiche ses oeuvres. Dans un enclos, une chèvre rousse, très bien "banée" (en cornes), comme on dit dans mon Auvergne natale, broute tranquillement l'herbe à sa portée. Ce sera le seul spécimen de cet animal qu'il me sera donné de voir sur l'île. Il n'en reste presque plus et les dernières se sont réfugiées dans des endroits très difficiles d'accès. Je ne rencontrerai aucun "singe à tête de chat", autre animal de l'île, d'origine hypothétique. Je ne ferai qu'en entendre parler. Mais je pense qu'il s'agit du coati, un animal originaire d'Amérique latine amené de l'Uruguay, qui s'est parfaitement acclimaté dans l'île. Bruce en parle comme d'un ours mangeurs de souris; il cite aussi les fardeles, des oiseaux locaux. La flore et la faune de l'île sont effectivement très riches. Pour ce qui concerne la végétation, on parle à juste titre de Galapagos de la flore; soixante quatre pour cent des plantes y sont endémiques, ce qui représente le plus fort taux du monde. Et pour ce qui concerne les animaux, on peut lire ici l'article : Aperçu de la faune de l'archipel Juan Fernandez au Chili, de Philippe Danton - Publications de la Société Linnéenne de Lyon - Année 2002 - 71-9 - pages 335-354. Dans cet article, on apprend que, comme en beaucoup d'autres lieux, les animaux introduits volontairement ou non par les navigateurs ou les colons, ont causé des problèmes et des dégâts à la flore et à la faune endémiques. C'est le cas, notamment, des rats, des chats, des chèvres, des vaches amenées par les colons au 19ème siècle et qui se gardent toutes seules en épuisant les herbages, des lapins qui se sont multipliés après que quelques-uns aient été lâchés inconsidéremment pour que les chasseurs s'adonnent à leur plaisir favori, et des chiens qui, parfois, redeviennent sauvages. Voici ce que dit Philippe Danton de ces derniers. Canis familiaris, le chien domestique, semble-t-il, accompagne l'homme partout où il va. Dans l'Histoire il fut même employé par les Espagnols qui lâchèrent des molosses dans les îles afin que ceux-ci déciment les populations de chèvres qui servaient de ravitaillement aux navires anglais. Aujourd'hui les chiens ensauvagés ont disparu et les gardes du Parc veillent à ne pas laisser divaguer les errants. Mais parfois, comme cette nuit du 21 au 22 janvier 2001, une bande de chiens "fous" fit la route depuis le village de San Juan Bautista jusqu'à la loberia de Tierras Blancas, à la pointe ouest de l'île Robinson Crusoë, et massacra littéralement environ 200 otaries de tous âges. Je visitai les lieux de ce carnage le 24 janvier et garde le souvenir d'un monceau de cadavres incroyable, d'une pestilence insupportable, d'un monstrueux nuage de mouches bourdonnantes et d'un tapis épais de grouillants asticots. Les chiens coupables furent abattus pour qu'ils ne recommencent pas et qu'ils n'en entraînent pas d'autres. Mais beaucoup de bons toutous vivent paisiblement au village ou ils servent de compagnie et d'auxiliaires de chasse. Ils sont aussi à l'origine des nombreuses puces qui infestent le village. Visite du cimetière. Une stèle, en l'honneur des marins morts, y rappelle un épisode peu connu de la guerre de 14-18. Le 15 mars 1915, le croiseur Dresden, de la marine allemande, qui s'était réfugié dans la baie de Cumberland, fut rejoint par plusieurs bâtiments de la Royal Navy. Ceux-ci tirèrent sur lui. Des obus se fichèrent dans la falaise, de part et d'autre de la baie, sans toujours exploser. On peut les y voir encore. Le capitaine du navire allemand essaya de gagner le temps nécessaire pour sauver ce qui restait de son équipage et saborder son navire. Les marins se réfugièrent sur l'île et le bateau sombra avec son chargement. On parle d'un trésor. Son exploration a coûté la vie à un plongeur. Les marins allemands restèrent sur place jusqu'à la fin des hostilités. L'un d'entre eux fit le serment de revenir. Il tint sa promesse en 1931. Il obtint un terrain de la municipalité à trois kilomètres de la bourgade, au lieu dit la Plazoleta. Il y construisit une maison et se livra à la culture des arbres fruitiers. Un an plus tard, il fut rejoint par une Allemande qu'il épousa. Tout allait bien pour eux quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut interrogé par un journaliste qui publia un article le faisant passer pour un espion nazi. Contrariés par cette publicité intempestive, l'homme et son épouse décidèrent d'abandonner leur plantation; ils regagnèrent le continent où ils s'établirent. On voit que, malgré son isolement, l'île n'est pas restée complètement à l'écart des deux conflits mondiaux. Lorsque le Chili rejoignit le camp des alliés, au début des années quarante, l'Île de Robinson Crusoë fut même fortifiée pour résister à une éventuelle incursion japonaise. Des canons y furent installés. On peut encore les voir sur le terrain boisé où se déroulent les festivités du village. Visite du musée: souvenirs d'Alexander
Selkirk, de Rodt, du Dresden etc...
Le soir, ma connaissance de l'espagnol me permet de servir d'interprète entre la patronne de l'hôtel et l'aîné des Allemands. Celui-ci, qui prétend avoir retenu une camarote (chambrette), ne veut pas payer la grande chambre qui lui a été attribuée. Notre hôtesse se fait tirer l'oreille. Elle prétend qu'elle n'a pas le droit d'accorder de rabais, sans risquer de perdre son emploi, en s'attirant les foudres de la compagnie d'aviation propriétaire des lieux. Nous finissons cependant par trouver un arrangement. Il n'y a pas foule à l'hôtel dont nous sommes les seuls clients. L'Allemand déménage de sa grande chambre pour une camarote et obtient l'ajustement du prix qu'il demandait. Le lendemain matin, nous allons visiter la grotte de Robinson Crusoë. On vient nous prendre en barque car l'accès à la grotte par la montagne est devenu dangereux. Nous débarquons sur une plage de galets, au port des Anglais. Puis nous passons sous une sorte de porche en forme d'arche creusé par la mer, avant d'atteindre le terrain où est située la grotte. De l'autre côté de ce passage, improvisé par la nature, s'étend une prairie ornée d'un bouquet de peupliers, dès que la plage prend fin. La grotte est protégée d'assez loin par un muret de galets noirs. Elle fait semblant d'être fermée par un squelette de porte construit avec quelques branches qui ne cachent rien. Un mur bas prolonge cette porte à claires-voies. Mur et porte laissent passer généreusemement l'oeil, l'eau et le vent. A l'écart de la grotte, quatre murs rappellent l'ambition de construire là un édifice qui resta inachevé. Dans une petite chapelle se dresse la statue peinte d'une Vierge de Solitude. C'est ici que le marin écossais Alexander Selkirk (ou Selcraig) fut abandonné, en octobre 1704, par le capitaine du vaisseau sur lequel il servait. Pendant quatre ans et quatre mois, il vécut sur l'île comme il le put, se nourrissant de végétaux et de chair de chèvre sauvage, s'habillant de la peau séchée des animaux tués. Il se rendait fréquemment au mirador, un point élevé de l'île, dans l'espoir d'apercevoir une voile libératrice sur l'immensité de l'Océan. Un jour, ses voeux furent exaucés. Il se précipita en direction de la côte où il fut accueilli à coups de mousquet. Les nouveaux venus étaient Espagnols et il dut regagner promptement la protection des sous-bois. Il attendit encore de longs mois avant qu'un bâtiment britannique, celui de l'expédition Woodes Rogers, ne fasse escale dans l'île, en 1709, et le ramène dans sa patrie. Il y retrouva sa famille et vécut quelque temps avec elle. Mais, le séjour sur l'île l'avait si fortement marqué, qu'il construisit, dans le jardin de la maison familiale, une réplique des accomodements de son île, pour y retrouver la solitude à laquelle il s'était accoutumé. Plus tard, il reprit du service dans la marine anglaise, comme on le verra ci-après. Alexander Selkirk est le plus connu, mais non le seul, habitant plus ou moins solitaire de l'île. D'après Isaac James, une pêcherie indienne d'une douzaine de personnes y aurait été installée vers la fin du 16ème siècle, mais elle n'existait déjà plus en 1616, lorsque Schouten descendit sur l'île. Elle aurait été ensuite, pendant un temps, possession des Jésuites qui l'auraient louée à un officier désirant y pratiquer la pêche et surtout l'exploitation de la peau des animaux marins. L'île, abandonnée, devint ensuite une station régulière des boucaniers et des pirates qui se livraient au pillage des galions et des villes de la côte du Pacifique appartenant aux Espagnols, d'où sans doute les noms de Puerto Ingles et Puerto Frances. En 1624, Jacques l'Hermite, qui commandait la flotte du Nassau y aurait laissé, à leur demande, trois soldats et trois sous-officiers malades dont ont ne sait pas ce qu'ils devinrent. Ensuite, en janvier 1681, alors que l'on racontait déjà entre marins l'histoire d'un naufragé qui vécut sur l'île cinq ans avant d'être sauvé, l'équipage d'un corsaire, dont Dampier faisait partie, fut contraint de lever précipitamment l'ancre, sous la menace de voiles adverses apparues au large. Le 12 janvier, il y oublia un de ses membres, un Indien Moskito, qui ne fut rapatrié que trois années plus tard. L'aventure de cet Indien rappelle sur plusieurs points celle de Selkirk. En 1687, cinq marins de Davis, qui avaient perdu tout leur argent au jeu, décidèrent d'y rester, espérant s'engager dans un autre bateau corsaire qui y relâcherait pour se refaire avant de rentrer en Angleterre; ils étaient accompagnés de quatre Noirs; bien pourvus par leur bateau, ils demeurèrent sur l'île deux ans et dix mois, non sans être inquiétés par les Espagnols; ils furent sauvés par le capitaine Strang, le 11 septembre 1690. Des boucaniers français y résidèrent alors pendant une dizaine de mois. On le verra plus loin, deux hommes du capitaine Stradling, qui devait y laisser Selkirk, y séjournèrent cinq à six mois, en 1704. Plusieurs personnes avaient donc séjourné plus ou moins longtemps sur cette île perdue au milieu du Pacifique. Après Selkirk, le 7 octobre 1719, le capitaine Cliperton y déposa deux hommes pour prendre possession des abris du marin écossais; mais ils furent retirés de l'île deux mois plus tard. Les récits de ces faits divers ont nourri l'imagination de Daniel Defoe. Mais le roman de Robinson Crusoë reste une fiction, même si celle-ci est agrémentée de détails authentiques (une notice sur l'île, sur Alexander Selkirk et le roman de Defoe peut-être lue ici). Voici le récit des aventures de l'Indien Moskito raconté par le capitaine William Dampier dans son ouvrage A New Voyage Round the World - Adam and Charles Black - 4, 5 & 6 Soho Square - London -1937. Le 22 mars 1684, nous arrivâmes en vue de l'île, et le lendemain nous parvînmes dans une baie à l'extrémité sud de l'île, et par 25 brasses d'eau (environ 30 m), à deux encâblures du rivage (400 m). Nous sortîmes alors notre pirogue, et nous descendîmes à terre pour tenter de retrouver un Indien Moskito que nous avions laissé sans le vouloir, en 1681, pressés que nous étions par trois navires espagnols qui nous chassaient de l'île, un peu avant notre appareillage pour l'Afrique; Le Capitaine Watling, qui avait succédé au capitaine Sharp, déposé par une mutinerie, était alors notre commandant. Cet Indien vivait seul ici depuis plus de trois ans et, bien qu'il ait été plusieurs fois recherché par les Espagnols, qui connaissaient sa présence sur l'île, ils ne purent jamais s'en saisir; on eût dit une ombre qui s'évanouissait comme un fantôme. Il était dans les bois à la recherche de chèvres quand le capitaine Watling retira ses hommes, et le navire était sous voile avant qu'il n'ait pu revenir à la côte. Il avait avec lui son arme et un couteau, avec une petite corne de poudre et quelques coups de feu; une fois ceux-ci épuisés, il employa son couteau pour mettre en pièces le canon de son arme dont il fit des harpons, des lances, des crochets et un long couteau, chauffant les pièces au feu, puis les frappant avec sa pierre à fusil, et un morceau du canon de son arme, préalablement durci; il avait appris cela des Anglais. Les morceaux de fer chauds qu'il martelait, se pliaient comme à plaisir sous les coups de pierre, et il les sciait avec son couteau dentelé ou en meulait l'un des côté sans ménager sa peine pendant de longues heures; il les durcissait à la température requise dès qu'il en avait l'occasion. Tout cela semblera étrange à ceux qui ne connaissent pas la sagacité des Indiens; mais ce n'est rien de plus que ce que les Moskito pratiquent usuellement dans leur propre pays, où ils fabriquent leurs instruments de pêche et leurs outils de frappe, sans forge ni enclume, mais en y consacrant beaucoup de temps. D'autres Indiens sauvages qui n'ont pas recours au fer, que les Moskito tiennent des Anglais, confectionnent des haches de pierre très dure, avec lesquelles ils abattent des arbres (l'arbre à coton, en particulier, dont le bois est tendre et doux) pour construire leurs maisons ou faire des canots ; et, bien qu'en travaillant leurs canots creux, ils ne puissent pas les creuser aussi proprement et aussi finement qu'avec des outils de fer, ils parviennent néanmoins à les rendre aptes à remplir leur fonction en complétant le travail de la hache par le feu, que ce soit pour abattre les arbres ou pour approfondir l'intérieur de leur pirogue. Ces moyens sont utilisés en particulier par les Indiens sauvages de la rivière Bluefield, dont j'ai vu des pirogues et des haches de pierre. Ces haches de pierre mesurent environ 10 pouces de long (25 cm), 4 de large (10 cm) et 3 pouces (7,5 cm) d'épaisseur au milieu. Elles ont leurs faces bien plates et coupent aux deux extrémités : au milieu, ils pratiquent une entaille, si large et si profonde qu'un homme peut y mettre la longueur de son doigt; ils y fichent un bâton d'environ 4 pieds de long (1,2 mètres), ils le lient autour de la tête de la hache, dans cette encoche, en serrant bien fort, pour utiliser le bâton comme un manche ; la tête est tenue ainsi très fermement. Les autres Indiens sauvages ne sont pas moins ingénieux. Ceux de Patagonie coiffent leurs flèches avec du silex ou d'autres matières dures d'une façon que j'ai eu l'occasion de voir et d'admirer. Mais retournons à notre Moskito sur l'île de Juan Fernandez (Mas a Tierra). Avec les instruments qu'il avait ainsi fabriqués, il se procura toutes les ressources que l'île lui offrait , chèvres ou poissons. Il nous affirma, qu'au début, il avait été contraint de manger du phoque, une viande très ordinaire, avant d'avoir confectionné des hameçons : mais par la suite, il ne tua jamais plus de phoques, mais il en tira des lignes, coupant leur peau en lanières. Il construisit une petite maison ou une hutte à environ un demi mile de la mer (800 mètres), couverte de peaux de chèvre ; sur sa couche, ou plutôt son barbecue de bâtons, élevé à environ deux pieds du sol (60 centimètres), des peaux de chèvres constituaient également toute sa literie. Il n'avait plus de vêtements, après avoir usé ceux qu'il portait en quittant le bateau de Watling, mais seulement une peau à sa taille. Il vit notre navire la veille de notre arrivée alors que nous jetions l'ancre, et il pensa aussitôt que nous étions des Anglais, et tua donc trois chèvres le matin avant notre venue, et il les accommoda avec des choux (des choux palmistes), pour bien nous traiter quand nous serions à terre. Il vint ensuite en bord de mer pour saluer notre débarquement. Quand nous atteignîmes la plage, un Indien Moskito de notre compagnie, nommé Robin, sauta à terre et, courant vers son frère de race, se jeta à plat, face contre terre, le visage à ses pieds, l'autre l'aida à se relever, l'embrassa, et tomba à son tour à plat, visage au sol, aux pieds de Robin, qui le releva. Cette scène inattendue nous divertit beaucoup, nous fûmes émus par la tendresse et la solennité de cette rencontre, extrêmement affectueuse de part et d'autre; et quand leurs civilités furent terminées, nous cédâmes à l'ambiance et nous mîmes tous à embrasser cet homme que nous venions de retrouver, lequel était ravi d'être entouré d'autant de ses vieux amis venus ici délibérément le chercher, comme il le pensait visiblement. Il s'appelait Will, l'autre Robin. Ces noms leur avaient été donnés par les Anglais, car, entre Indiens, ils n'avaient pas de noms; ils considéraient comme une grande faveur d'être nommés par quelqu'un d'entre nous; et ils se plaignaient amèrement si nous refusions de les pourvoir d'un nom lorsqu'ils étaient parmi nous, en disant d'eux qu'ils étaient des hommes si pauvres qu'ils n'avaient même pas de nom. La grotte de Robinson, on l'a dit, est entourée par un enclos qui n'existait sans doute pas du temps de Selkirk. L'intérieur a été aménagé, par ce dernier ou quelqu'un d'autre. Des cavités ont été creusées dans la paroi pour recevoir des objets. A peu de distance de la grotte, s'élèvent les murs de pierres sèches d'une construction inachevée. A côté, se trouve une statue de la Vierge de la Solitude. Sur le bord de la mer gît un canon ancien, la gueule tournée vers la terre. Nous regagnons l'hôtel par la voie terrestre. Chemin faisant, j'aperçois une ronce courbée qui dessine sur le ciel un assez joli arc de feuillage. Je ne peux résister à la tentation de la fixer sur la mémoire d'argent de ma pellicule. Le lendemain, entre Français, et toujours par voie terrestre, nous rendons visite à notre ami, le baroudeur, rencontré à l'aéroport de Santiago. Il nous offre une bière. Les Allemands sont partis effectuer une longue randonnée dans les cerros. Le jour suivant, l'aîné des Allemands prétend qu'il est malade pour regagner le plus rapidement possible la vie civilisée. En fait, il s'ennuie. Après avoir pris congé de lui à l'embarcadère, nous gravissons, les quatre encore présents, le sentier qui mène au mirador d'Alexander Selkirk. L'Allemand, plus jeune, prend les devants. J'attends notre vétéran. Il a 78 ans, s'aide d'un bâton et arrivera, bien sûr, le dernier. Plusieurs passages sont assez difficiles pour une personne âgée : des rochers doivent être escaladés. Lorsque j'estime avoir pris trop d'avance, je m'arrête et ne repars qu'en entendant le bruit du bâton de mon suivant frappant le sol. Je profite de ces arrêts pour admirer la végétation qui m'entoure. N'étant pas botaniste, je suis dans l'incapacité de mettre un nom sur les espèces variées qui foisonnent. J'apprendrai plus tard que des plantes inconnues ailleurs se trouvent sur ce coin de paradis terrestre. Protégées naturellement, sur des sommets inaccessibles aux prédateurs, en haut de falaises escarpées, certaines d'entre elles ont disparu des surfaces fréquentées de notre globe, depuis des millions d'années. Sur cette île, on a donc l'impression d'être au milieu d'un musée en plein air. Des oiseaux très jolis viennent se poser juste au-dessus de ma tête. Ils sont visiblement plus curieux que peureux. Après plus d'une heure d'efforts, nous parvenons enfin au col. Une plaque posée, sur le flanc d'une montagne en forme de pain de sucre, y rappelle le souvenir du marin écossais. D'ici, on a vue sur les deux côtés de l'île. C'est l'endroit idéal pour guetter l'apparition d'un navire. Le sentier que nous avons pris se poursuit en direction de l'aéroport. On voit nettement sa trace à flanc de montagne, à travers le désert. C'est le moment de revenir à la biographie d'Alexander Selkirk. Sa découverte sur cette île déserte a été décrite par le capitaine Rogers. Son ouvrage a été traduit en français et publié en Hollande sous le titre : Voyage autour du Monde commencé en 1708 et fini en 1711 par le capitaine Woodes Rodgers - Traduit de l'anglais - Deux volumes - A Amsterdam - Chez la veuve de Paul Marret - dans le Beurs-Straat à la Renommée - 1716. J'ai confronté cette traduction à l'original en anglais et, comme les versions ne coïncidaient pas parfaitement, je me suis permis quelques modifications de la version française ainsi que l'ajout de précisions et de remarques. Voici donc le résultat de ces adaptations. Le 28 janvier 1709, nous avons un temps assez doux. A six heures, nous apercevons la terre. La plus orientale, qui est à l'est quart nord-est, à neuf ou dix lieues de distances (environ 45 km), ressemble à une île. Les gens de la Duchesse (un bateau de la flottille, celui de Rogers s'appelait le Duc) vont mal. Il n'est pas douteux que cela provient du froid et de l'humidité qu'ils ont éprouvé faute de vêtements appropriés. Le 31, le vent souffle 24 heures de suite, sud-sud-ouest quart à l'ouest. Ce matin, à sept heures, nous faisons route vers l'île de Juan Fernandez qui se trouve à l'ouest-sud-ouest, à 7 lieues environ de distance (une quarantaine de km). A midi, elle est à l'ouest quart au sud-ouest, à 6 lieues. Nous prenons de la hauteur et nous nous trouvons sous les 34 degrés de latitude méridionale. Journal de ce qui se passa dans le mois de février 1709 avec une description de l'île de Juan Fernandez, où l'on trouva un Écossais, que le capitaine Stradling y avait laissé depuis plus de quatre années. Le 1er février, hier, environ deux heures après-midi, nous préparâmes notre pinasse. Le capitaine Dover y entra, avec un équipage, pour se rendre à terre, malgré les 4 lieues (un peu plus de 5,5 km) qui nous séparaient de la côte. Aussitôt Dover parti, je me rendis à bord du capitaine Courtney (Duchesse) qui s'étonna beaucoup du long trajet que devait effectuer notre pinasse. J'avouai n'avoir pas été favorable à cette initiative que j'avais acceptée uniquement pour faire plaisir au capitaine Dover. A l'approche de la nuit, nous vîmes une lumière sur le rivage. Incapables de savoir si ce feu venait de notre pinasse ou de quelqu'autre source, nous allumâmes tous nos fanaux pour lui servir de guide, et nous tirâmes un coup de canon avec plusieurs mousquetades, pour l'aider à nous retrouver, tandis que nous rangions la côte à l'abri du vent. Sur les deux heures du matin, le capitaine Dover nous rejoignit, après s'être approché à une lieue de l'île. Il monta à bord de la Duchesse qui le reçut à quelques distances de notre arrière. Nous fûmes bien aise de le revoir, car le vent commençait à fraîchir. Convaincus que le feu que nous voyions était sur l'île, et dans la pensée qu'il pourrait bien y avoir des vaisseaux français à l'ancre, nous résolûmes de les attaquer, pour faire de l'eau et des vivres, dont nous avions grand besoin. Le 2 février, avertis par le capitaine
Dampier que le vent du Sud règne d'ordinaire ici tout le long du
jour, nous attendîmes qu'il se levât, pour courir sur l'île.
(Remarque : le capitaine Dampier, familier
des lieux et connaissant bien les vents, joua un rôle primordial
dans l'accostage et la délivrance d'Alexander Selkirk).
Ce matin, après avoir passé au-delà, nous revirâmes
de bord, et, à dix heures, nous découvrîmes la côte
méridionale. Nous rangeâmes la terre. Nous essuyâmes
de si rudes bouffées en provenance du rivage que nous fûmes
contraints de bourcer (carguer)
nos voiles de perroquet, à la vue de la baie du milieu (baie
de Cumberland?) où nous comptions
trouver l'ennemi prêt à nous recevoir, mais il n'y en avait
point, pas plus que dans l'autre baie du nord-ouest. Ce sont les deux seules
baies où l'on puisse mouiller, mais la baie du milieu est de loin
la meilleure. Nous crûmes cependant qu'il y avait eu là des
bateaux qui s'étaient retirés à la vue des nôtres.
Vers les midi, nous envoyâmes notre gabare (une
autre traduction parle d'une yole) vers
l'île avec le capitaine Dover, Mr Frye, et six hommes, tous armés.
Nos deux vaisseaux, par ailleurs, louvoyaient pour entrer dans la baie,
et les rafales, qui fondaient sur nous du milieu de l'île, où
la terre est fort haute, nous contraignirent à lâcher notre
voile de perroquet et à employer tout le monde à tenir les
autres voiles, de peur que le vent ne les emportât. Mais aussitôt
ces bouffées passées, le vent s'assagit et ne souffla presque
plus. Comme notre gabare tardait à revenir, nous craignîmes
que les Espagnols n'eussent une garnison sur l'île et qu'ils ne la
retinssent, de sorte que nous y envoyâmes notre pinasse bien armée,
pour voir ce qu'il était advenu de la gabare. D'un autre côté,
j'arborai dehors une flamme pour servir de signal, et la Duchesse
leva le pavillon de France. Bientôt, la pinasse revint, avec quantité
d'écrevisses (sans doute des langoustes),
et un homme vêtu de peaux de chèvres, qui paraissait plus
sauvage que les animaux. C'était un Écossais, nommé
Alexander Selkirk, qui avait été maître à bord
du vaisseau les Cinque-Ports, et que le capitaine Stradling avait
abandonné sur cette île depuis quatre ans et quatre mois.
Le capitaine Dampier, qui s'était trouvé sur ce navire, m'affirma
que c'était le meilleur homme qu'il y eût sur ce navire, de
sorte que je l'engageai à me servir de contre-maître (pilote?).
Ce bon Écossais, à la vue de nos vaisseaux, qu'il supposa anglais, alluma le feu que nous avions remarqué sur l'île. Il avait vu passer bien d'autres navires, pendant le séjour qu'il y fit; mais il n'y en eut que deux qui vinrent y mouiller. Incertain sur leur nationalité, il s'en approcha pour les examiner; mais quelques Espagnols, qui avaient déjà mis pied à terre, tirèrent sur lui dès qu'ils le virent et le poursuivirent jusque dans les bois où il grimpa dans un arbre. Il n'y fut pas découvert, bien que ses poursuivants rôdassent aux environs, et qu'ils tuassent quantité de chèvres sous ses yeux. Il nous avoua d'ailleurs, qu'il eût mieux aimé se livrer à des Français, si un de leurs vaisseaux y eût abordé, ou s'exposer à mourir sur cette île, plutôt que de tomber entre les mains des Espagnols, qui n'eussent pas manqué de le tuer, où de le condamner aux mines, dans la crainte qu'il ne servît les étrangers à découvrir la Mer du Sud. Il nous apprit aussi qu'il était né à Largo, dans la Province de Fife, en Écosse; qu'il avait été destiné à la marine dès son enfance; qu'il fut mis sur cette île par le capitaine Stradling, à l'occasion d'un démêlé qui les opposa; qu'il résolut d'abord d'y rester plutôt que de s'exposer à de nouveaux chagrins, outre que le vaisseau qu'il montait était en mauvais état; que cependant, revenu à lui-même, il souhaita y retourner; mais que le capitaine ne le voulut pas. Il avait déjà touché à cette île au cours d'un autre voyage, pour y faire de l'eau et du bois; alors, on y avait laissé deux hommes, qui y vécurent six mois jusqu'au retour du vaisseau, qui était allé à la Mer du Sud, d'où il fut chassé par deux vaisseaux français qu'il y rencontra. Voici une brève biographie de Selkirk avant son séjour sur l'île de Robinson Crusoë inspirée du Dictionnaire biographique national, de George Atherton Aitken. Alexander Selkirk (1676-1721), naquit en 1676, septième fils de John Selcraig, tanneur et cordonnier, de Largo, Fifeshire, qui avait épousé Euphan Mackie en 1657. Encouragé par sa mère, à utiliser la forme du nom qu'il adopta, l'enfant manifesta dès son plus jeune âge un fort désir d'aller en mer. Il possédait une âme d'aventurier et un caractère affirmé qui ne le prédisposait pas à la vie monotone de savetier dans un village écossais. Mais en raison de l'opposition de son père, il resta à la maison jusqu'en 1695, date à laquelle les registres paroissiaux signalent qu'il fut cité à comparaître devant la Justice pour conduite indécente à l'église. Il éluda la convocation et l'on découvrit alors qu'il avait pris la mer. Il aurait participé à un essai de colonisation dans le nord du Panama; cette tentative, connue sous le nom de Désastre de Darien échoua par suite de la mort d'une grande majorité des colons à cause de la famine et des maladies. On ne sait rien d'autre de lui jusqu'en 1701. A cette date, revenu à Largo, il se disputa avec ses frères et son père, et eut de nouveau mail à partir avec la Justice. L'année suivante, il navigua pour la marine britannique et, en mai 1703, il se joignit à l'expédition du capitaine Dampier qui se livrait à la guerre de course dans les mers du Sud. Son expérience était déjà assez considérable, pour qu'il soit nommé maître (pilote, contre-maître, second?) sur le navire les Cinque Ports, dont Charles Pickering était capitaine, avec pour lieutenant Thomas Stradling. Le nom normand médiéval de ce bateau se référait aux cinq ports principaux du sud de l'Angleterre à cette époque, Sandwich, Douvres, Hythe, New Romney, dans le comté de Kent et Hastings, dans celui du Sussex. En 1703, au large du Brésil, Pickering mourut, probablement du scorbut. il fut remplacé par Stradling à la tête du Cinque Ports. La flottille corsaire ayant éprouvé plusieurs mécomptes, l'entente était loin de régner au sein des équipages. Après la capture de quelques prises décevantes, la situation empira. Les échecs de l'expédition étaient imputés principalement au caractère indécis, quoique autoritaire, de Dampier. Ce dernier et Stradling se querellèrent et décidèrent de se séparer, en laissant la faculté à leurs hommes de choisir leur capitaine. Selkirk resta avec Stradling, espérant sans doute que le butin serait meilleur avec lui. La séparation s'effectua le 19 mai 1704, au large du Mexique. Selon Isaac James, vers 1687, les Espagnols avaient lâchés des chiens sur Juan Fernandez, située à 400 miles (environ 700 km) de Valparaiso, en espérant que ceux-ci la débarrasserait de ses chèvres qui attiraient pour leur chair les marins anglais. Mais les chiens ne purent venir à bout des chèvres qui se réfugièrent dans des endroits inaccessibles. Les biques osaient même parfois affronter les dogues. John Howell, dans son ouvrage, La vie et les aventures d'Alexander Selkirk, Edinburgh - Oliver & Boyd - 1829, décrit une scène de ce genre rapportée par un témoin oculaire : une meute de chiens se lançaient à l'assaut d'un troupeau de chèvres établi sur un plateau auquel seul un étroit passage donnait accès; le bouc le plus solide du troupeau se posta, cornes basses et jarrets tendus, à cette entrée qui n'était praticable que par un seul chien à la fois. Lorsque le premier des chiens y parvint, essoufflé et la langue pendante, un violent coup de cornes l'accueillit et le précipita sur ceux qui le suivaient; l'animal tomba de rocher en rocher jusqu'au bas de la pente où il arriva déchiré et pantelant; les autres n'insistèrent pas! Les marins anglais continuèrent donc de se rendre souvent sur l'île et plusieurs tentèrent de s'y établir où y furent laissés pour diverses raisons pendant un laps de temps plus ou moins long. Ils durent s'y défendre contre les Espagnols et les Français. Pendant leur périple autour du monde, Dampier et Stradling, avec Selkirk, y séjournèrent. Ils y laissèrent divers objets sous la garde de quelques hommes comptant les retrouver un peu plus tard. Malheureusement, des Français survinrent, attaquèrent les gardiens et s'emparèrent des objets. En septembre 1704, le Cinque Ports mouilla à Juan Fernandez. Cinq mois après son passage précédent, en compagnie de Dampier, Stradling n'y retrouva que deux des hommes qu'ils y avaient laissés. Un conflit opposa alors Selkirk à son supérieur. Le marin écossais avait été très impressionné par le rêve d'un naufrage qui avait perturbé son sommeil. On doit dire, qu'à cette époque, en Écosse, les septièmes enfants d'une famille étaient supposés bénéficier de certaines qualités extraordinaires, comme celle de lire dans l'avenir! Depuis ce rêve, Selkirk souhaitait radouber le navire dont la quille montrait des signes de vétusté. Il tenta en vain de gagner quelques marins à sa cause. Stradling s'y opposa violemment, se contentant de réparations sommaires. Selkirk, prévoyant le pire, décida de rester sur l'île, encouragé sans doute par l'expérience de ceux qui y avaient résidé plusieurs mois, espérant être sauvé par un navire de passage. Il débarqua d'abord sur la plage joyeusement, avec un sentiment de liberté, et prit congé de ses camarades dans l'euphorie. Cependant cette félicité optimiste ne dura pas longtemps. Dès que le navire s'apprêta à lever l'ancre, il regretta son choix et se précipita dans l'eau en priant Stradling de le reprendre à bord, mais de ce denier refusa. C'était la coutume sur les bateaux de course d'abandonner les mutins sur une île déserte en espérant qu'ils y mourraient de faim. Pour justifier l'absence de Selkirk, Stradling le porta disparu. Malgré l'hostilité qui séparait Selkirk de son capitaine, ce dernier ne se montra pas chiche et laissa au réprouvé beaucoup plus de moyens que n'en eurent la plupart des naufragés solitaires. Assis sur le coffre contenant ses hardes, notre marin désormais solitaire regarda tristement s'éloigner le Cinque Ports. Pendant plusieurs nuits, il ne dormit pas, et pendant plusieurs jours, il ne mangea point, toujours assis sur son coffre, l'oeil fixé sur l'horizon avec l'espoir de voir apparaître la voile salvatrice. Les tiraillements de son estomac le rappelèrent enfin à la raison et il se mit en quête de nourriture qu'il trouva d'abord dans la mer, en commençant par les coquillages absorbés crus. Revenons au récit de Rodgers. Quoi qu'il en soit, abandonné sur cette île, avec ses vêtements, son lit, un fusil, de la poudre, des balles, du tabac, une hachette, un couteau, un chaudron (ou une bouilloire), une Bible, et quelques livres de piété, ses instruments, livres et bouquins de marine, il s'occupa et pourvut à ses besoins du mieux qu'il put. Mais pendant les premiers huit mois, il eut beaucoup de peine à vaincre la mélancolie, et à surmonter l'horreur que lui causait sa terrible solitude. Il construisit deux cabanes, à quelques distances l'une de l'autre, avec du bois d'arbre à piment (poivrier); il les couvrit d'une espèce de jonc (autre version: de longues herbes pareilles à de l'avoine, liées de lanières de peaux de chèvres), et doubla ce toit avec les peaux des chèvres qu'il tuait, au fur et à mesures de ses besoins alimentaires, tant qu'il lui resta de la poudre. Lorsqu'elle se trouva proche de s'épuiser, il découvrit le moyen de tirer du feu avec deux morceaux de bois de piment qu'il frottait l'un contre l'autre sur le genou. On remarquera que Rodgers parle de deux cabanes, mais qu'il n'est pas question d'une grotte. Les cabanes de Selkirk devaient de toute façon être plus éloignées de la plage, par mesure de sécurité. La grotte qui se visite aujourd'hui, n'est donc vraisemblablement pas authentique et elle est visiblement inspiré de l'ouvrage de Defoe, pour satisfaire à peu de frais la curiosité des touristes! La fiction a dévoré son modèle à tel point, on le verra, que l'île où a vécu Selkirk s'appelle désormais Robinson Crusoë alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur celle que l'on a baptisé Selkirk! Pour ce qui concerne la Bible et les livres pieux, il s'agit peut-être d'une attention sournoise de celui qui a autorisé leur remise : ces ouvrages pouvaient-ils être mieux placés qu'entre les mains d'une personne abandonnée sur une île déserte qui n'a plus qu'à s'en remettre à Dieu? Même si Selkirk a pu se réfugier quelques temps dans la grotte, il n'y resta certainement pas longtemps, tellement étaient gênants les hurlements sauvages et lugubres des animaux marins affalés sur la plage. D'après Isaac James, selon qui le nom
de Selkirk en celte évoquerait une église dans les bois,
le marin écossais aurait songé au suicide, mais, grâce
à la religion, il aurait fini par accepter son sort. Sa période
de dépression aurait duré de 8 à 18 mois selon les
auteurs. Le retour à la religion dans la solitude n'est pas spécifique
à notre marin écossais. D'autres naufragés l'éprouvèrent
aussi, comme le signale aussi Isaac James; lorsqu'ils furent retrouvés,
ils acceptèrent de monter sur le navire qui les tirait de leur exil,
espérant convertir leurs sauveteurs, mais ce sont ceux-ci qui les
retournèrent et ils sombrèrent à nouveau dans l'ivrognerie
et la débauche! Il existe cependant à ma connaissance un
exemple contraire, celui des descendants des mutins de la Bounty
qui, outrés des moeurs relâchées en vigueur à
Tahiti, quand on les y ramena, retournèrent à Pitcairn, où
ils s'étaient réfugiés et avaient vécu pendant
des années après leur révolte, ou préférèrent
aller s'installer ailleurs.
Il cuisinait dans la plus petite des huttes, et il dormait dans la grande, y chantait des psaumes et priait Dieu. Jamais de sa vie il n'avait été si bon chrétien, et il désespérait même de l'être autant à l'avenir. Accablé d'abord de tristesse, ou par manque de sel et de pain, il ne mangeait jamais qu'à toute extrémité, lorsque la faim le pressait, et il ne se couchait que lorsqu'il n'était plus en état de soutenir la veille. Le bois de piment servait à cuire sa viande et à l'éclairer, et son odeur aromatique l'aidait à remonter son esprit abattu. Il ne manquait pas de poisson; mais il n'osait pas en manger sans sel, parce que cela lui causait du dévoiement d'entrailles, sauf les écrevisses de rivière, qui sont ici d'un goût exquis, et aussi grosses que des homards (des langoustes probablement). Tantôt il les mangeait bouillies et tantôt grillées, de même que la chair de ses chèvres, dont le goût n'est pas si prononcé que chez nous. Il en tirait un excellent bouillon. Il tenait une comptabilité des chèvres tuées. Il en avait occis au moins cinq cents et attrapé autant qu'il avait marqué à l'oreille avant de les relâcher. L'arbre à piment donne en brûlant une lumière claire et répand une odeur agréable ce qui incita notre proscrit à s'en servir comme bois de chauffage et comme chandelle. Quand la poudre lui manqua, il attrapa les chèvres la course. Sa manière de vivre et l'activité continuelle à laquelle il s'adonnait, l'avait libéré de toutes ses humeurs malsaines. Il s'était rendu si agile, par cet exercice continuel, qu'il courait à travers bois, sur les rochers et les collines, avec une étonnante aisance et à une vitesse incroyable. Nous en eûmes la preuve lorsqu'il chassa pour nous, avec un chien (un bulldog), que nous avions à bord dressé au combat des taureaux. Il dépassait le chien à la course et battait nos meilleurs coureurs. On lui adjoignit le chien et nos hommes les plus agiles afin de l'aider à chasser les chèvres; il distança le chien et les hommes, prit les chèvres, et nous les rapporta sur son dos! Il nous avoua qu'il s'en fallut un jour de peu que son agilité ne lui coûtât la vie. Il poursuivait une chèvre avec tant d'ardeur, qu'il saisit l'animal sur le bord d'un précipice que des buissons lui cachaient, et culbuta du haut en bas avec elle. Il fut si commotionné et meurtri, qu'il en perdit connaissance. Enfin revenu à lui, il trouva la chèvre morte en dessous de lui. Elle avait amorti sa chute. Il resta près de vingt-quatre heures sur place, et ne parvint ensuite qu'à se traîner avec beaucoup de peine vers ses cabanes, qui étaient bien à un mile (1,6 km). Il y resta une dizaine de jours avant d'en ressortir. Isaac James a écrit que Steele porte
de vingt-quatre heures à trois jours le délais pendant lequel
Selkirk fut incapable de bouger après sa chute. John Howell, dans
son ouvrage, La vie et les aventures d'Alexander Selkirk, Edinburgh
- Oliver & Boyd - 1829, reprend également cette durée.
D'un autre côté, par un long usage, il en vint à savourer la viande sans sel et sans pain, et, en saison, il bénéficiât d'une quantité de bons navets, que les gens du capitaine Dampier y avaient semés, et qui couvraient encore, lorsque nous y étions, plusieurs arpents de terre. Il ne manquait pas non plus d'excellents choux, qu'il cueillait sur les arbres qui en portent, et qu'il assaisonnait avec du piment local, lequel se rapproche du poivre de la Jamaïque dont l'odeur est délicieuse. Il trouva également une sorte de poivre noir, appelé Malagita, qui est fort bon pour chasser les vents et guérir les gargouillis d'intestins. Comme on le verra plus loin, un autre témoin de la découverte de Selkirk, Edward Cook (Un voyage dans la Mer du Sud pendant les années 1708, 1709, 1710 et 1711 - Londres - 1712), pense que les navets ont été apportés sur l'île par les Espagnols, ce qui est aussi l'avis d'Isaac James. Après avoir surmonté sa mélancolie, il se divertit parfois en gravant son nom sur les arbres, et en notant de la même façon le temps écoulé depuis son abandon sur l'île. Les chats et les rats lui menèrent d'abord la vie dure; l'une et l'autre espèces s'étaient reproduites en grande quantité après être descendues des bateaux qui avaient fait escale ici pour s'approvisionner en bois et en eau. Les rats grignotaient ses pieds et ses vêtement durant son sommeil, ce qui l'obligea à cajoler les chats en leur offrant de la viande de chèvre; ainsi beaucoup d'entre eux s'apprivoisèrent-ils, et s'étendirent autour de lui par centaines, ce qui le délivra rapidement des rats. Il apprivoisa également quelques chevreaux et, pour se distraire, il put alors jouer, chanter et danser avec eux et avec les chats, de sorte que, grâce à la Providence et à la vigueur de sa jeunesse, étant alors âgé d'une trentaine d'années, il réussit à surmonter tous les inconvénients de sa solitude, et à être parfaitement à son aise. Parmi les autres divertissements de Selkirk,
Isaac James cite : compter les étoiles, une occupation interminable,
et fabriquer de nouveaux ustensiles, comme des cuillères en bois,
une activité de durée plus courte, mais certainement plus
gratifiante! Notre marin écossais était tourmenté
par l'idée que, s'il venait à mourir, il serait dévoré
par ses chats; aussi ne les laissait-il manquer de rien. Quant aux rongeurs,
on l'a déjà dit, l'île en foisonne toujours, rats et
lapins, ces derniers amenés plus tard!
Ses souliers et ses habits furent bientôt usés à force de courir à travers les bois et les broussailles; mais ses pieds s'endurcirent si bien à la fatigue, qu'il courait partout sans aucune peine. Après que nous l'eûmes trouvé, il ne put s'assujettir de quelques temps à porter des souliers, car ses pieds enflaient dès qu'il les mettait. Quand ses vêtements furent hors d'usage, il se fabriqua un juste-au-corps et un bonnet de peaux de chèvre, qu'il cousît ensemble avec de petites courroies, qu'il découpa sur le cuir avec son couteau, et un clou qui lui tint lieu d'aiguille. Il se confectionna aussi des chemises de quelque toile qu'il possédait, et il les piqua de la même façon avec son clou, et le fil qu'il tira de ses vieux bas qu'il dévidait selon ses besoins. Il en était à sa dernière chemise lorsque nous le rencontrâmes. Quand son couteau fut usé, il en forgea d'autres avec des cercles de fer qu'il trouva sur le rivage; il en fit plusieurs morceaux qu'il aplatit du mieux qu'il put et qu'il aiguisa ensuite en les frottant sur des pierres. En fait, ses vêtements furent probablement cousus à la façon des cordonniers, ainsi que son père le lui avait appris, le clou servant d'alêne. Quant aux couteaux tirés des cercles de fer, il en ramena un en Écosse qui ressemblait à une machette. Dans les premiers moments après son arrivée à bord, il avait si bien oublié l'usage de sa langue maternelle, qu'il ne prononçait les mots qu'à demi, et que nous eûmes d'abord assez de peine à le comprendre. Nous lui offrîmes du brandevin (ou du whisky?); mais il ne voulut pas en goûter de crainte qu'il ne lui fît mal, accoutumé qu'il était à ne boire que de l'eau. D'ailleurs, il se passa quelques temps avant qu'il ne pût manger notre cuisine avec plaisir. Outre ce qui a déjà été rapporté du produit de cette île, il nous parla de certaines petites prunes noires, qui sont excellentes, mais qu'il est malaisé de cueillir parce qu'elles croissent sur le sommet des montagnes et des rochers. Il y a quantité d'arbres à piment, et nous en vîmes quelques-uns qui avaient 60 pieds (18 m) de haut et deux verges environ de circonférence (1,8 m). Les cotonniers (arbres à coton) y sont plus hauts, et leur tige a près de quatre brasses de circonférence (un peu plus de 7 m). Le climat y est si bon, que les arbres et les plantes y conservent leur verdure pendant toute l'année. L'hiver ne dure que deux mois, en juin et juillet, on n'y voit même alors qu'une petite gelée avec un peu de grêle; mais il y a quelquefois de grosses pluies. La chaleur est égale et modérée en été, et il n'y a pas beaucoup d'orages ni de tempêtes. Notre Écossais n'y aperçut non plus aucune créature sauvage ou venimeuse, ni d'autres bêtes que celles dont nous avons déjà parlé. Juan Fernandez laissa le premier sur l'île quelques chèvres qui s'y multiplièrent de sorte qu'aujourd'hui elle en est pleine. Ce navigateur s'y établit avec quelques famille de sa nation quand le Chili passa sous domination espagnole, dans l'espérance d'en tirer profit. Une autre activité plus profitable incita sans doute ces colons à quitter ce lieu qui est cependant capable d'assurer la subsistance d'un assez grand nombre de personnes, et dont la défense est si forte qu'il ne serait pas facile de les en déloger. Ringrose, dans la relation qu'il a donnée du Voyage du capitaine Sharp et d'autres boucaniers, parle d'un vaisseau qui périt sur cette île, où le seul homme qui en réchappa vécut cinq années, jusqu'à ce qu'un autre vaisseau le reprit. Le capitaine Dampier cite aussi un Indien Mosquito qui fut laissé en 1681, sur l'île Juan Fernandez par le capitaine Watlin qui l'y retrouva en 1684, ce qui fait que ce Mosquito y demeura seul pendant plus de trois ans. Le premier qui descendit à terre fut l'un de ses compatriotes, et ils se saluèrent l'un l'autre en se prosternant vers la terre avant de s'embrasser. Mais quoi que l'on pense de cette dernière histoire, je suis convaincu que celle de Selkirk est authentique; et son comportement ultérieur m'a conforté dans cette opinion. La manière dont notre Écossais se gouverna par la suite me persuade qu'il y mena une vie fort chrétienne, qu'il nous dit la pure vérité à cet égard, et que seule la providence divine a pu le soutenir au milieu d'une si grande affliction. Son exemple montre que la solitude, et la retraite du monde, n'est pas un état si triste que la plupart des hommes se l'imaginent, surtout lorsqu'on y tombe par suite d'un accident inévitable. On voit aussi par là qu'un malheur en prévient quelquefois un autre beaucoup plus grand, puisque le vaisseau de son capitaine échoua peu de temps après, et que la majeure partie de l'équipage y périt. D'un autre côté, l'adresse dont il fit preuve pour satisfaire ses besoins, d'une manière aussi efficace, quoique moins commode que celle avec laquelle nous y parvenons avec l'aide de nos sciences et de nos arts, nous confirme cette maxime selon laquelle la nécessité est la mère de l'industrie. L'aventure vécue par Selkirk peut également nous instruire, en nous montrant combien un mode de vie simple et tempéré renforce la santé du corps et la vigueur de l'esprit, deux qualités que nous sommes susceptibles de détruire par abondance et excès, particulièrement en boisson fortement alcoolisée, aussi bien que par la variété et la nature de notre nourriture et de notre breuvage. Pour ce qui concerne cet homme, dès qu'il eut repris l'usage de nos viandes (au sens d'aliments) et de nos liqueurs, il perdit beaucoup de sa force et de son activité, preuve convaincante que la nourriture la plus simple et la tempérance entretiennent la santé du corps et la vigueur de l'esprit; au lieu que la variété de nos mets et de nos boissons, surtout pris avec excès, ruinent l'une et l'autre. Mais toutes ces réflexions morales sont plutôt du ressort des philosophes ou des théologiens, que de celui d'un homme de mer; ainsi, je reviens à mon sujet. Le 2 février (une autre version date ces événements du 1er février en soirée), il y eut des calmes, de sorte qu'il fallut touer nos vaisseaux jusqu'à l'ancrage, à un mille ou environ de la terre, où nous mouillâmes à six heures du soir, à 45 brasses d'eau (environ 82 m), sur un fond de sable propre. Le courant tourne ici au sud, et va le long du rivage. Après avoir plié nos voiles, nous les portâmes à terre, pour les raccommoder, et nous en servir à faire des tentes pour nos malades, qui étaient au nombre de 21, mais avec seulement deux en danger. La Duchesse en avait beaucoup plus, et en bien pire état que les nôtres. D'ailleurs, Selkirk, que nous appelions le gouverneur, ou plutôt le monarque absolu de cette île, eut soin de nous procurer deux chèvres, dont on fît d'excellent bouillon pour nos malades, après y avoir ajouté des feuilles de navets et d'autres verdures. Le 3. Hier soir, nous transportâmes la plupart de nos gens sur l'île, pour faire de l'eau et du bois (l'eau des navires était polluée à cause du mauvais état des barils, comme on le verra plus loin), pendant que d'autres s'employaient à réparer les vaisseaux. Tous nos voiliers s'occupèrent à rapiécer les voiles, et j'en fournis un à la Duchesse, qui en manquait. Ce matin, la forge de notre serrurier fut mise à terre; nos tonneliers s'y placèrent, et j'y fit dresser une tente pour mon usage. Nous formions tous ensemble un petit bourg, et chacun y travaillait d'une manière ou d'une autre. Il y avait ici d'excellent poisson et de plus d'une sorte, de celui que l'on appelle argenté, des berceurs, des meuniers, des cavallis, des vieilles, et tant d'écrevisses (autre version : goujons de mer, colins, poissons de roches, langoustes...), qu'en peu d'heures on pouvait en prendre pour rassasier quelques centaines d'hommes. Les oiseaux de mer, qui venaient dans la baie, étaient aussi gros que des oies; mais leur chair avait le goût du poisson dont ils se nourrissent. Notre gouverneur ne manquait jamais de nous amener deux ou trois chèvres par jour, qui étaient servies à nos malades. Le bouillon qu'on leur en faisait avec de la verdure, joint à la salubrité de l'air, ni trop chaud, ni trop froid, eût tôt fait de les guérir du scorbut, dont ils étaient presque tous attaqués. Nous prenions du plaisir à nous promener entre les arbres à piments verts, qui répandaient une odeur très agréable; pour construire notre maison, nous en avions enveloppé quatre dans une voile et nous avions posé une autre voile dessus pour faire le toit. D'après Philippe Danton (voir ci-dessus) : "Les eaux du Pacifique qui baignent les Juan Fernandez sont très poissonneuses. Il m'est impossible ici de parler de l'ensemble des poissons qui habitent l'archipel. On y a dénombré environ 56 espèces différentes, dont 15 % sont endémiques, réparties dans 31 familles." Mais on ne rencontre pas de poissons d'eau douce dans l'archipel. Nous passâmes ainsi le temps jusqu'au 10 février, à radouber nos vaisseaux, à faire du bois et de l'eau, et à nettoyer nos barriques, lesquelles ne valaient rien et avaient gâté notre eau prise en Angleterre ou à l'île de Saint Vincent. Nous fîmes aussi 80 galons (environ 364 litres) d'huile extraite du lard de lions de mer (otaries), et nous en eussions fait beaucoup plus si nous n'eussions manqué de barils et autres choses nécessaires. Comme nos chandelles diminuaient, et que nous cherchions à les épargner, nous purifiâmes cette huile le mieux qu'il fut possible, pour l'usage de nos lampes. Les matelots s'en servirent aussi parfois pour frire leur viande faute de beurre et de graisse et la trouvèrent assez bonne. Ceux de nos gens qui travaillaient sur l'île, à réparer nos agrès, se nourrissaient de jeunes marsouins, qu'ils préféraient à nos vivres, et qu'ils trouvaient aussi bons que nos agneaux. Pour ce qui me concerne, je n'avais pas les même goûts, et j'aurais bien voulu troquer les uns contre les autres. Au demeurant, nous mîmes tout en oeuvre pour expédier rapidement notre travail car on nous avait prévenu, aux Canaries, que cinq gros vaisseaux français s'approchaient de ces îles. Le 11 février. Hier, le capitaine Dampier, Mr Glendall, Selkirk, et dix matelots se mirent sur la pinasse, pour aller, de compagnie avec la chaloupe de la Duchesse, au sud de l'île, où se trouve une plaine avec quantité de chèvres, plus grosses et moins farouches que celles qui se tiennent dans les endroits plus élevés. Notre pourvoyeur nous avoua que les montagnes sont si élevées de ce côté là qu'il n'a jamais réussi à s'y rendre. Quoi qu'il en soit, nos hommes, après avoir encerclé un gros troupeau, dont ils auraient pu ramener au moins une centaine d'animaux, s'il avaient su prendre leurs mesures, et après en avoir vu plus d'un millier, n'en rapportèrent que seize. Si des vaisseaux, obligés d'aborder cette île avaient besoin de vivres, ils n'auraient qu'à envoyer à ce quartier sud quelques hommes avec des chiens. Ceux-ci leur fourniraient quotidiennement assez de chèvres pour sustenter de nombreux équipages et je ne doute pas qu'ils en trouveraient des centaines avec la marque de Selkirk à l'oreille. Le 12 février. Ce matin, nous pliâmes le reste de nos voiles, nous fîmes porter à bord l'eau et le bois qui nous manquaient, nos hommes se rembarquèrent, et nous achevâmes nos préparatifs pour reprendre la mer. L'île de Juan Fernandez approche beaucoup de la figure triangulaire. Elle peut avoir 12 lieues (environ 55 km) de circuit. Son côté sud-ouest a plus d'étendue que les autres, et il existe une petite île (Santa Clara ou l'île aux chèvres) dans son voisinage, d'un mile environ de longueur (1,6 km), avec quelques rochers qui paraissent tout à fait sous le rivage de la grande île. C'est ici, au sud-ouest, que commence une chaîne de hautes montagnes qui courent jusqu'au nord-ouest, et la terre qui forme une pointe étroite à l'ouest, est la seule plaine qu'on y trouve. La côte, au nord-est, paraît fort haute, et c'est là que se trouvent les deux grandes baies, où les vaisseaux entrent d'ordinaire pour se rafraîchir. La meilleure est celle qui approche le plus du milieu de ce côté de l'île, et on la reconnaîtra facilement à quelques distance, par la haute montagne qui est vis-à-vis, dont le sommet est plat comme une table. On peut mouiller aussi près du rivage que l'on veut, et le plus près est le mieux. La rade la plus sûre est au côté gauche, la plus voisine du rivage oriental. On ne saurait se tromper lorsque l'on est dans la baie. L'autre baie se voit distinctement au nord. Mais elle n'est pas si bonne pour faire de l'eau ou du bois, ni pour donner fonds et descendre à terre. Dans celle où nous jetâmes l'ancre, il y a quantité de bonne eau, dont la meilleure se trouve dans une petite anse, située à une mousquetade à l'est de l'endroit que j'ai décrit. On peut mouiller à un mile, où à la portée d'un trait de flèche, du rivage, puisque l'eau y est profonde partout, que la côte y est saine, et qu'il n'y a pas le moindre danger autour de l'île que l'on ne puisse voir facilement. Cette baie est d'ailleurs ouverte presque la moitié du compas. La terre la plus orientale que nous vissions d'ici était à l'est quart au sud-est, à un mile et demi environ de distance (un peu moins de 2,5 km), et nous avions au nord-ouest quart à l'ouest, à une bonne lieue de distance (4,8 km), la pointe nord-ouest de l'île. Du reste, nous eûmes 45 brasses d'eau (environ 82 m), un fond de sable net, à un mile environ du rivage (1,6 km), dont nous nous serions encore bien plus approchés si Mr Selkirk ne nous avait mis en garde contre le vent de terre, qui souffle parfois avec une grande violence. Il nous assura même que ce mois était le plus beau de l'année, et qu'il n'avait presque jamais vu souffler ici le vent de mer, en hiver ou en été; mais qu'il venait du large de petites brises qui ne duraient pas deux heures et qui n'enflaient pas les houles. En effet, pendant notre séjour, il n'y eut que des vents de terre, ou qui donnaient le long de la côte, sans grossir les vagues; le calme régnait la nuit, et nous avions de temps en temps quelques rafales, qui tombaient du haut des montagnes. Les arbres à piment font le meilleur bois de charpente qu'il y ait sur ce côté de l'île, qui en est tout rempli, et nous en fîmes des bûches pour le chauffage. Les choux y sont excellents et en grande quantité; la plupart des arbres qui les portent se trouvent au sommet des collines, où il faut grimper avec beaucoup de précaution, parce qu'elles sont fort raboteuses, et qu'il y a des trous, où logent certains oiseaux de mer qui ressemblent aux plongeons, et que l'on risque de se tordre les pieds ou de se casser les jambes à travers des roches pourries. Il y a aussi grande quantité de navets verts sur la première plaine, où le terroir est noirâtre, et Mr Selkirk nous dit qu'ils avaient très bon goût dans nos mois d'été, qui sont ici ceux d'hiver : mais comme nous étions en automne, ils avaient déjà grainé, de sorte que nous n'en pûmes cueillir que les feuilles vertes, qui mêlées à du cresson, dont les ruisseaux abondent, servirent beaucoup à guérir nos malades souffrant du scorbut. Notre Écossais nous assura qu'au mois de juillet il avait vu ici de la neige et de la glace, mais que le printemps y est fort agréable, durant les mois de septembre, octobre et novembre; qu'on y trouve alors quantité de bonnes herbes, du persil, du pourpier... On y voit une plante qui possède quelques ressemblance avec la matricaire (camomille allemande), dont l'odeur est plus forte et plus cordiale que celle de la menthe. Nos chirurgiens en firent d'excellentes fomentations, et tous les matins on en parfumait les tentes; ce qui ne contribua pas peu à rétablir nos malades, dont deux seulement moururent, Edouard Wilts et Cristophe Williams, matelots de la Duchesse. Nous en cueillîmes aussi plusieurs gros paquets que nous portâmes à bord de nos vaisseaux, après l'avoir faite sécher à l'ombre. Cette plante croît en abondance le long du rivage. D'après Isaac James les oiseaux de mer ressemblant aux plongeons seraient des pardelas. Mais voici ce que rapporte Anson dans Voyage aux Indes orientales par le Sud-Ouest - Pierre de Hondt - La Haye, 1757 : "L'île de Juan Fernandez n'a pas d'autres oiseaux que des faucons, des merles, des hiboux et des colibris. Les Anglais n'y virent point cette espèce, qui se creuse des nids en terre, et dont quelques autres voyageurs ont donné la description, sous le nom de Pardelas ou Damiers; cependant, ayant trouvé plusieurs de leurs trous, ils jugèrent que les chiens les avaient détruits. Tous les chats, que Selkirk y vit en si grand nombre, doivent avoir eu le même sort, puisque dans un long séjour ils n'en aperçurent qu'un ou deux. Mais les rats s'y sont maintenus avec tant d'ascendant, que toutes les nuits ils causaient beaucoup d'incommodité dans les tentes." Anson arriva sur l'île le 16 juin 1741 et y fit escale pendant trois mois, après un passage difficile du Cap Horn. Les équipages de sa flotte étaient décimés par le scorbut et affaiblis par les tempêtes. Il s'y refit avant de reprendre la mer, non sans mal, à cause du nombre insuffisant des marins survivants. Une autre remarque concernant la faune : il y a des araignées sur l'île de Robinson Crusoë, mais pas d'abeilles, de guêpes, de serpents ou autres bêtes venimeuses. Ce seraient les colibris qui polliniseraient les fleurs. Rodgers. Au mois de novembre, les chiens de mer (phoques) se rendent sur cette île, pour y mettre bas. Ils sont alors de si mauvaise humeur que, bien loin de se retirer à l'approche d'un homme, ils se jettent sur lui pour le mordre, même s'il est armé d'un bâton. Ils ne se montrent pas aussi agressifs en d'autres temps, et ils se lèvent aussitôt qu'ils découvrent quelqu'un. A la saison des accouchements leur voisinage est dangereux, mais en d'autres temps ils laissent la voie libre à l'homme. S'ils s'y opposaient, il serait impossible d'aborder, car le rivage en est d'ordinaire couvert à plus d'un demi mile à la ronde (750 à 800 m). Quand nous y arrivâmes, nous les entendions crier jour et nuit, bien que nous tenant à un mile de la terre; les uns bêlaient comme des agneaux; les autres aboyaient comme des chiens, ou hurlaient comme des loups, et poussaient divers cris plus horribles les uns que les autres. Leur fourrure est la plus belle de cet espèce que j'aie jamais vue de ma vie; celle de nos loutres n'en approche pas. Selon Isaac James, les cris des animaux marins,
qui allaient de la plainte au hurlement, éveillaient les échos
dans les vallées profondes de l'île, en un vacarme épouvantable
qui dérangea beaucoup Alexander Selkirk et précarisa son
sommeil. Les fracas de la nature n'étaient pas moins incommodants
ni moins dangereux. Sur cette île d'origine volcanique, la terre
était peu épaisse et les arbres n'arrivaient à s'y
enraciner que très superficiellement. On ne pouvait pas compter
s'accrocher à eux pour gravir une pente; un marin de Rodgers en
fit l'expérience et en mourut. Une autre personne faillit subir
le même sort en s'appuyant contre en tronc qui céda sous son
poids. Un coup de vent suffisait à abattre de
gros arbres qui s'effondraient à grand bruit. Et des rochers eux-mêmes
se détachaient parfois pour rouler sur les pentes!
Des baleines viennent parfois errer jusqu'à l'entrée de la baie de Cumberland. Pour les oiseaux de terre, nous n'y aperçûmes qu'une sorte de merles, au jabot rouge, qui, à cela près, ressemblent pas mal aux nôtres (s'agit-il du zorzal, une sorte de grive?), avec le petit oiseau murmure, ou bourdonnant, qui n'est pas plus gros qu'un hanneton (le colibri ou pique-fleurs qui, on l'a vu remplacerait l'abeille, dans le processus de pollinisation). Il y a ici une petite marée, dont le flux est incertain, mais qui monte d'environ sept pieds (un peu plus de 2 m) au temps des hautes marées. Je ne m'amuserais pas à relever les mensonges que d'autres ont avancés à l'égard de cette île, bien persuadé de n'avoir rien dit moi-même qui ne soit conforme à la vérité. Je me suis d'autant plus étendu à la décrire qu'elle peut être d'une grande utilité pour ceux qui voudront trafiquer par la mer du Sud. L'arbre à piment, et celui qui porte le chou, sont trop connus pour en faire ici la description. Le 13 février. Dans une assemblée du Conseil qui se tint hier, à bord de la Duchesse, il fut résolu de courir nord-est quart à l'est vers la terre, de nous en éloigner de six lieues (27 à 28 km), et de ranger ensuite la côte nord; que l'île de Lobos del mar serait la première place où nous toucherions; que si nos vaisseaux venaient à être séparés, ils s'attendraient l'un l'autre 20 lieues (un peu mois de 100 km) au nord de la hauteur où se serait produite leur séparation; qu'ils mettraient à la cape, à six lieues du rivage, l'espace de quatre jours; qu'ils s'avanceraient à petites voiles vers Lobos, s'ils ne se retrouvaient pas, et qu'ils auraient surtout l'oeil au guet pour éviter les Rochers Ormigos, qui sont à peu près à la même distance de Callo, le port de Lima. On convint d'ailleurs que si l'un ou l'autre de nos deux vaisseaux apercevait quelque navire ennemi, le signal, pour lui donner la chasse, en cas que nous fussions à portée, serait de ferler nos voiles du grand perroquet et de hisser les vergues en haut; que celui des deux qui irait le mieux à la voile, ou qui se trouverait près de l'ennemi, courrait directement dessus, et que l'autre se tiendrait à une distance raisonnable du rivage, pour n'en être pas découvert, suivant que l'occasion le demanderait : que si celui qui serait le plus proche de l'ennemi, le croyait trop gros, pour l'attaquer seul, il ferait alors le même signal, ou tout autre facile à discerner; enfin que celui qui l'aborderait, qui s'en rendrait le maître, ou qui l'aurait sous le vent, arborerait une flamme blanche à la tête du grand mât, si c'était de jour, ou qu'il porterait autant de fanaux qu'il lui serait possible, si c'était de nuit. Il fut résolu en même temps que, pour discontinuer la chasse d'un vaisseau ennemi, le signal de nuit serait de mettre un bon fanal à la tête du grand mât, et celui de jour, d'amener les voiles de perroquet, à la réserve de celle du grand perroquet; qu'on ne tirerait le canon, soit de jour ou de nuit, qu'en cas de brume, ou par un temps fort sombre, afin de n'être pas découverts, que cependant si l'un de nos vaisseaux était en danger, soit à cause d'un bas-fonds, ou de quelque autre manière, il tirerait alors un coup de canon chargé à boulet; que si nous venions à nous perdre de vue, chacun ferait les signaux qui se trouveraient réglés pour la semaine; qu'en cas de séparation, nos deux vaisseaux, à leur entrée à Lobos, porteraient une flamme anglaise à la tête du mât d'avant, et que si à l'arrivée de l'un, l'autre y était déjà, celui-ci arborerait pavillon anglais; que si l'un ou l'autre vaisseau mouillait en deçà de la rade, il porterait trois feux, l'un à la tête du grand mat, l'autre à la poupe, et le troisième au haut du beaupré; que celui des deux vaisseaux qui arriverait le premier à Lobos, sans y trouver l'autre, planterait aussitôt deux croix à l'endroit de l'abordage, l'une à tribord et l'autre à bâbord de l'entrée de la grande île, et cacherait une bouteille en terre à 60 pieds (18 m) tout droit au nord de ces croix, avec un écrit dedans, pour avertir l'autre de ses aventures, depuis leur séparation, et de ses nouveaux desseins; qu'il observerait exactement cet ordre, afin que si le premier venu au rendez-vous donnait la chasse à quelque navire ennemi, ou qu'il la prît lui-même, le dernier sache de quel côté diriger sa route. Le 13 février. Hier après-midi, nous envoyâmes notre gabare à la pêche, d'où elle revint en fort peu de temps, avec environ 200 gros poissons que nous mîmes dans le sel, pour l'usage de notre monde. Ce matin, nous achevâmes les articles que l'on vient de lire, et dont l'observation est très nécessaire dans une entreprise comme la nôtre. Voici donc Selkirk enrôlé à nouveau dans la guerre de course, pour le meilleur et pour le pire, sous les ordres de Rodgers, avec la recommandation de Dampier, et en possession d'un grade. Il abandonne son titre et ses prérogatives de gouverneur pour reprendre une vie d'aventures et de combats, non sans emporter avec lui son vieux mousquet et quelques objets souvenirs de son île; pour ce qui est de ses chèvres, il ne s'inquiète pas : elles sauront se débrouiller seules; mais il s'attriste sur le sort de ses chats qui vont redevenir sauvages. D'après Isaac James, s'il était resté sur son île, il aurait certainement été pris par les Espagnols; en effet, en 1712, des Français qui y avaient installé une pêcherie, y furent dérangés par ces vindicatifs voisins. Le départ de Selkirk, ne laissa pas l'île complètement déserte, on vient de le dire. Elles continua à attirer les navires à la recherche d'eau, de chair fraîche, et d'un hâvre où se réparer; des marins furent tentés de s'y établir, avant que la navire de Shelvocke ne vienne se fracasser sur ses rochers en 1720. Mais je m'en tiens là, pour ce qui est de l'asile de notre marin écossais et je vais désormais résumer ses pérégrinations, en négligeant les coups de mains où il n'est pas cité, quitte à redonner parole à Rodgers chaque fois qu'une affaire importante se présentera. Le 15 mars 1709, la Duchesse s'empare d'un navire. Le lendemain, Selkirk apprend des hommes capturés sur ce navire que le bateau du capitaine Stradling, le Cinque-Ports, s'est abîmé sur la côte de Barbacour; et que le capitaine et six ou sept hommes, seuls rescapés du naufrage, fait prisonniers, ont subi, dans les geôles de Lima, un sort pire que le sien. Notre homme a donc l'amère satisfaction d'apprendre que ce qu'il craignait s'est produit! Peu de temps après, un autre bateau est pris. On l'appellera le Biginning. Il est placé sous le commandement de Cook. Le 26 mars, une autre voile tombe entre les mains des hommes de Rodgers. Le 29 mars 1709, la seconde prise, une fois remise en état, est nommée l'Increase. Tout ce qui est à terre est monté à bord; une nouvelle chaloupe touée jusque là à l'arrière du vaisseau de Rodgers est lancée en mer et le 30 au matin, à dix heures, la flottille fait voiles, après avoir choisi Mr Stratton pour maître du Biginning. Tous les malades sont mis sur l'Increase, avec un chirurgien de chaque vaisseau, et Selkirk en est établi maître. Le 1er avril, pendant l'après-midi, la mer devient rouge comme si des flots de sang y avaient été versés. En fait, sur plusieurs miles, elle est couverte de frai de poissons. Redonnons la parole à Rodgers : Le 25 avril 1709, un parti, dirigé par Connely et Selkirk, est jeté sur Guayaquil pour s'emparer des richesses des planteurs. Il n'y eut dans cette expédition que le seul Guillaume Davis, de ma compagnie, qui fut blessé; il reçut un coup de mousquet assez favorable à travers la nuque du cou; tous les autres en sortirent heureusement après avoir donné la chasse à 35 cavaliers bien armés qui venaient au secours de ceux de Guayaquil. Les maisons le long de la rivière étaient pleines de femmes; il y en avait surtout dans un endroit plus d'une douzaine de jeunes, bien mises et jolies, de qui nos gens eurent quantité de pendants d'oreilles et de chaînes en or; mais ils les traitèrent si honnêtement, qu'elles offrirent de leur apprêter à manger, et leur donnèrent une barrique de bon vin. Elles avaient caché quelques-unes de leurs plus grosses chaînes sous leurs habits, autour de la ceinture, des bras, des cuisses ou des jambes; les dames, qui tressent ici leurs cheveux avec des rubans d'une manière fort propre, s'habillent de soie si mince, que nos gens s'aperçurent bientôt du trésor caché, de sorte qu'ils les prièrent, d'un ton modeste et civil, par la bouche de leur interprète, de bien vouloir mettre à jour elles-mêmes ce trésor pour ne pas les contraindre à porter la main en des endroits trop intimes. Je remarquerai d'autant plus volontiers ce comportement qu'il est rare parmi les gens de mer, et que Mrs Connely et Selkirk, qui commandaient ce détachement, ne sont mariés ni l'un, ni l'autre; ainsi, je me flatte que le beau sexe leur en témoignera de la reconnaissance à notre retour en Grande Bretagne. Quoi qu'il en soit, ils rapportèrent de leur course en pendants d'oreilles, chaînes d'or ou en vaisselle, pour la valeur, à ce que je crois, de plus de mille livres sterling, plus un Nègre, qui les avaient aidés à découvrir une partie de ce trésor; mais ils avouèrent tous qu'ils en avaient perdu bien au-delà pour avoir manqué d'une autre chaloupe; puisqu'à mesure qu'ils pillaient d'un côte de la rivières, les canots et les radeaux passaient quantité de monde et d'effets de l'autre. Ils nous dirent aussi qu'ils avaient vu, en différents partis, plus de trois cents hommes armés, à pied ou à cheval, ce qui nous fit craindre que les ennemis, sous prétexte de négocier pour garantir leur ville du feu, ne cherchassent à gagner du temps, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de nous accabler par leur nombre. Là dessus, nous résolûmes de nous rassembler tous, dès que l'alarme serait donnée à un de nos quartiers; ce qui arrivait quotidiennement à la vue d'un gros parti, et nous détournait beaucoup de nos activités. Nous trouvâmes dans une église cinq jarres de poudre, de la mèche, du plomb, et trois tambours, avec une assez grosse quantité d'armes ordinaires, épées et lances. J'y pris aussi la canne à pomme d'or du gouverneur, et celle d'un capitaine à pomme d'argent; entre les Espagnols, il n'y a que les principaux officiers à porter des cannes. Le 19 mai 1709, mention est une nouvelle fois faite de Selkirk à qui a été confiée un bâtiment qualifié de barque, c'est-à-dire un petit bateau (peut-être l'Increase), qui, avec un galion, accompagne Rogers, dans la recherche infructueuse d'une aiguade. La flottille se trouve alors à hauteur des Galapagos et la pénurie d'eau est telle qu'elle entraîne la mort de quelques hommes. Nouvelle mention de Selkirk et de sa barque les 20, 21 et 25 mai 1709. Début juillet, mention de l'emploi de la barque de Selkirk pour le transport à terre de 72 prisonniers, qui n'ont pas été libérés avant, malgré la charge que leur entretien entraînait, de crainte qu'ils n'indiquassent aux hommes d'armes français et espagnols où se trouvaient les bateaux anglais en cours de radoub. Le 12 août 1709, la barque est de retour et Selkirk en reprend possession avec son équipage. Le 27 décembre 1709, Selkirk participe à la réunion d'un comité à bord du Duke à propos d'un engagement avec un puissant galion de Manille qui a mal tourné. Il est décidé de ne pas poursuivre plus longtemps le combat et d'abandonner l'idée de s'emparer de cette proie trop coriace. Les galions de Manille étaient des vaisseaux espagnols qui naviguaient entre Manille et Acalpuco; dans ce sens, ils étaient chargés de précieuses marchandises asiatiques et dans l'autre ils transportaient beaucoup d'argent. Le 10 janvier 1710, en Californie, après un conflit entre capitaines pour désigner celui qui prendrait le commandement d'une frégate espagnole rebaptisée The Batchelor, Selkirk est nommé maître sur cette prise, dont la direction échappe à Dover au profit de Frye et Stretton. Le 30 juin 1710, sur la frégate The Batchelor, en direction de Batavia, Selkirk et trois autres personnes, sont chargés d'une comptabilisation des prises. Cette fonction est un témoignage supplémentaire de la confiance que l'on accorde au marin écossais. Howell date cet événement du 20 juin, jour de l'arrivée à Batavia; il parle d'une attribution à plusieurs hommes, pour acheter ce qui leur était indispensable; Knowlman et Selkirk auraient alors reçu huit cents pièces de huit, évaluées chacune à quatre shillings six pence; la part de Selkirk se serait élevée à 90 livres. Le 1er juillet 1710, à Batavia, de l'argent est attribué afin de pourvoir à la couverture des besoins lors du retour en Europe. Selkirk reçoit 80 pièces de huit. Le 30 septembre 1710, d'après Isaac James, Alexander Selcrag (sic) est nommé maître à bord du Duke, le navire de Rodgers, nouvelle preuve de confiance. Le 14 octobre 1711, après un long retard, le navire portant Selkirk arrive en Angleterre. Ce retard n'est pas imputable à Rodgers qui, blessé deux fois grièvement au cours de la campagne, souhaitait rentrer rapidement. Mais il se heurtait à la résistance de ses équipages qui, ne voulant pas soumettre leur butin au hasard d'une mauvaise rencontre, préféraient attendre le départ d'une flotte hollandaise conséquente qui leur servirait d'escorte. Que devint notre gouverneur après son retour sur sa terre natale? Le journaliste, Richard Steele, une relation de Woodes Rodgers, fit sa connaissance. Voici ce que ce dernier nous raconte dans un article, intitulé Alexander Selkirk, paru dans le périodique The Englishman, 3 décembre 1713 - N° 26. La personne dont je parle est Alexander Selkirk; son nom est familier aux curieux, parce qu'il vécut quatre ans et quatre mois seul dans l'île de Juan Fernandez. J'ai eu le plaisir de converser fréquemment avec cet homme peu de temps après son retour en Angleterre, en 1711. J'éprouvai une vive curiosité à l'entendre me narrer les différentes révolutions qui troublèrent son esprit pendant sa longue solitude, car il est un homme de bon sens. Quand on considère quelle peine la majeure partie des humains éprouvent de l'absence de compagnie pendant une soirée, on peut imaginer combien doit être pénible une solitude obligatoire et constante pour un homme de l'espèce des marins, toujours habitué à jouir et souffrir, manger, boire, dormir et accomplir toutes les tâches de la vie en camaraderie et compagnie. Il fut mis à terre d'un vaisseau qui prenait l'eau, par suite d'un différent irréconciliable avec le capitaine; et il décida de livrer son destin à cet endroit plutôt qu'à un vaisseau fou dirigé par un commandant désagréable. On lui laissa un coffre de mer, les vêtements qu'il portait ainsi que sa literie, un fusil à pierre, une livre de poudre, une assez grande quantité de balles, un silex et son support d'acier, quelques livres de tabac, une petite hache, une bouilloire, une Bible et quelques autres livres de dévotion, avec des objets qui concernaient la navigation, et ses instruments mathématiques. Le ressentiment à l'encontre de son officier, qui l'avait si mal traité, lui fit considérer sa vie future, comme la meilleure issue possible, jusqu'au moment où il vit le vaisseau lever l'ancre; à ce moment, son coeur se souleva et l'idée de se séparer ainsi d'un seul coup de ses camarades et de toute société humaine s'empara de lui. Pour soutenir sa vie, il ne disposait seulement pour provisions que de deux repas d'avance, et l'île n'abondait qu'en chèvres sauvages, chats et rats. Il jugea que le moyen le plus probable de trouver rapidement et facilement de la nourriture, serait de chercher des coquillages, mollusques et crustacés, sur la plage, plutôt que de chasser le gibier avec son fusil. Il trouva effectivement de grandes quantités de tortues, dont la chair est extrêmement délicieuse, et dont il mangea fréquemment très abondamment après son atterrage, jusqu'à ce que ce met devienne désagréable en lui causant des douleurs d'estomac. La nécessité de calmer sa faim et sa soif, le divertit d'abord de toute réflexion sur sa condition solitaire. Quand son appétit fut satisfait, le désir de société commença à le tourmenter fortement et il lui apparut que ce désir était moins pressant quand il manquait de tout. Sustenter son corps avait été relativement facile, mais le désir ardent de voir à nouveau une figure humaine, lorsque son estomac l'implorait, atteignait maintenant l'insupportable. Il devenait de plus en plus affligé, languide et mélancolique, peu enclin à réprimer sa propre violence, jusqu'à ce que, par degrés, par la force de la raison, et en s'adonnant souvent à la lecture des Écritures, et en tournant ses pensées vers l'étude de la navigation, au bout de dix huit mois, il parvint peu à peu à se réconcilier complètement avec sa condition. Quand il eut réalisé cette conquête sur lui-même, la vigueur de sa santé, la distance qu'il prit avec le monde, un ciel constamment gai et serein, et un air tempéré, firent de sa vie une fête perpétuelle, et son être fut beaucoup plus joyeux qu'il avait été auparavant ennuyeux. Il jouissait maintenant de toute chose, il orna la hutte, dans laquelle il s'étendait pour dormir, avec des objets qu'il sculptait dans du bois qui ne manquait pas, à côté de l'endroit où il se trouvait, aménageant la plus délicieuse tonnelle, éventée par une brise continuelle, et la douce respiration du vent, qui rendait son repos après la chasse égal aux plaisirs les plus sensuels. J'ai oublié d'observer que, pendant l'époque de son insatisfaction, des monstres des profondeurs, qui viennent s'étendre fréquemment sur le rivage, ajoutèrent ce désagrément à celui de la solitude; les hurlements et les voix terrifiantes de ces visiteurs indésirables étaient trop terribles pour des oreilles humaines; mais, après avoir retrouvé son humeur naturelle, il put non seulement entendre leurs voix, mais aussi s'approcher des monstres eux-mêmes avec une grande intrépidité. Il parle de lions de mer (otaries), dont les mâchoires et les queues sont capables de briser les membres d'un homme, s'il s'aventure trop près d'eux : mais, à cette époque son esprit et sa vie étaient à un niveau si élevé qu'il pouvait agir de manière régulière et insouciante, il les tuait imperturbablement et sans difficulté : grâce à son esprit d'observation, il s'était rendu compte que, quoique leurs mâchoires et leurs queues fussent terribles, ces animaux puissants étaient lents à se retourner, il n'y avait donc rien d'autre à faire que de se placer en dehors de leur cercle, et aussi près que possible d'eux, pour les expédier avec une hachette à volonté. Il prit la précaution, en cas de maladie, d'attraper de très jeunes chevreaux boiteux, qui puissent recouvrer la santé, mais ne soient jamais capables de courir vite. Il en avait de nombreux autour de sa hutte; et, quand il était en pleine forme, il pouvait s'emparer à toute vitesse d'une chèvre des plus rapides montant un promontoire, et il n'en a jamais manqué une, sauf en descente. Grâce à cet élevage, Selkirk avait toujours du lait et de la viande à portée de la main. Il était passé tout naturellement de l'état de chasseur à celui de fermier sédentaire! Son habitation était infestée de rats, qui grignotaient ses vêtements et ses pieds pendant son sommeil. Pour se défendre contre eux, il nourrit et dressa de nombreux jeunes chatons qui se couchaient auprès de sa couche, et il les défendit contre leurs prédateurs. Quand ses vêtements furent complètement hors d'usage, il sécha et cousit ensemble des peaux de chèvres, avec lesquelles il se revêtit, et s'habitua à passer avec à travers les bois, les buissons et les ronces avec autant d'indifférence et de précipitation que n'importe quel autre animal. Une fois, tandis qu'il courait en haut d'une colline, afin de capturer une chèvre, il se jeta sur elle; le sol s'ouvrit et il tomba au fond d'un précipice, où il resta étendu, sans l'espoir d'aucune aide, pendant trois jours, durée qu'il mesura par les évolutions de la lune. Cette manière de vivre lui paraissait de jour en jour plus plaisante; il n'avait jamais le temps de s'ennuyer; ses nuits étaient calmes et ses jours joyeux, grâce à la pratique de la tempérance et de l'exercice. Voici la façon dont il s'y prit pour remplir les heures vouées aux exercices de dévotion : il les déclamait à haute voix, pour garder intactes ses facultés d'élocution, et pour s'exclamer avec la plus grande énergie. Quand je le vis pour la première fois, je pensais que, si je n'avais pas connu son caractère et son histoire, j'aurais pu discerner qu'il avait été privé longtemps de toute compagnie d'après son aspect et ses gestes; il y avait du sérieux, un sérieux puissant mais de bonne humeur, dans son apparence, et un certaine négligence pour les choses ordinaires de son entourage, comme s'il était toujours plongé dans ses pensées. Quand le bateau qui le tira de la solitude de son île arriva, il reçut les marins avec la plus grande indifférence pour ce qui est de la perspective de gagner le large avec eux, mais l'opportunité de les rafraîchir et de les aider suscita en lui une vive satisfaction. Cet homme qui avait si longtemps pleuré sur son retour dans le monde, estimait qu'il aurait bien du mal à se réhabituer, après la tranquillité de sa solitude, à tous les plaisirs de la société. J'avais eu souvent l'occasion de converser avec lui. Pourtant, après quelques mois d'absence, je le rencontrai dans la rue, et bien qu'il me parlât, j'étais dans l'incapacité de me souvenir que je l'avais déjà vu; le retour à la vie urbaine avait complètement changé son aspect de solitaire, et tout à fait modifié l'air de son visage. Cette simple histoire d'un homme reste un mémorable exemple, de ce que le plus heureux des hommes est celui qui restreint ses envies aux nécessités naturelles; et celui qui va plus loin dans ses désirs, ne fait qu'accroître ses besoins en proportion de ce qu'il a déjà jusqu'à en devenir insatiable; ou, pour utiliser sa propre expression : "Je vaux maintenant 800 livres, mais je n'ai jamais été aussi heureux que quand je ne valais pas un penny." On peut supposer que Steele ne fut pas le seul confident de Selkirk et que ce dernier dut raconter son histoire à plusieurs personnes. Il l'aurait même écrite et publiée dans une brochure à quatre sous : La Providence manifestée, ou Les Remarquable Aventures d'Alexander Selkirk, texte repris plus tard par Isaac James, qui le publia en 1800, et par le révérend H.C. Adams, dans L'Original Robinson Crusoë, en 1877. Mais il est peu probable que cette brochure, sans doute inspirée par la lecture de Rodgers, soit authentique. L'ouvrage d'Isaac James est une compilation très détaillée des récits publiés antérieurement. Selkirk retourna à Largo au début du printemps 1712. C'était un dimanche, à l'heure de la messe. Il se rendit à l'église que fréquentait sa famille. Celle-ci ne reconnut d'abord pas le nouveau venu, bien habillé avec la part des pillages qui lui avait allouée. Sa mère, enfin, le remit et se précipita au devant de lui, perturbant quelque peu l'office religieux. Toute la famille en fit autant. Il vécut à Largo la vie d'un solitaire. Il entreprenait de longues marches à travers la nature, plongé dans ses pensées. Il acheta un bateau pour aller à la pêche, mais sans aucun compagnon à ses côtés. Il aménagea pour méditer une sorte de grotte sur une pente dans un jardin de sa famille; il y laissait errer son regard sur l'immensité marine en regrettant son île perdue qu'il savait ne jamais revoir. Il ne parvenait pas, après huit années d'absence, dont plus de quatre dans la solitude, à retrouver ses marques dans la société de son temps. Les conséquences de son aventure me font penser à l'un des explorateurs qui traversèrent les premiers le continent américain, entre 1804 et 1806. Meriwether Lewis revint tellement marqué par son expérience qu'il ne dormit plus que sur une peau d'ours jeté sur le sol et qu'il finit par mettre fin à ses jours. Comme il était atteint de la malaria, on prétend qu'il tira les deux balles qui le tuèrent dans les parties douloureuses de son corps pour en extraire le mal. Mais Selkirk était d'une autre trempe! Il finit par surmonter une fois de plus ses difficultés personnelles. Il rencontra une fille de 17 ans, du nom de Sophia Bruce, et la persuada de s'enfuir avec lui, apparemment à Bristol, puis de là à Londres. Le 23 septembre 1713, il eut des démêlés avec la Justice, en raison d'un procès contre lui de la paroisse de St Stephen, à Bristol, relatif à un incident avec Richard Nettle, constructeur naval (Notes and Queries, 2e ser. Xi.246). Isaac James parle également d'une affaire qu'il aurait eu à la suite de la correction particulièrement brutale qu'il aurait infligée à un gamin qui avait cassé une cruche d'eau. Dans un testament de janvier 1717 scellé à Londres, Selkirk qualifie Sophia d'"amie bien-aimée, Sophia Bruce, de Pall Mall, Londres, célibataire" et en fait son exécutrice testamentaire et héritière, en laissant néanmoins des biens à son neveu Alexander, fils de David Selkirk, un tanneur de Largo; deux documents du Scot Magazine à ce propos ont été publiés par Howell. Selkirk quitta Sophia par la suite. Après sa mort, une Sophia Selcraig prétendit, sans justification légale, être sa veuve, et demanda la charité au révérend Samuel Say, un ministre dissident à Westminster (Say Papers, dans le Dépôt mensuel, 1810, v.531). Cependant, Selkirk avait repris sa vie de marin et, avant 1720, il épousa une veuve nommée Frances Candis. Le 12 décembre 1720, il rédigea un nouveau testament, se décrivant comme "d'Oarston (Plymstock, Devon), compagnon du navire de sa majesté Weymouth". Il laissa tout ce qu'il avait à sa femme Frances, dont il fit son unique exécutrice testamentaire. Il s'engagea dans le Weymouth comme contre-maître le 20 octobre 1720 et mourut à bord l'année suivante au Ghana. Dans le livre de paie du navire, il est inscrit comme "décédé le 12 décembre 1721", à l'âge de 45 ans. On peut penser que son corps fut jeté à la mer. Le testament de 1720 fut proposé pour l'homologation le 28 juillet 1722. Sa veuve apporta les preuves nécessaires et, lorsque son mariage avec Selkirk et son veuvage furent validés, elle obtint gain de cause, le 5 décembre 1723. Elle réclama une maison de Craigie Well et en obtint la possession. Avant décembre 1723, elle s'était mariée une troisième fois, et était devenue la "femme de Francis Hall" (Testament d'Alexandre Selkirk, 1720, dans New England Hist. et Gen. Reg. - Octobre 1896, et avec fac-similé, ib. Avril 1897). Selkirk semble n'avoir jamais eu d'enfant. Diverses reliques ont été conservées par ses amis et une statue en bronze le représentant a été érigée à Largo. Une tablette à sa mémoire a également été placée, en 1868, près de son mirador à Juan Fernandez, par le commodore Powell et les officiers du HMS Topaz, pour lesquels ils ont été remerciés par Thomas Selcraig, seul descendant collatéral de Selkirk, alors vivant à Édimbourg (Notes et requêtes, 4e série ii.503, iii.69). En 1966, en mémoire de ces faits et en hommage au roman de Daniel Defoe qui s'en inspire, l'île chilienne de Mas a Tierra, fut rebaptisée île de Robinson Crusoë. L'île désertique de Mas a Fuera, se vit attribuer l'appellation d'île Selkirk, sans doute parce que le marin écossais ne s'y rendit jamais! Edward Cook, qui participait à l'expédition, dans son ouvrage déjà cité, évoque la découverte de Selkirk sur son île, mais, dans le premier volume, son témoignage ne fait que confirmer celui de Rodgers; dans l'introduction du second volume, il se montre un peu plus prolixe, mais, comme il se refuse à tromper ses lecteurs en enjolivant son récit, il s'en tient à une simple relation des faits. En voici un résumé. Au moment de poser leurs pieds sur le rivage, les marins et officiers envoyés sur une île déserte ont la surprise d'y découvrir un homme bizarrement accoutré, portant une barbe de plus de quatre ans, qui agite un drapeau blanc. Il parle anglais et les accueille cordialement en leur indiquant l'endroit le plus favorable où jeter l'ancre et débarquer. Il se réjouit que les nouveaux venus soient des Anglais. Ces derniers l'invitent à bord. Il s'enquiert alors de la présence d'un certain officier sur la frégate, laissant entendre que, si c'est le cas, il préférera rester à terre. Cet officier y est, mais on le rassure : ce n'est pas lui qui commande le navire. Qui est cet officier? L'individu n'est pas identifié par Cook, mais John Howell affirme qu'il s'agit de Dampier! Selkirk invite ensuite ses visiteurs à le suivre chez lui. Il habite deux cabanes dont Cook décrit sommairement l'ameublement spartiate où l'on retrouve les biens qui furent laissé au proscrit lors de son abandon ainsi que quelques autres fruits de son habileté. A côté des cabanes sont élevés des chevreaux attrapés jeunes pour faciliter leur dressage. Il pourvoit ses hôtes de chair de chèvre. Il hésite longuement avant de se laisser convaincre de monter à bord en raison de la profonde aversion qu'il éprouve à l'encontre de l'officier dont il a été déjà question. Il raconte les difficultés qu'il a dû surmonter afin de se procurer sa nourriture et avoue avoir été servi à la fois par la nature et les Espagnols : par la nature grâce à l'arbre à choux, par les Espagnols à cause des graines de navets qu'ils ont semés sur l'île. Rodgers, on s'en souvient, déclare que c'est Dampier qui planta ces légumes. Il narre sa chute dans un ravin lors de la poursuite d'une chèvre dont il se tira seul, sans le secours d'un chirurgien, d'un médecin ou d'un apothicaire. Cook pense que ce qu'apprit surtout Selkirk dans la solitude, c'est d'abord à pratiquer l'adage : "Aide-toi et le ciel t'aidera!". Finalement, malgré ses réticences initiales, cet homme étrange, que Cook nomme aussi Selcrag, objet de la curiosité générale, finit par rentrer en Angleterre avec Rodgers. Outre la compilation d'Isaac James, le récit le plus complet des aventures de notre héros, basé principalement sur les récits contemporains, figure dans La vie et les aventures d'Alexander Selkirk, par John Howell, ouvrage déjà cité. L'auteur de "Picciola" (Saintine, soit J. Xavier Boniface) prétendit fonder son intéressant roman "Seul", Paris - 1850, sur la véritable histoire de Selkirk; mais ce n'est qu'une fiction bien conduite sans valeur historique. Bien d'autres ouvrages mentionnent le nom de Selkirk qui, grâce à Robinson Crusoë, jouit d'une notoriété certaine, citons la notice du Dictionnaire biographique national, 1885-1900 , volume 51, de George Atherton Aitken, également déjà évoquée, et l'ouvrage de Jules Verne, Les grands navigateurs du 18ème siècle, Hetzel, 1879. Cette veine littéraire, outre le chef d'oeuvre de Daniel Defoe, a irriguée l'imagination de bien des folliculaires pilleurs d'épaves qui n'avaient pas son talent. Au retour, nous jetons un coup d'oeil sur l'ancien fort espagnol de Santa Barbara. Il fut édifié en 1749, pour défendre l'île contre les incursions des pirates. Les Espagnols, convaincus qu'ils ne dissuaderaient pas les navires étrangers de se rendre dans l'île seulement en lançant leurs dogues contre des chèvres, y construisirent une fortification. En mai 1767, Carteret, cité par Isaac James, lors de l'un de ses voyages, fut surpris de la découvrir. Elle semblait contenir une importante garnison. Quatre canons ouvraient leurs gueules en direction de la baie. L'ouvrage de pierres s'élevait sur la pente de la montagne à environ 300 yards (275 m) de la mer. Il comportait entre 18 à 20 embrasures et contenait un grand bâtiment probablement destiné au logement de la troupe. Le navire de Carteret ayant fait mine de vouloir entrer dans la baie, un bâtiment espagnol s'avança vers lui, avec des intentions manifestement hostiles; une seconde tentative connut le même résultat et le visiteur indésirable s'ent tint là. L'année suivante, un tremblement de terre secoua l'île; celle-ci étant située dans une zone sismique, un tel événement n'était pas extraordinaire et se répéta même assez fréquemment; on en note un autre au large, les 20 et 21 février 1835; le 16 août 1906, un nouveau séisme laisse croire sur le continent que l'île a été engloutie; en 2010, le phénomène se reproduit et déclenche un tsunami qui ravage Juan Bautista, la plupart des habitants ne sont sauvés que par la prescience d'une petite fille de douze ans qui donne l'alerte. Abandonné depuis longtemps, au début du 20ème siècle, le fort aurait été l'objet d'une tentative d'établissement d'un pénitencier; l'expérience aurait échoué, le ravitaillement étant trop compliqué. Cet ouvrage fut restauré en 1974, avant d'être classé monument historique en 1979. On peut y voir quelques vieux canons. Puis nous allons visiter les
grottes des patriotes. Vers 1770, sous le régime espagnol, une
colonie pénitentiaire aurait été établie sur
l'île avec une garnison d'une cinquantaine d'hommes pour surveiller
un nombre égal de prisonniers. Pendant la guerre d'indépendance,
cent vingt cinq rebelles furent exilés sur l'île Juan Fernandez.
Ils y vécurent dans des grottes, (naturelles ou qu'ils creusèrent?
Je ne saurais le dire). Les survivants durent attendre que le triomphe
des indépendantistes leur permette de regagner la terre ferme. L'indépendance
du Chili ne devait toutefois pas changer la destination de l'île;
de 1814 à 1817, sous le nouveau régime, elle servit de lieu
de relégation des opposants. S'il faut en croire Maria Graham (Journal
of a residence in Chile during the year 1822, and a voyage from Chile to
Brazil in 1823 - Longman and Murray - London, 1824), les navires anglais
étaient dissuadés de relâcher à l'île
pour y faire de l'eau afin que les détenus ne puissent pas en profiter
pour s'évader. Des exilés se soulevèrent contre le
gouverneur et au moins l'un d'entre eux fut tué dans des circonstances
obscures. A l'époque où Maria Graham visita l'île,
elle était veuve du capitaine du navire qui l'avait amenée
en Amérique du Sud, et ne voulait pas quitter ces parages avant
d'avoir vu l'île qui était à l'origine du fameux roman
de Robinson Crusoë. Elle y vint en compagnie d'autres personnes, dont
l'amiral Cochrane, un marin anglais, qui combattit Napoléon, avant
de se retrouver aux côtés des officiers français de
la Grande Armée qui luttaient pour l'indépendance de l'Amérique
latine, et de devenir le créateur de la marine chilienne. Maria
Graham admira l'exubérance de la végétation, mais
se désola de trouver l'île à nouveau presque déserte.
Vers la fin de son séjour, son groupe de visiteurs rencontra seulement
un homme qui leur dit vivre là, avec quatre compagnons qu'ils ne
virent pas. Après la révolte contre le gouverneur, l'île
avait été abandonnée sur ordre des autorités
chiliennes. On n'y trouvait plus que des ruines et les traces d'anciennes
cultures revenues à l'état sauvage.
Le soir, je vais voir l'un des impacts des tirs des canons anglais sur le Dresden. Un obus s'est enfoncé dans la falaise, à peu de distance de l'hôtel. Une plage de galets y donne accès. Une échelle de planches permet de se hisser jusqu'au trou au fond duquel s'est incrusté le projectile. J'ai déjà vu l'autre impact, lors de la visite du cimetière dont il est proche. Le lendemain, mes compagnons partent pour la chasse aux chèvres, sur Santa Clara, l'île aux chèvres. Je ne les reverrai pas : je serai parti lorsqu'ils reviendront. Désormais seul à l'hôtel, j'aide mon hôtesse à réparer le groupe électrogène, lequel refuse obstinément de démarrer. Les bougies sont encrassées. Il suffit de les nettoyer. Ensuite, la préposée à l'électricité change de casquette et m'emmène à la découverte de son jardin. Pour protéger certaines plantations, elle a construit des serres en plastic. Mais de forts coups de vent les déchirent. Elle se plaint aussi des méfaits des lapins. Heureusement, elle possède un chien qui veille. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture de cet ange gardien des légumes. Son garde-manger est dans la montagne et il est bien garni! L'après-midi je monte jusqu'à la Sentinelle. Je traverse d'abord à gué un ruisseau grêlé de galets. Je dois ensuite traverser un pré où paît un troupeau de bovins. On escalade les fils de fer barbelés au moyen d'une échelle double rudimentaire faite de mauvaises planches. Je passe très loin des bêtes. Mais je m'aperçois que le taureau, qui est noir, me dévisage d'un air peu amène. Je n'arrive pas à me convaincre qu'il est jaloux; craint-il que je ne m'occupe un peu trop de ses femelles, dont la robe évoque celle des Salers de mon Auvergne natale? Au bout d'un moment, je trouve enfin la clé de l'énigme; elle est sur ma tête; je porte une casquette rouge. Je l'enlève et le taureau se remet à brouter sans plus s'intéresser à moi. La Sentinelle était autrefois un relais télégraphique édifié au sommet d'une montagne, pour surveiller la mer. Il communiquait avec les installations du village. Il est maintenant en ruine. On y jouit d'un beau point de vue sur plusieurs secteurs de l'île, notamment sur l'Anse des boucaniers français. Mais il faut y parvenir et le sentier, raviné par les pluies, n'est pas une autoroute. Enfin, j'y arrive. Ici, l'air est vif et sain. On goûte au plaisir particulier du frisson plongeant du vertige. La falaise n'est pas loin et une glissade déboucherait inévitablement sur la mort, cette chute sans fin de l'esprit dans le vide. Je me promène sur le plateau, puis je m'aventure à redescendre par un chemin qui me semble plus direct. J'y renonce bientôt. Il faut traverser des passages de roches nues et glissantes et, en contrebas, il n'y a aucune branche à laquelle s'accrocher en cas de chute. Un faux pas et c'est le plongeon assuré dans la mer, d'une hauteur qui terrifie. Je me demande si j'ai agi bien raisonnablement en me risquant seul par ici. Qui me retrouverait si j'étais accidenté? Comme je ne veux pas risquer mon destin et connaître, peut-être en plus grandiose, le sort de Selkirk suivant la chèvre qu'il poursuivait jusqu'au fond du gouffre, je sacrifie la renommée que me vaudrait peut-être un tel exploit, et je reviens par le chemin pris lors de la montée. Je rentre à l'hôtel trempé de sueur. Je n'ai jamais autant transpiré de ma vie. Mais le spectacle des pics, des vallées, des falaises et de la mer, vus de là haut, en valait la peine. Le lendemain, je fais la grasse matinée. Avant de déjeuner, je m'installe sur la terrasse où un massif de géranium attire les oiseaux-mouches, ou pique-fleurs. Il n'y a ici que des femelles au plumage gris. Les mâles sont plus colorés, mais on ne les rencontre guère qu'aux environs du jardin botanique. L'après-midi, je me dirige vers le village par les terres, puis je me rends au dernier lieu que je ne connais pas encore : la Plazoleta. De la demeure du couple allemand ne subsistent plus que les fondations. La Plazoleta est aujourd'hui un lieu de pique-nique, à l'écart de la bourgade. Sous les arbres, des bancs de bois ont été installés; il n'y a plus qu'à mettre la table. Autour, la végétation est exubérante. Je remarque, en particulier, une plante qui ressemble à une gigantesque rhubarbe; on l'appelle le parasol de Robinson, à cause de la forme de ses feuilles qui, retournées, peuvent effectivement jouer le rôle d'une vaste ombrelle. Bruce remarqua qu'à la Plazoleta les branches remuaient comme des jambes de ballerines. Je tente d'aller saluer notre ami le baroudeur. Mais il est absent. Peut-être est-il sorti en mer avec l'explorateur des fonds marins qui partage sa maison. Ce dernier devait dîner hier soir à l'hôtel en ma compagnie, mais il m'a fait faux bon. Je ne le verrai pas. S'il était venu, nous aurions eu la surprise de nous reconnaître. Nous nous sommes en effet déjà rencontrés à Santiago. Il est marié à une jeune femme française chez qui j'ai eu l'occasion d'aller, avec des amis qui sont ses voisins. J'ignorais alors quelle était l'activité du mari, comme j'ignore maintenant son identité. Cette dernière me sera incidemment révélée, plusieurs années plus tard, au cours d'un autre voyage au Chili. Il travaille sur un galion qu'il a localisé au large de l'île. Mais l'exploitation de sa découverte exige des capitaux importants et, finalement, l'entreprise n'aboutira pas. Je reviens à l'hôtel en passant par le jardin botanique. Les naufrages ont été nombreux dans les parages. Le Pacifique porte mal son nom et les approches de l'île ne sont pas faciles. En 1715, la flotte espagnole convoyant le trésor en provenance des colonies des Andes fit naufrage non loin de ses côtes. Les richesses perdues ne seront jamais retrouvées, et deviendront source de convoitise. Le corsaire anglais Shelvocke y perdit son voilier en 1720. Pour quitter l'île, il dut construire une embarcation de fortune, avec des arbres pris dans la forêt et les débris de son ancien navire. Le travail dura plusieurs mois. Voici comment il raconte cet événement dans son ouvrage : A Voyage round the World - London - 1755. Le 6 mai 1720, Shelvocke et son équipage arrivent, pour la seconde fois, à environ 12 lieues de l'archipel Juan Fernandez. Le jour suivant, le charpentier répare le navire. Vers onze heures, ils aperçoivent la grande île. Shelvocke louvoie puis jette l'ancre et fait descendre des barils sur la plage. Une fois remplis, ils sont montés sur le bateau. Le matin suivant, le navire est prêt à reprendre la mer. Mais pendant quatre jours cela lui est impossible à cause du temps. Il n'y a pas d'explication donnée pour ce qui concerne le délai qui s'écoule jusqu'au 25 mai. Le 25 mai, un fort coup de vent, venu de la mer, ce qui est inhabituel, projette le vaisseau contre les rochers. L'équipage doit s'accrocher fortement pour ne pas être précipité dans la mer par la violence du choc. Le navire est démâté. L'équipage, désemparé, en est réduit à la peu réjouissante perspective de mourir de faim sur une île déserte, si toutefois il n'est pas englouti dans les flots. Presque tous les hommes échappent au naufrage, excepté un seul. Il leur reste la rude tâche de ranimer leur courage et d'utiliser leur force pour sauver leur vie. Shelvocke réussit à retirer du désastre un peu de pain avant que le navire ne soit mis en pièces. Quelques instruments et livres de navigation sont également mis à l'abri. Alors que tombe la nuit, les rescapés se retrouvent sur le rivage, trempés, et dans une situation très inconfortable. Sous un ciel couvert, au milieu d'une nature sauvage, avec dans leurs oreilles les voix plaintives des animaux marins, ils se trouvent sans autre ressource que de s'asseoir sur le sol mouillé pour reposer leurs jambes fatiguées. Dans la soirée, les officiers se concertent sur les moyens de ramasser encore quelques vestiges du naufrage. Un feu est allumé et chacun, enroulé dans ce qu'il a sous la main, s'étend sur le sol et s'endort. Le lendemain matin, ils s'éveillent comme au sortir d'un mauvais rêve. Aucune illusion n'est possible, ils sont bel et bien prisonniers de l'île! Shelvocke tente de rassembler les hommes afin de se livrer aux travaux de récupération envisagés la veille. Mais le butin est maigre : on ne ramène guère que quelques petites armes. On aurait peut-être pu rapporter de la nourriture, boeuf ou porc, mais la plupart des hommes préfèrent dresser des tentes ou des huttes pour s'assurer un confort minimum pour la longue période où ils sont condamnés à vivre ici, pendant que le vent déchaîné continue à détruire les provisions. Shelvocke parvient néanmoins à sauver 1 100 dollars sur l'ensemble des avoirs de l'équipage, le reste étant inaccessible. Le sort a jeté les naufragés non seulement sur une terre inhabitée, au milieu d'un vaste océan, mais encore en un endroit dont les lieux habités les plus proches sont tenus par leurs pires ennemis, les Espagnols, dont ils n'ont rien à attendre de bon. Aussi l'idée ne vient-elle à personne d'espérer leurs secours! Shelvocke, non sans mal, trouve un endroit convenable pour établir son campement, à un demi mile (800 m) du rivage, près d'un ruisseau, bordé de rochers, environné d'arbres utiles, avec de quoi faire du feu à proximité, et où la visibilité permet de découvrir rapidement la présence d'un ennemi. Les hommes s'assemblent autour de lui, en se pourvoyant de peau d'animaux marins pour faire face à la froide saison qui s'annonce. Le capitaine prend la décision, pour protéger la santé de ses hommes, de partager la nourriture qu'ils pourront se procurer. Ils se sustenteront essentiellement de coquillages, d'animaux marins et de poissons, ainsi que de légumes du cru (chou palmiste). Le temps s'écoule ainsi dans l'attente de l'hiver, autour d'un feu où cuisent les produits de la pêche. Les uns et les autres passent alternativement de périodes de désespoir en époques d'euphorie à l'idée de construire une barque qui pourrait leur permettre de gagner à nouveau le large. Cette idée taraude Shelvocke qui la soumet à son charpentier. Celui-ci la goûte peu. Il répond abruptement qu'il ne peut pas construire un brick sans paille avant de s'éloigner furieux! Le capitaine s'adresse alors à son armurier qui lui assure qu'il a recueilli assez de fer pour tenter l'aventure. Il a même sauvé sa forge. Shelvocke présente son projet à ses hommes, sans leur cacher l'ampleur des travaux à accomplir, leurs difficultés, et le peu de chance de réussir. Il leur demande ensuite s'ils sont disposé à consentir les sacrifices correspondants. Un cri unanime affirmatif lui répond! Les hommes se mettent donc immédiatement au travail sous la direction de leur capitaine. Ils utilisent les débris du naufrage et les complètent par des prélèvements sur l'environnement. Le 8 juillet, le projet commence à prendre forme. Mais, tout à coup, le charpentier refuse d'aller plus loin. Shelvocke lui caresse d'abord un peu le dos avec sa canne, puis, pensant qu'il n'en tirera rien ainsi, il en vient à lui graisser la patte avec la promesse d'un solde conséquent lors de l'achèvement des travaux. Les travaux reprennent. Se procurer les bois de qualité indispensables n'est pas tâche aisée et, quand on en trouve, ils sont éloignés, presque inaccessibles. On doit les transporter à bras par collines, rochers et vallons. Les arbres aptes à la confection des mâts, en particulier, ne sont pas légion sur l'île! La diligence et l'ingéniosité de l'armurier, Popplestone fait merveille. Au début, tout se passe bien. Les hommes travaillent ferme sans regimber, malgré les insuffisances de la nourriture. Ils respectent leur capitaine. Et celui-ci leur fait miroiter la perspective de s'emparer, avec leur barque, de quelque navire marchand qui leur procurera confort et meilleure fortune. Les ouvriers improvisés se contentent de ces promesses. Mais, avec le temps, leur moral faiblit. Ils travaillent plus négligemment, malgré qu'une grande partie de la barque soit déjà construite. Les officiers eux-mêmes n'appuient plus leur capitaine qui sent venir de terribles événements. Pour les prévenir, Shelvocke convoque une partie de l'équipage. Mais les hommes conviés à la réunion se concertent avant et se mutinent. Ils reprochent à leur capitaine son caractère autoritaire et son penchant à se conduire en officier de la marine de guerre, imprégné d'esprit de discipline, plutôt qu'en frère de la côte libertaire. Ils le déposent. Ses principaux lieutenants participent au complot. Sous la pression, Shelvocke décide de signer un texte que lui soumettent les mutins. Le lendemain, ces derniers se réunissent à nouveau sous le grand arbre où ils tiennent leurs séances. Le jour d'après, ils se présentent à l'abri de Shelvocke et obtiennent de lui une somme d'argent appartenant à l'équipage sous la menace. L'ancien capitaine est complètement isolé. Aucun officier ne daigne plus manger avec lui! Approvisionné par un Noir, qui tue des animaux marins et cueille des choux palmistes à son profit, il n'a plus pour convives que son fils, le chirurgien et le Noir! Shelvocke, complètement démoralisé, envisage un moment de s'enfuir avec la barque inachevée. Les mutins lui enlèvent ses armes qui représentent pour eux une menace et gâchent sa poudre en tirant à tort et à travers. Le 15 août 1720, l'arrivée inopinée d'un navire inconnu met les naufragés en émoi. Shelvocke, seul capable de réagir intelligemment à une telle situation, retrouve un regain de prestige. Il sermonne ses hommes en leur rappelant que seul l'achèvement de la barque leur permettra de quitter l'île et d'échapper aux geôles ou aux mines espagnoles. Mais le navire passe au large sans s'arrêter et l'embellie est de courte durée. Cependant, deux camps commencent à se séparer. Les uns tiennent pour l'achèvement de la barque et les autres, menés par les mutins, pour sa destruction et la construction d'un navire plus important. Shelvocke intervient dans la discussion et démontre que le débat est sans objet car tous les moyens nécessaires ont déjà été épuisés pour la barque; la construction d'un autre bateau plus grand est évidemment devenu impossible. Le vote qui suit est favorable à l'ancien capitaine. Mais, pendant la nuit, le charpentier exige la somme qui devait lui être remise lors de l'achèvement de la barque! Shelvocke est menacé d'être abandonné sur l'île, s'il ne se soumet pas aux exigences des mutins. Un troisième parti se déclare. Il rassemble tous ceux qui ne veulent plus quitter l'île. Cette division amène un changement important. Beaucoup d'hommes se remettent à travailler. L'influence des mutins décline et ils cherchent à se rapprocher du capitaine qu'ils ont destitué, son remplaçant en tête. Le travail avance, mais un problème se pose au moment de la pose du pont. Les matériaux abîmés ne conviennent plus. Le départ de l'île est de nouveau mis en question. Mais la crainte d'être finalement découvert par les Espagnols stimule l'ingéniosité de l'équipage qui finit par trouver un expédient tel que l'on n'en a jamais vu, d'après Shelvocke. Le 9 septembre, la barque terminée est mise à l'eau. Il reste à préparer le grand départ en sélectionnant la qualité et la quantité des provisions à emporter. Il ne faut songer ni à la viande d'otarie, ni aux poissons, les essais de conservation s'étant montrés infructueux. Un premier test de la barque est effectué dans l'attente anxieuse de ceux qui, demeurés sur l'île, craignent que leurs compagnons ne se fassent la belle en les y laissant. Heureusement, ils reviennent avec un copieux chargement de poissons. Un canon du naufrage est retiré de l'eau où il avait sombré. La barque est utilisée pour la pêche en attendant le grand départ. Un jour, une voie d'eau se déclare. Shelkvocke craint que le découragement ne gagne à nouveau l'équipage. Mais tout est remis raidement en état. On prêche la patience à ceux qui trépignent, la prudence incitant à prendre la mer après la fin de la mauvaise saison. Le 5 octobre, qui coïncide avec une marée favorable, est final retenu. On sera alors au milieu du printemps austral. Au moment de l'embarquement, un nouvel incident se produit, mais il s'avère heureusement sans gravité. On baptise la barque the Recovery. Pour toute ancre, ce bateau improvisé ne dispose que d'une grosse pierre retenue par une corde! Le 6 octobre, tout étant à bord, la barque à deux mats, s'éloigne du rivage. Elle laisse à terre 11 à 12 hommes du troisième parti qui, d'après leurs dires, ne se sentent pas prêts à affronter l'autre monde. Treize hommes de couleurs (Noirs et Indiens) partagent leur sort. L'histoire ne dit pas ce qu'ils sont devenus. On présume qu'ils se sont rendus aux Espagnols. En tous cas, lorsque Rogewein aborde sur l'île, deux ans plus tard, il n'y voit personne. Shelvocke réussira et pourra narrer la suite de ses exploits maritimes et terrestres. En 1996, l'ancre de son bateau perdu sera ramenée à la surface et enrichira le petit musée de l'île. Mas a Tierra continuait néanmoins de recevoir la visite périodique de vaisseaux étrangers et suscitait l'intérêt de l'opinion britannique. En 1765, John Byron s'y arrêta quelques jours, après son deuxième passage du Détroit de Magellan, lors de son voyage au tour du globe. En 1786, Joseph Townsend situa sur l'archipel une fable où des chiens et des chèvres déposées par Juan Fernandez entraient en compétition pour la nourriture. Cette fable lui servait à soutenir la thèse selon laquelle les lois de la nature, ou les rapports spontanés entre différentes populations ou classes sociales suffisent à créer un équilibre où chacun trouve son compte, dans le débat pour l'abolition des poor laws qui avait lieu en Angleterre à cette époque. D'après l'historien de la biologie, André Pichot, cette fable inspira Charles Darwin dans l'élaboration du mécanisme de la sélection naturelle, il en aurait pris connaissance grâce à la féministe néo-malthusienne Harriet Martineau que fréquentait son frère. En 1792, le lieutenant John Moss de la marine britannique, visita les lieux et y trouva une petite bourgade d'une quarantaine de maisons dont la situation paraissait prospère (Howell); les femmes y portaient un jupon court qui descendait à peine au dessous du genou; leurs jambes étaient nues, mais des sous-vêtements cachaient leur intimité; leurs cheveux, longs et divisés en quatorze ou quinze tresses, pendaient sur leur dos. Dans chaque maison, on buvait du maté et il y avait beaucoup d'enfants. En 1797, le navire Betsy fit escale à Mas a Tierra et y embarqua un million de peaux d'otaries, en abandonnant 400 000 autres sur le rivage, faute de place à bord. En 1851, l'archipel fut rattaché à Valparaiso. La goélette française Le Télégraphe coula au voisinage de l'île en 1891, à la suite d'une mutinerie de l'équipage. Il n'y eut qu'un seul rescapé, Antoine-Désiré Charpentier, ancêtre du maire de Juan Bautista. Les aventures du naufragé ont été relatées par l'écrivain Robert Gaillard dans "Le dernier naufragé de l'île de Robinson - Bourrelier et Cie, 1938". Ce récit, largement romancé, semble suspect sur bien des points pour ce qui concerne sa véracité historique, bien qu'il soit inspiré, d'après son auteur, du Journal laissé par Félix (sic) Charpentier. Ce dernier, un jeune ingénieur agronome français, correspondant de l'Académie des Sciences, avait soutenu devant cette docte assemblée une idée qui lui était chère, celle d'extraire l'azote de l'air pour fabriquer des engrais plus riches au bénéfice de l'Agriculture. Cette idée ne rencontra par le succès qu'il en attendait et les scientifiques renommés se moquèrent même du jeune novateur. Mortifié, celui-ci décida de tenter sa chance ailleurs et il choisit le Chili. C'est ainsi qu'il se trouve, le 3 juillet 1891, comme passager sur la corvette le Télégraphe, dans le Pacifique, voguant vers Valparaiso. Après une navigation sans histoire, l'atmosphère sur le bateau s'alourdit. Le capitaine est visiblement soucieux, et son humeur s'en ressent. Il devient bourru, et il laisse entendre à Charpentier, sans lui préciser les raisons de son inquiétude, qu'il espère que cette traversée ne sera pas le dernier voyage de son passager. Il lui confie même un revolver qui lui permettra de se défendre, le cas échéant, sans lui en dire plus. Un moment plus tard, après être passé par sa cabine, Charpentier remonte sans arme sur le pont. Il y retrouve le capitaine qui, un fouet dans une main et un pistolet dans l'autre, essaie de raisonner trois marins ivres qui refusent d'exécuter ses ordres. Ces ordres sont d'autant plus pressants que la mer enfle et qu'une tempête se prépare. Le capitaine, qui aperçoit son passager, lui intime l'ordre de retourner dans sa cabine. Une fois là, Charpentier comprend que la mutinerie ne lui laisse le choix que de périr assassiné ou noyé dans un navire en perdition que la tempête va fracasser sur les rochers. Honteux de laisser le capitaine affronter seul son équipage, alors qu'il dispose d'une arme, il décide de retourner sur le pont pour se joindre à l'officier. Cette fois-ci 19 hommes font face à lui. Une lame brille entre les mains d'un marin portugais. Charpentier s'apprête à tirer. Le capitaine le devance et tue le marin. Alors, la colère des mutins se déchaîne. Ils n'ont pas d'armes à feu, mais possèdent des coutelas et des barres de fer. Le capitaine et son passager tentent de courir se réfugier derrière des barils de poissons secs, d'huile et de goudron, à l'arrière du vaisseau. Malheureusement, le capitaine trébuche et chute. Il est immédiatement poignardé dans le dos. Charpentier, dont la force est décuplée par le danger, parvient jusqu'aux barils. Six balles garnissent son barillet et il compte bien se défendre jusqu'au bout. A peine est-il derrière son rempart de tonneaux qu'un marin plus rapide que les autres bondit à ses côtés. Il l'abat d'une balle en pleine poitrine. Mais d'autres arrivent, notamment un colosse, à demi sauvage, recruté récemment lors d'une escale. L'homme est déjà sur lui. Charpentier tire une balle, mais le coup ne part pas! Notre héros se sent perdu. Le colosse tend les bras pour le saisir. Il est accompagné par une quinzaine de forbans vigoureux exhibant victorieusement leurs bras noueux et leurs poings fermes. Le colosse éclate d'un rire dément et satanique, qui donne la chair de poule à sa proie. C'est alors qu'un énorme craquement secoue le navire, comme si une explosion s'était produite en son sein. Charpentier, providentiellement tiré des griffes de ses adversaires, est précipité à l'eau et se met à nager, sous une pluie de débris divers, à l'aveugle, car la nuit est maintenant tombée. A peine voit-il le Télégraphe se coucher, se renverser, quille haute, avant de sombrer définitivement à proximité du récif qu'il vient de heurter. La présence de l'écueil incite le naufragé à nager dans sa direction en estimant qu'une côte est peut-être proche. En effet, il atteint enfin une plage où, épuisé par ses efforts et ses émotions, il s'endort profondément. Le lendemain, lorsqu'il s'éveille, le soleil brille. Des aboiements de chiens lui laissent espérer une présence humaine. Il appelle. Hélas, il n'aperçoit qu'une dizaine de petits chiens, que sa présence alarme sans doute, au sommet d'une dune. Sans le savoir, notre homme vient d'atterrir sur Santa Clara, l'île aux chèvres, à peu de distance de l'île de Robinson Crusoë. Il se rend sur les lieux du naufrage mais ne retrouve pas grand chose, ce qui l'amène à penser qu'il en est le seul rescapé. Avec un clou rouillé et une liane, il se fabrique une ligne. Il se nourrit d'abord de coquillages et de poissons crus, car il n'a rien pour faire du feu. Par bonheur, il trouve une caisse du Télégraphe qui contient du papier, et des crayons, ce qui lui permettra au moins de tenir son journal, ainsi qu'une paire de ciseaux. Le 7 juillet, il tente de se saisir d'un chien pour se doter d'une compagnie et décide de l'appeler Vendredi. Il est cruellement mordu et Vendredi s'échappe. Il décide, avec le seul secours de ses ciseaux, de construire un radeau, dans du bois de fromager, un bois très tendre. En l'absence de lianes adéquates, il lie les troncs du radeaux avec des stolons, robustes et épais, de fraisiers géants. Le 8 juillet, dans la forêt voisine, il croit apercevoir un sanglier. Le 9 juillet, il affronte la mer avec son radeau, mu par deux rames improvisées fabriquées avec les ciseaux. Il plonge jusqu'à l'épave d'où il ramène un fusil gras de la guerre de 1870, deux fusils de chasse, dont l'un à amorces, avec les amorces qui vont avec, une de ses malles contenant des cornues et autres tubes de verre qui, hélas, s'avéreront brisés, et deux coutelas, dont l'un évoque une machette. Malheureusement, il n'y a là rien qui permettent de faire du feu, et la perspective de vivre de poissons crus le désole d'autant plus qu'il attribue à ce régime les boutons qui lui sont venus sur la peau. Le 10 juillet, il ramène de l'épave deux bonbonnes protégées par des nattes de fibres très bien tressées. L'une de ces bonbonnes contient de l'acide azotique fumant, et l'autre du vitriol (acide sulfurique). En plus de ces bonbonnes, il rapporte aussi une bouilloire, une bouteille et une soucoupe plate. Le 11 juillet, au cours d'une escapade en forêt, il découvre le village des chiens sauvages, qui habitent des terriers creusés dans le sol comme des lapins. Soudain, il ressent la peur de sa vie, un troupeau de boeufs sauvages, du type des bisons d'Amérique, dévale la pente droit sur lui. Pour éviter d'être broyé sous leurs pieds, il n'a que le temps de se jeter dans un marécage voisin! Il prend conscience qu'il lui faut se pourvoir d'un fusil pour se défendre, sans perdre l'idée de se trouver un compagnon, afin de ne pas être contraint de passer sa vie à rester tout le temps sur le qui vive. Cette scène inspirée du far-west est évidemment suspecte car il n'y a certainement jamais eu de bisons sur l'île aux chèvres! Le 12 juillet, Charpentier profite d'une marée basse exceptionnelle pour se rendre une fois de plus auprès de l'épave, dont la coque est partiellement découverte. Ce sera sa dernière visite car il doit y affronter une otarie. L'approche devient dangereuse. Il en rapporte un chaudron, des casseroles, et surtout un morceau de plomb détaché de la quille. Le 13 juillet, il tente en vain d'enflammer deux morceaux de bois secs en les frottant l'un contre l'autre mais ne parvient qu'à les roussir. Découragé, il pense au suicide; mais il n'a plus son pistolet. Ses piqûres d'insectes s'enveniment. Jusqu'alors, il se croyait sur la côte chilienne. Mais une promenade le détrompe : il lui semble être sur un île! Le 14 juillet, grâce à ses connaissance en chimie, il fabrique un explosif avec les acides ramenés de l'épave. Il va pouvoir utiliser son fusil à amorces. Il fabrique un succédané de poudre en laissant tremper du papier dans un mélange d'acide. Le plomb dont il dispose, travaillé au couteau, lui permet de tourner des balles. Il teste ses inventions en tirant sur un tronc d'arbre où la balle s'enfonce profondément. Il parvient enfin à obtenir du feu en frottant deux morceaux de bois. Il va pouvoir chasser, en plus de pêcher, et cuire sa nourriture dans les casseroles et le chaudron. Il se fabrique une paire de mocassins. Le 15 juillet, il blesse un chèvre, qu'il égorge sans remords, malgré les pleurs de l'animal. Il se fabrique une pipe en merisier. Le 17 juillet, il fume une herbe qui ressemble à du tabac. Le 18 juillet, il se prépare à partir à la chasse au bison (c'est l'auteur du récit qui l'affirme). Dans la forêt, il rencontre de nombreux écureuils (à l'existence aussi douteuse que celle des bisons!). Dans des clairières, il rencontre des pécaris (à la présence aussi improbable que celle des autres animaux évoqués ci-dessus). Il tire un bison entre les yeux, mais, une fois la fumée dispersée, il s'aperçoit que l'animal est toujours debout et secoue la tête comme pour se débarrasser d'une mouche importune. Il recharge son fusil et vise le coeur, au défaut de l'épaule. Cette fois l'animal tombe et agonise. Il retrouve la première balle aplatie sur le crâne dans l'épaisse chevelure de la bête. Le 19 juillet, il fabrique du pemmican avec la viande et tanne la peau du bison. Tout ce qu'il réalise, résulte des souvenirs de ses lectures, qui ont visiblement inspirées l'auteur du récit! Miracle, il s'aperçoit que l'arbre sur lequel il a essayé son fusil était un érable (y a-t-il jamais eu un arbre de cette espèce sur l'île aux chèvres?). Une abondante sève en coule, qu'il va pouvoir convertir en sucre avec lequel il pourra édulcorer un ersatz de café! Il transforme une pierre creuse en quinquet; un morceau de sa chemise fournit la mèche et l'huile proviendra de la chasse aux phoques. Reste à fabriquer de l'encre pour tenir son journal, pour ce qui est des plumes, il y en a pléthore sur de dos des oiseaux! Le 22 juillet, il passe la nuit à se défendre contre les chiens sauvages qui ont flairé la présence du sucre. Il finit par s'en débarrasser, sauf un qui, plus gourmand que les autres, et surtout plus gourmand que peureux, cède aux avances de l'homme qui lui réserve sa meilleure écume d'eau de bouleau en cours de réduction. Peu à peu, le petit chien s'adapte et voilà Charpentier pourvu d'un Vendredi. Pour ce qui est de l'encre, il en confectionne avec de la poudre d'os calcinés mélangée à la gomme d'un arbre délayées dans l'eau; la plume est prélevée sur une frégate tuée d'un coup de fusil. Le 25 juillet, il part à la chasse avec son chien, afin de vérifier l'attachement de celui-ci, non pas à son maître, mais à son sucre. Pour cela, il se pourvoit d'une bonne quantité de cet aliment dulcifiant, dont il gratifie fréquemment l'animal. Il amène ce dernier dans la forêt, près du chenil creusé dans le sol. L'expérience réussit : le chien préfère le sucre au retour parmi ses congénères. Comme une tempête menace, et aussi parce qu'il souhaite explorer plus soigneusement l'endroit où il se trouve, Charpentier creuse une cache, à la mode des pirates, selon ses lectures, afin d'y mettre ses maigres biens à l'abri contre les intempéries et contre un hypothétique larcin, dans la grotte où il s'est établi, et où il dort sur un lit de varech. La nuit est terrible, mais le jour venu, il a la satisfaction de se saisir d'un tonneau de suif, d'abord pris pour une baleine, qui s'est détaché sans doute du pont d'un navire. Malheureusement, effrayé par l'orage, son chien s'est enfui. Le 29 juillet, après une exploration plus approfondie du territoire, plus aucun doute n'est permis : il se trouve bien sur une île. Mais il pense avoir aperçu, derrière la brume, une autre terre assez proche de son île. S'agit-il d'un continent ou d'une autre île? Et si c'est une île, est-elle peuplée, et par qui? Ces questions lui taraudent l'esprit et, comme la distance est trop grande pour son fragile radeau, il décide de construire une barque en façonnant, à coups de machette, des troncs de liriodendrons, des espèces de tulipiers géants, dont le bois n'est pas trop dur. Le 4 août, le canot terminé est étanché avec le suif du tonneau. Une paire des rames l'accompagne. L'essai en mer de l'ensemble est concluant. Pendant la nuit, un bruit suspect réveille Charpentier. Sur ses gardes, il sort de sa grotte et se dirige vers l'endroit d'où provient le bruit. Il aperçoit une bête qui lui paraît d'abord être un chat. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il s'agit de son petit chien qui, d'abord apeuré, se blottit contre le sol dans l'attitude d'un animal qui s'attend à recevoir une correction. A force de patience et de cajolerie, l'homme finit par rassurer l'animal. Celui-ci est gravement blessé. Affolé, par l'orage, il a sans doute tenté de rejoindre les siens et ces derniers l'ont chassé impitoyablement, non sans le mordre sauvagement pour se venger de sa désertion. Il est alors revenu auprès de son maître pour y trouver refuge et secours. Le 5 août, le canot est remis à l'eau et Charpentier procède à un nouveau test. Tout va bien. Mais le voyage est remis jusqu'à la guérison de son petit compagnon. Charpentier en profite pour chasser. Tirer à balle sur un oiseau exige une grande sûreté, une grande précision. La grenaille obtenu avec un couteau n'a pas assez de force pour tuer un volatile. Fabriquer des plombs serait facile, mais il faudrait une passoire! Le 7 août, le petit chien est presque guéri. Charpentier tente l'expérience de le faire monter dans son canot. Ils prennent la mer. L'animal manifeste d'abord une terreur assez vive, mais grâce au sucre et à des paroles bienveillantes, il se tranquillise. Le départ sera pour demain. Il faudrait baptiser l'animal; Vendredi ne saurait plus convenir; Charpentier pense à Platon. Ce n'est pas sans émotion qu'il s'apprête à quitter son île, peut-être pour toujours. De quoi son avenir sera-t-il fait sur l'autre terre? Le 9 août, la traversée est effectuée sans incident, si ce n'est le hurlement à la mort du petit chien, sinistre présage, au moment de quitter l'île aux chèvres, Charpentier et son compagnon à quatre pattes sont sur une terre nouvelle. Notre homme s'aperçoit vite qu'il se trouve sur une autre île, déserte, montagneuse, aride et inculte : Mas a Tierra, l'île de Robinson Crusoë. Le 10 août, il cherche une source où se désaltérer. Le 11 août, à midi, il trouve enfin un ruisseau et de la végétation. Le 12 août, il se rend compte que cette île est habitée. Trois individus, qui ne l'ont pas encore aperçu, s'avancent vers lui. Ne sachant pas quel sort ils lui réservent, il préfère se dissimuler. Mais son chien se met malencontreusement à les agonir d'aboiements. Un Araucan, particulièrement découplé, se précipite sur lui. Charpentier l'abat d'un coup de fusil, avant de s'en repentir. Cela suffit à mettre les deux autres en fuite. Mais ils vont certainement revenir avec du renfort! Charpentier se cache et voudrait fuir, mais il n'en a pas le temps. Pendant la nuit, du bruit et des lanternes qui vacillent lui montrent que la chasse à l'homme est ouverte. Le journal ne reprend que le quatre octobre. Entre temps, il a été capturé sans ménagement par une troupe comprenant deux Blancs. Bourré de horions, son fusil brisé et son chien rebaptisé Toutcho, ce qui lui va certainement mieux que Platon, il s'est retrouvé ligoté et jeté dans le fond d'une case. Là, un Blanc, accompagné de deux Araucans, vient l'y voir. Il parle un français excellent et lui demande quelle est sa nationalité. Charpentier répond qu'il est Français. "Je m'en doutais rétorque, l'inconnu." Notre héros précise qu'il est né à Lugrin, sur les bords du lac de Genève. L'atmosphère se détend car le nouveau venu est Suisse. L'interrogatoire continue et Charpentier déclare que, s'il est sur cette île, c'est par la suite d'un naufrage. C'est justement ce que son interlocuteur voulait savoir. Le Suisse décline son nom; il s'appelle Juquin et vit sur l'île en compagnie d'un autre Suisse qui se nomme de Rodt. Charpentier ne tarde pas à faire la connaissance de ce dernier. Les deux Suisses portent moustaches et barbiche à la Napoléon III. Alfred de Rodt, après avoir combattu les Prussiens qu'il déteste à Sadowa, a participé du côté français à la guerre de 1870, dans une unité fondée par le romancier d'aventures Gustave Aymard (que Robert Gaillard s'efforce visiblement d'imiter). Ensuite, déçu par l'Europe autant que gagné par l'esprit d'aventure, il se rend en Amérique latine pour y fonder une colonie sur l'île de Robinson Crusoë qui s'appelle encore Juan Fernandez avec une dizaine de compatriotes, dont plus de la moitié décèdent. Il complète le contingent à Valaparaiso avec des Indiens et des Noirs (pour ce qui est de Noirs, c'est contestable, les esclaves succombant au passage de la Cordillère des Andes). De Rodt épouse une jeune et jolie métisse et fonde San Juan Bautista, où vivent une centaine de personnes hétéroclites au plan de la nationalité (fonde est impropre puisqu'un village a déjà existé sur les lieux, disons qu'il le relève de ses cendres et peut-être le baptise). De Rodt accueille Charpentier avec sympathie. Il est heureux de voir venir à lui un homme de science et demande au Français de commencer par guérir Tangarupa, l'Araucan, blessé d'un coup de fusil à l'épaule, qui n'en est pas mort. Charpentier n'est pas médecin, mais il extrait la balle et soigne son patient comme il le peut avec des herbes. Celui-ci guérit et le docteur improvisé gagne l'amitié du malade qu'il a lui-même navré! De Rodt règne en maître sur une petite société de type socialiste dans l'orbite du Chili. Charpentier lui ayant fait part de ses projets, le Suisse le dissuade de se rendre sur le continent où l'accueil qu'il recevra sera aussi décevant qu'en Europe. Il l'engage à rester sur l'île où ses expériences, au contraire, seront encouragées et suivies avec intérêt. Notre savant accepte. Les deux nouveaux amis échangent une vigoureuse poignée de main. Charpentier, qui possède quelques notions de navigation, se voit confier la mission d'aller chercher des bêtes à cornes sur le continent avec une baleinière au repos, faute de capitaine. Tangarupa l'accompagne. Ils abordent près de Conception et se rendent dans une fonda où on leur indique un endroit où ils pourront acquérir des bêtes. Il leur faut traverser un désert où la sagacité de l'Araucan et sa connaissance du terrain s'avérent très utiles. Les deux hommes se désaltèrent en déterrant des racines gorgées d'eau; ils évitent les termitières; ils se réfugient sur une île pour éviter des fourmis, mais celles-ci sont si nombreuses qu'elles abattent un arbre en grignotant son tronc; les porteuses de mandibules se sont ainsi dotées d'un pont et vont pouvoir déchiqueter leurs proies : les deux hommes et leurs chevaux; nos deux amis jettent l'arbre dans la rivière, mais ils ne sont pas tirés d'affaire car des lianes continuent de l'attacher au-dessus de leur tête aux frondaisons qui surplombent leur retraite; heureusement, un tamandua (fourmilier), le terrible mangeurs de fourmis, aidé par des grives non moins friandes de ces insectes à la ténacité proverbiale, sauvent nos amis et leurs chevaux d'une mort cruelle (on est là en plein roman d'aventures; j'ai mangé moi-même des fourmis, prélevées sous l'écorce des arbres, en compagnie d'Indiens guyanais; elles avaient un goût acidulé et apportaient un complément alimentaire à la tribu). Nos deux hommes achètent cinquante bêtes. Mais, revenus à Conception, il ne leur reste plus que dix boeufs et quinze vaches qu'ils ramènent à l'île Juan Fernandez sur leur baleinière. Toute la population du village est sur le port pour les accueillir. Charpentier revoit avec beaucoup de plaisir Vaïti, l'espiègle et sémillante belle soeur de de Rodt. Mais les congratulations tournent court. De Rodt tire Charpentier à l'écart et l'amène vers un quidam en uniforme, envoyé du pouvoir chilien, qui ordonne l'évacuation immédiate de l'île par ses habitants! Il menace en remarquant que les insulaires n'ont pas les moyens de se défendre. De Rodt réplique qu'il détient assez d'explosifs pour faire sauter l'île et envoyer par le fond la Santa Maria qui a amené là cet outrecuidant commissaire. Celui-ci réplique mais perd de sa hauteur. De Rodt poursuit qu'il ne vient pas d'un pays où les gens se rendent tant qu'ils ont des armes à la main. L'agent chilien, Perez de Alfera, demande qu'elle est la nationalité de son interlocuteur. De Rodt précise qu'il est Suisse, que ses parents ont été soldats de Napoléon 1er, et que lui-même a combattu sous Napoléon III. L'attitude du Chilien change du tout au tout. "Comment, dit-il, vous avez connu Napoléon? Que souhaitez-vous, Monsieur de Rodt?" "Rien d'autre que de rester sur cette île, déserte jusqu'à mon arrivée, et que j'ai rendue fertile." "Je puis arranger cela et obtenir pour vous la régie de cette île moyennant un loyer annuel de 1 500 livres. Et c'est ainsi que l'affaire est réglée. La vie continue sur l'île où la nourriture est d'autant plus abondante que les cultures vivrières sont stimulées par les engrais de Charpentier. Un jour, cependant, la mauvaise fortune lui fait connaître le sort d'Alexandre Selkirk. En poursuivant une chèvre, il glisse, tombe dans une crevasse, et s'empale sur une branche pointue. Heureusement, Tangarupa et Toutcho ne sont pas loin. L'Araucan, s'il ne sait pas soigner une blessure par balle, s'y connaît parfaitement lorsque la plaie a été causée par une lance, fût-elle en bois. Notre chimiste est donc ramené à son logis sur un brancard de fortune et dûment soigné à renfort de compresses d'herbes, sous la surveillance de la charmante Vaïni, et tout cela bien sûr, finit, comme dans tous les bons romans par un mariage, célébré par de Rodt en tant que chargé de la tenue de l'état-civil. A quelques temps de là, un navire anglais s'approche de l'île. A son bord se trouve un Français fortuné que sa fantaisie entraîne à la découverte du vaste monde. Il s'appelle Louis P. Recart et décide lui aussi de se fixer sur l'île. En furetant à travers pics et vallées, nos amis découvrent de nouvelles ressources alimentaires et jusqu'à du miel fournit par des abeilles sauvages. Mais il faut savoir retrouver les ruches et Tangarupa seul détient ce secret qu'il livre aux Européens au court d'une démonstration. Cette dernière est pittoresque à souhait, mais complètement fictive, car les abeilles sont si bien cachées que personne ne semble jamais en avoir vu dans l'île! Recart, qui trouve les langoustes délicieuses, en homme d'affaires avisé, songe à les commercialiser. Mais une catastrophe survient soudain. La mer se recouvre de sang et la population du village est saisie de panique. Charpentier rassure en expliquant que ce sont des insectes minuscules qui flottent parfois sur la mer aux environs de l'Équateur (on se souvient du frai de poisson qui a donné lieu à ce genre de phénomène rapporté par Rodgers). L'alerte est de courte durée. Recart reprend son idée d'exportation des langoustes. Pour y parvenir, on doit d'abord obtenir le monopole de la pêche auprès du gouvernement chilien. Ensuite, il faudra se pourvoir de bateaux-viviers, que l'on ne peut pas construire à Valparaiso. Charpentier est chargé des deux missions. Recart étant l'associé d'un Brésilien, Duriez, qui tient une scierie, on songe aussi à lui. Le 12 mai 1893, Charpentier reprend la plume. Entre temps, il est retourné en France. La fabrication des bateaux-viviers s'avérant impossible au Chili, Recart lui a conseillé d'aller en chercher dans leur pays. Plutôt que de revenir avec des bateaux, notre héros en ramène des plans qui pourront être exécutés de manière moins coûteuse au Chili. Mais, ayant rencontré des amis européens, il leur a aussi parlé du journal qu'il tient et ceux-ci, intrigués et poussés par la curiosité, l'ont engagé à le leur envoyer. C'est ainsi que ce document serait parvenu jusqu'à Robert Gaillard. Mais, si cela est exact, pourquoi ce dernier n'a-t-il pas publié ce document en appendice de son roman? La pêche à la langouste s'avère une réussite internationale, tant et si bien qu'une conserverie de langouste est construite et qu'une flotte de baleinières s'installe dans le port pour accroître les prises. Alfred de Rodt meurt en 1905. Les cinq enfants de Charpentier, qui vit jusqu'à 1924, font souche avec ceux de De Rodt. Leur descendance commune y est encore. Comment démêler le vrai du faux dans le roman de Gaillard? Chacun y prendra ce qui lui convient! Louis P. Recart, dont je n'ai guère trouvé de trace que dans le numéro du 14 février 1923 du Salut Public, avec la mention qu'il aurait obtenu une concession de pêche du gouvernement chilien, conjointement avec un autre Français du nom de Fontaine, est-il celui qui aurait rencontré Charpentier et de Rodt? Le doute est permis, mais l'association des deux Français est vraisemblable. Pour ce qui est du naufrage et des péripéties qui l'ont suivi, pour ma part, je juge plus crédible la relation de Georges-Henri Simon, recueillie peut-être auprès de la famille du rescapé. L'écrit, surtout lorsqu'il est romancé, n'est pas toujours une source plus sûre que le témoignage oral. Le capitaine Brothier aurait oublié de fermer la porte de la cambuse où était serrée l'eau de vie. Les marins s'en seraient rendu compte et en auraient surabondamment profité. Quelques-uns seraient monté sur le pont et aurait agressé le capitaine. Ce dernier, armé d'un pistolet, aurait abattu deux de ses hommes particulièrement violents et éméchés. Il aurait consigné Charpentier dans sa cabine et pris lui-même la barre, ses hommes ne lui obéissant plus, et étant de toute manière incapables d'entreprendre la moindre manoeuvre. Malheureusement, la mer était mauvaise et les abords semés d'îlots rocheux. Le timonier improvisé s'aperçut rapidement qu'il ne contrôlait plus son navire. La catastrophe était inévitable. Un énorme craquement se fit bientôt entendre. Le vaisseau venait de heurter un rocher qui avait crevé sa quille tandis que de furieuses vagues le secouaient et le démantelaient. Charpentier, jeté d'un coin à un autre, fut précipité à la mer avec une bouée. Il faisait nuit. Dans la tempête, il décida d'essayer de se diriger vers une côte qui ne devait pas manquer de se trouver aux delà des écueils. Après de longs et pénibles efforts, contre les éléments déchaînés, il finit par aborder sur du sable, complètement épuisé. Il chercha un endroit pour y attendre le jour, s'installa du mieux qu'il put et sombra dans un profond sommeil. Il se trouvait à Puerto Ingles, c'est-à-dire là où avait été abandonné naguère Selkirk, et non pas sur l'île des chèvres! Au matin, il se réveilla dans un endroit loin d'être accueillant, sur une plage inconnue, cernée de hautes montagnes couvertes d'une végétation sauvage qui laissait supposer l'absence de vie humaine. L'angoisse le prit. N'avait-il échappé au naufrage, où avaient péri le capitaine en accomplissant son devoir, et les matelots victimes de leur ivrognerie, que pour périr de faim sur une île déserte? Sa jeunesse et son énergie reprenant le dessus, il s'aventura à travers la jungle et gravit, non sans de grandes difficultés, l'une des montagnes. Il n'y avait évidemment pas de chemin frayé, les rocs étaient friables par endroits et les arbres, qui avaient bien du mal avec leur courtes racines, pour rester agrippés au sol rocheux, n'offraient qu'un recours dérisoire et même dangereux. Néanmoins, parvenu en haut de la montagne, notre homme reçut sa récompense, sous la forme de quelques maisons qui se distinguaient de la verdure environnante. Des maisons, cela veut dire des hommes! Charpentier était sauvé. Il est plus facile d'approcher la vérité à peopos d'Alfred de Rodt. Des sources sérieuses existent. Il a rédigé un journal qui a été publié : El diario de Alfredo de Rodt, subdelegado e inspector de colonia de las Islas Juan Fernández - Editorial Cumberland, 2005. Cet ouvrage est difficile à trouver, mais il a été utilisé à plusieurs reprises par la presse helvétique, chilienne ou d'autres pays. Pour ce qui concerne sa biographie, antérieurement à son arrivée au Chili. Nous pouvons nous référer au Dictionnaire historique de Suisse. Voici ce qu'on y lit : de Rodt est né le 10 septembre 1843, à Berne, et il est mort le 4 juillet 1905, à San Juan Bautista (archipel Juan Fernández, Chili). Il était le fils de Karl et de Marie Sophie Françoise van der Meulen. Il fut scolarisé à Berne, et poursuivit des études d'ingénieur forestier à Tharandt (Saxe), puis à l'Ecole polytechnique de Zurich (sans diplôme). Il s'engagea dans l'armée autrichienne en 1865; officier, il fut blessé en 1866 à la bataille de Nachod (Bohême) et réformé en 1870. Il séjourna en France et en Espagne, puis émigra au Chili, où il obtint, en 1877, le droit d'exploiter les ressources de l'archipel Juan Fernández. La guerre du Pacifique (1879-1884) le ruina, en entraînant la chute des exportations de bois et de fruits de mer (notamment des langoustes). Il fut nommé inspecteur colonial en 1895. Orphelin de sa mère depuis l'âge de trois ans, le jeune de Rodt était en conflit permanent avec sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Jeune homme romantique (sa bibliothèque comprenait toutes les oeuvres de l'Allemand Friedrich von Schiller), il méprisait le milieu aristocratique dans lequel sa belle-mère évoluait. C'est probablement ce qui le poussa à s'engager dans la cavalerie autrichienne, à l'âge de 21 ans. On l'a vu, il fut grièvement blessé à la jambe droite, le 27 juin 1866, pendant la guerre prusso-autrichienne. Il reçut le grade de capitaine, mais dut rentrer à Berne pour se soigner. Sa carrière militaire fut brisée en 1870, les médecins militaires autrichiens décidant de le réformer. Ce qui ne l'empêcha pas de participer à la guerre franco-allemande de 1870, dans les rangs français. Fortuné, et disposant d'un compte bancaire à Berne, Alfred de Rodt décide alors de prendre en mains son destin et de le réaliser selon ses aspirations. Ses pas le dirigent vers le Chili. On le trouve en mars 1876, à Valparaiso, plaque tournante des chercheurs d'or, venus des quatre coins du monde, pour se diriger vers la Californie sur laquelle se ruent alors les assoiffés de métal jaune. Il se rend à cheval en Argentine, puis au Brésil, avant de revenir au Chili. A ce moment, le gouvernement chilien s'interroge sur ce qu'il pourrait bien faire de l'île Mas a Tierra dont l'intérêt stratégique est évident. En 1829, une colonie pénitentiaire y a été établie avec une petite garnison. Le 26 février 1829, un bail a été signé avec un certain José Joachim Larrain, qui souhaitait y établir un port et un magasin général pour les baleiniers. Mais ce projet a échoué. Divers locataires lui ont succédé. Ils ont contribué à déboiser l'île, pour en vendre le bois, et pour créer des prairies propres à l'introduction de bovins. En 1835, Manuel Tomas Martinez est nommé gouverneur de l'île. Il se lance dans l'exploitation du bois de santal. Il en résulte un nouveau désastre écologique : l'espèce est aujourd'hui éteinte! En 1851, l'archipel devient une subdélégation de Valparaiso. Mais les locataires se désintéressent d'une terre dont les ressources ont été largement réduites. En 1876, le capitaine Oscar Viel, à bord du Chacabuco, constate que l'île est à l'abandon et ne rapporte plus rien au fisc chilien. Elle n'abrite plus que 37 habitants – dont sept femmes et dix enfants dans la misère. A son retour sur le continent, il propose au Trésor public de lancer un appel d'offres pour louer l'archipel. L'Administration met en oeuvre la proposition d'Oscar Viel. De Rodt, qui est alors à Vinã del Mar, saute sur l'occasion, il développe d'ambitieux projets et les présente. Cet homme encore jeune, possède une bonne formation et de l'expérience; il a 33 ans, et remporte facilement l'adjudication, dont il était d'ailleurs le seul soumissionnaire! Le 17 avril 1877, de Rodt est donc nommé
subdélégué pour l'archipel Juan Fernandez (et aussi,
selon une source chilienne : chef de l'archipel, juge de subdélégation,
garde forestier, subdélégué maritime, ministre des
douanes et administrateur de La Poste, entre autres...) Le 6 juillet, il
quitte Valparaiso sur son premier bateau, le Charles-Edwards qui porte
94 tonnes de matériels divers, et quatorze passagers, femmes et
enfants compris. Plus tard, en tant qu'armateur, il possédera une
flottille de cinq grands bateaux et exploitera une route commerciale pour
le transport de passagers et de produits de l'île au continent. Il
parvient le 21 juillet dans la baie de Cumberland. A cette époque,
l'île compte 56 habitants, 100 vaches, 60 chevaux et quelques 7 000
chèvres sauvages. Notre homme va s'efforcer de développer
son territoire selon deux axes : d'abord, l'autosuffisance alimentaire
(la terre est fertile et le climat propice à l'agriculture, même
si l'espace cultivable est limité); ensuite l'exportation vers le
continent de peaux d'otaries, de poissons et de langoustes. Dans une lettre
à un membre de sa famille, il parle d'élever sur l'île
un millier de vaches! Le 1er août 1877, les pêcheurs de Mas
a Tierra entreprennent leur première campagne de pêche sous
l'impulsion du baron, comme vont désormais l'appeler ses administrés.
Mais les ennuis ne tardent pas. Le 22 février 1878, après seulement six voyages, le petit trois-mâts que de Rodt a acheté pour effectuer ses transports sur le continent est jeté sur des rochers, près de Valparaíso, avec un chargement de bois et 450 peaux d'otaries à bord, lors d'une violente tempête. L'équipage réussit à se sauver, mais le navire est totalement détruit. Il était assuré, mais la cargaison ne l'était pas, ce qui représente une lourde perte. D'après une source suisse (Tribune de Genève), de Rodt est contraint de faire appel à sa famille. Mais il ne se décourage pas. En septembre, il considère que son expérience est une réussite puisqu'il n'est pas venu ici pour s'enrichir très vite mais pour vaincre sa paresse et travailler sérieusement. Malgré les difficultés, la population de l'île augmente progressivement. En 1879, on compte 141 habitants, puis 147 l'année suivante, pour moitié des enfants. En 1892, de Rodt s'associe à la compagnie Carlos Fonck et Cie pour pêcher et mettre en conserve les langoustes. Cette association sous contrainte, de Rodt manquant de fonds pour réaliser les investissements nécessaires, ne tient pas. La conserverie, qui s'avère non rentable, doit fermer. De 1879 à 1884, la guerre du Pacifique, entre le Chili, la Bolivie et le Pérou entraîne la chute des exportations de fruits de mer, de poissons et de bois de l'île. De Rodt possède alors 250 bovins et 300 moutons achetés l'année précédente. Il a noué des relations commerciales avec Antofagasta, alors bolivienne; le sort de la guerre en fait une ville chilienne. La situation financière de notre entrepreneur suisse se dégrade un peu plus. Il doit solliciter son oncle. Et il regarde désormais du côté de l'armée chilienne qu'il espère approvisionner en caisses pour armes et munitions. Ancien officier de cavalerie, il rêve d'élever des chevaux pour la remonte de l'armée de son pays. N'est-il pas chilien et n'a-t-il pas changé son prénom pour celui d'Alberto? En attendant, il vend des peaux d'otaries en Angleterre et il exporte du bois, du charbon, du cuir de vache et des peaux de chèvres. Pour éviter l'attaque ou la confiscation de ses bateaux pendant la guerre, il a tenté de les immatriculer en Suisse, mais s'est heurté à un refus. Il engage néanmoins des chasseurs, des pêcheurs, des bûcherons et des scieurs, qu'il paye malgré l'absence de débouchés suffisants pour ses produits. Contraint de vendre son bétail pour obtenir de la trésorerie, il frôle plusieurs fois la faillite mais peut heureusement compter sur ses amis et ses demi-frères, Gottfried et Henri de Rodt, à Vevey, qui l'aident à garder la tête hors de l'eau. En 1885, les autorités chiliennes décident de ne pas renouveler le bail de de Rodt qui arrive à son terme. Mais le gouvernement lui laisse l'administration de l'île jusqu'à une décision du Congrès sur son futur statut. Finalement, en 1895, le président Jorge Montt déclare l'archipel colonie chilienne et nomme de Rodt inspecteur de la colonisation. Deux ans plus tard, le président Federico Errazuriz Echaurren, rend visite à l'inspecteur et à son île. Cette reconnaissance officielle, n'enrichit pas de Rodt, qui a englouti presque toute sa fortune, mais elle consacre la réussite morale de son projet visionnaire : l'île a cessé à nouveau d'être déserte grâce à l'initiative, à l'énergie et à l'élan que lui a insufflée son baron. Tout en suivant son chemin semé d'embûches, de Rodt, s'est doté d'une compagne locale, Antonia Sotomayor Flandes, une Créole chilienne, d'autres disent un Espagnole. Le 27 mai 1883, elle donne naissance à leur premier fils, Alfredo, hors mariage, car les tourteraux ne sont passés ni devant monsieur le maire ni devant monsieur le curé, ou ce qui en tient compte sur l'île. Quatre autres garçons et une fille suivront jusqu'en 1895. Il n'ose pas déclarer ces naissances illégitimes à ses correspondants suisses jusqu'au jour où un prêtre, venu visiter l'île, s'aperçoit que l'inspecteur de la colonisation donne le mauvais exemple en vivant dans le péché, comme d'ailleurs beaucoup d'autres habitants de Juan Bautista. Il faut que ce scandale cesse. De Rodt régularise donc sa situation, à l'âge de 59 ans, en 1902, et la famille suisse est avisée de l'augmentation subite du cousinage. Seulement, le lointain parent d'Amérique ne déclare que quatre rejetons, tous bien bâtis et dignes de leurs origines, alors qu'il en a cinq! Il oublie le petit dernier. Il est vrai que Luis Alberto n'a pas encore 7 ans! Quant à la fille, Antonia Aida, dite Antuquita Chica, elle est décédée de la grippe en janvier 1901. Le jeune marié, épuisé par ses travaux, est atteint dans sa santé. Les séquelles des blessures à sa jambe le font souffrir, il boite. Il est de plus probablement atteint de démence précoce, comme le montre, à partir de 1901, la dégradation de son écriture dans son journal, jusque-là impeccablement tenu. Il meurt le 4 juillet 1905, sans avoir revu sa terre natale. Il est inhumé dans le cimetière près de la baie où il a débarqué vingt-huit ans plus tôt. Sa colonie compte alors 122 habitants, issus de 22 familles : treize chiliennes, deux italiennes, deux allemandes, une portugaise, une anglaise, une française, une russe et une suisse. De nos jours, la famille de Rodt est éteinte en Suisse, mais plusieurs dizaines de descendants d'Alfred vivent sur l'île Mas a Tierra, devenue Robinson Crusoë. Une dernière question, elle concerne une grande voyageuse, Cécile de Rodt, qui publia "Voyage d'une Suissesse autour du monde - Neufchatel - Zahn - 1904". Cette personne faisait-elle partie de la famille de notre baron? La mort du baron n'interropt pas le développement de l'île et de son archipel. En 1935, l'archipel est classé parc national. En 1977, il devient réserve mondiale de la biosphère grâce à l'UNESCO. En 1980, la municipalité de Juan Fernandez est créée, mais elle ne couvre que 8% de l'île, le reste relevant du parc national. En 1966, les îles sont rebaptisées, comme on l'a déjà dit, dans une volonté manifeste de promotion touristique en exploitant le mythe populaire de Robinson Crusoë. En 2005, pour le centième anniversaire
de la mort d'Alfred de Rodt, au cours d'une cérémonie en
présence de l'ambassadeur de Suisse au Chili, une plaque est apposée
en hommage au baron sur sa tombe. La même année, le Journal
de de Rodt est publié; je ne suis pas parvenu à me le procurer;
il semble ne se trouver qu'au Musée naval de Valparaiso. En 2010,
le tsunami bouleverse Juan Bautista, dévaste son cimetière
et disperse les documents et objets du musée.
Comment concilier l'épopée du Suisse de Rodt, telle que j'ai pu la reconstituer, malheureusement sans avoir accès directement à son journal, avec le récit romancé de l'aventure de Charpentier? Je n'ai trouvé qu'une source où les deux personnages se retrouvent. Dans son ouvrage Chili, une folle géographie, Editorial Universitaria, Benjamin Subercaseaux mentionne Charpentier qui, dit-il, en compagnie du Suisse Alfred de Rodt et de l'industriel Louis Recart, introduisirent la pêche à la langouste et obtinrent du gouvernement chilien la première concession pour une industrie qui devait devenir ultérieurement célèbre dans tout le continent. Cette mention n'est évidemment pas une preuve. Mais elle laisse supposer que tout n'est pas faux dans le roman de Robert Gaillard. Aujourd'hui, les familles de Rodt et Charpentier, unies par des mariages, font partie des notabilités de l'île. Quoi qu'il en soit, pour ce qui me concerne, je trouve réconfortant que, dans notre période de mondialisation, subsiste sur une petite île une population qui s'attache à sa terre et s'y projette vers l'avenir en consommant ce qu'elle produit et en prenant le temps de vivre sans trop se soucier des modes et des tourbillons de l'instant présent qui agitent nos sociétés plus ou moins déséquilibrées. Pendant mon séjour sur l'île de Robinson Crusoë, je me souviens avoir discuté avec l'architecte néo-calédonien sur le sort des habitants de Tristan da Cunha, île de l'Atlantique, qu'il avait visitée. En 1961-1962, l'éruption volcanique du Queen Mary's Peak provoqua leur évacuation au Royaume-Uni. La majorité d'entre eux revinrent sur l'île après quelques années, préférant sa solitude et sa désolation au confort artificiel du consumérisme européen. Leur île est pourtant considérée comme la terre la plus isolée du monde. Son accès est particulièrement difficile en raison des conditions climatiques, de son éloignement (au moins sept jours de mer depuis l'Afrique du Sud) et de la rareté des bateaux. Robinson Crusoë et Tristan da Cunha, deux exemples à méditer! Nombreuses sont les épaves qui gisent au fond de l'océan, autour de l'île. Elles n'ont sans doute pas encore été toutes répertoriées; il y a donc de quoi exciter l'appétit des chercheurs de trésors. D'autant que l'or n'est peut-être pas toujours enfoui sous les eaux. D'après la légende, des pirates auraient dissimulé leur magot quelque part sous le sol rocailleux de l'île. La légende est crédible; les bateaux pirates faisaient fréquemment escale au port des Anglais, pour y relâcher et partager leurs prises. Quoi de plus simple que d'enterrer une partie du butin en un lieu secret facile à retrouver plus tard en cas de besoin! On le met ainsi au moins à l'abri des rencontres sur mer dont on ne sait jamais au profit de qui elles peuvent tourner. Mais, si cachette il y a, elle est demeurée jusqu'à présent introuvable, malgré les fouilles. Le capitaine crochet de l'endroit n'a pas laissé de carte! En 1998, un riche Américain, Bernard
Keiser, se lance dans la chasse au trésor sur l'île de Robinson
Crusoë. Il obtient l'autorisation d'entreprendre des fouilles. Mais
l'inscription en réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO
soulève quelques problèmes de compatibilité. Keiser
aurait essentiellement creusé auprès du Port des Anglais.
Il y aurait découvert des boutons et quelques tessons de porcelaine
chinoise qui valident le passage de vaisseaux européens, sans apporter
réellement rien de nouveau par rapport à ce qui se savait
déjà. Cela n'empêche pas d'autres aventuriers de l'imiter.
Dans les cafés de Santiago, il n'est pas rare de rencontrer des
gens qui rêvent de faire fortune rapidement en trouvant le bon filon.
Je connais personnellement deux frères qui ont sacrifié une
dizaine de vaches pour devenir chercheurs d'or dans la Cordillère
d'où ils sont revenus bredouilles. Dans bien des esprits latino-américains,
et aussi d'ailleurs, le mythe de l'Eldorado est encore présent,
comme le montre l'encarté ci-dessous.
Le soir, je ne suis plus seul à l'hôtel. L'avion en provenance de Santiago n'avait ni passagers, ni caisses de langoustes pour le retour. Il est donc resté sur l'île. On me demande si j'accepterais de dîner en compagnie du pilote. Je donne bien volontiers mon accord. L'homme est sympathique et nous ne tardons pas à lier conversation. Nous nous trouvons des points communs. Nous sommes tous les deux amateurs d'histoire en général et de la période napoléonienne en particulier. Son fils a visité Paris, avec la recommandation du père de ne pas oublier la visite au tombeau des Invalides. Le fils a obéi et a envoyé au père une carte, en souvenir de cette visite. Nous évoquons aussi nos activités professionnelles réciproques. Le pilote est retraité mais, comme sa pension n'est pas assez élevée à son goût, il a repris du service sur les petits appareils qui font la navette entre Santiago et Juan Bautista. Il me raconte une histoire qui est arrivée, à lui ou à un de ses amis, je ne me souviens plus. La personne en question pilotait un avion de ligne. Soudain, tout contact fut coupé avec la tour de contrôle. Il pensa à une panne des instruments. Mais lorsqu'il s'approcha de la piste, il la vit se gondoler devant lui. Un tremblement de terre secouait l'aéroport. Il dut reprendre de la hauteur et chercher, dans l'angoisse, un autre endroit où se poser sans dommage. Heureusement, pour lui et pour les passagers, il y parvint avant d'avoir épuisé son carburant. La soirée se passe ainsi agréablement en discussions enrichissantes. Le lendemain, retour à Santiago. Le ciel est couvert et, sur la lancha, le pilote s'interroge. La visibilité sera-t-elle suffisante pour décoller sans risque? Finalement, sur le plateau, elle est correcte. Le pilote m'invite à m'asseoir à ses côtés, dans la cabine de pilotage. Nous prenons l'air sans problème. Je bénéficie d'une vue panoramique sans comparaison avec celle des passagers qui sont derrière nous. Peu à peu, je me familiarise même avec les cadrans du tableau de bord. A peu près à mi chemin, il me semble que la jauge à essence est anormalement basse. Naturellement, je garde mes réflexions pour moi. Quelques instants plus tard, le pilote lève le bras et tourne un petit robinet au-dessus de sa tête. La jauge se remet à monter. Il y avait donc un second réservoir. Après deux heures et demi de vol, nous atterrissons sur l'aéroport de Santiago, où se tient un meeting aérien. Je prends congé de Dario, mon nouvel ami le pilote, par une vigoureuse poignée de main. |